|
 Les autres milieux Les autres milieux |
 De nombreuses zones humides remarquables De nombreuses zones humides remarquables |
|
En raison du faible relief de la région, ainsi que de la nature géologique (argile, craie) de son sous-sol, le Nord - Pas-de-Calais a des zones humides de grand intérêt. Les roselières, tourbières alcalines, étangs et marais, prairies humides et mares prairiales constituent une mosaïque de milieux assurant une grande biodiversité. Les zones humides couvrent 9 % des espaces naturels  14. La région comprend trois unités importantes : les baies et les marais arrière-littoraux situés à l’arrière des cordons dunaires, les zones humides en fond de vallée et les étangs issus des affaissements miniers. Les zones humides les plus remarquables sont les marais de l’Audomarois, de Guines, et de d’Erquinghem, le complexe alluvial de la Scarpe et de l’Escaut, la Sambre, les basses vallées de l’Authie, de la Canche et de la Slack. Il n’existe que deux zones humides reconnues d’intérêt national dans la région : l’ensemble des vallées alluviales de la Scarpe et l’Escaut (7 000 hectares classés), et l’ensemble de la plaine maritime picarde avec les baies de la Canche et de l’Authie ainsi que les marais arrière-littoraux. 14. La région comprend trois unités importantes : les baies et les marais arrière-littoraux situés à l’arrière des cordons dunaires, les zones humides en fond de vallée et les étangs issus des affaissements miniers. Les zones humides les plus remarquables sont les marais de l’Audomarois, de Guines, et de d’Erquinghem, le complexe alluvial de la Scarpe et de l’Escaut, la Sambre, les basses vallées de l’Authie, de la Canche et de la Slack. Il n’existe que deux zones humides reconnues d’intérêt national dans la région : l’ensemble des vallées alluviales de la Scarpe et l’Escaut (7 000 hectares classés), et l’ensemble de la plaine maritime picarde avec les baies de la Canche et de l’Authie ainsi que les marais arrière-littoraux.
La grande originalité des zones humides du Nord - Pas-de-Calais tient au fait que les interventions humaines ont façonné depuis des millénaires ces paysages. Les rivières sont marquées par une forte tradition d’aménagement hydraulique qui a largement contribué à artificialiser les cours d’eau. Les aménagements successifs, commandés par les impératifs économiques, ont profondément modifié les équilibres antérieurs et entraîné un changement des régimes hydrologiques. Dans les zones minières, les exploitations charbonnières ont, dans un premier temps, désorganisé les conditions hydrologiques mises auparavant en place par l’activité agricole (aménagement et drainage) puis, dans un deuxième temps, les ont à nouveau changé lors de l’abandon de l’activité minière. Les effondrements miniers rendent les nappes affleurantes et donc plus vulnérables aux pollutions diffuses. Dans les vallées alluviales de la Scarpe et de l’Escaut, creusement de plans d’eau pour la chasse et intensification des pratiques agricoles ont entraîné l’abaissement général de la nappe et la perte progressive du caractère humide. Dans la vallée de la Marque, les marais ont fortement régressé petit à petit à cause de l’urbanisation et de leur remblaiement. D’après l’atlas des zones inondables, leur diminution, en supprimant les zones naturelles d’étalement des eaux, est en partie responsable des inondations dans cette vallée. Comme partout en France, les zones humides de la région sont victimes des pratiques agricoles intensives (drainage, populiculture) et de l’artificialisation du sol. Bien que ce soit un enjeu majeur pour la région, elles diminuent progressivement. Pourtant, de leur qualité dépend souvent celle des eaux souterraines  15 et leur maintien est un atout pour réguler les crues saisonnières : elles absorbent l’eau en période de pluie et la restituent en période de sécheresse. 15 et leur maintien est un atout pour réguler les crues saisonnières : elles absorbent l’eau en période de pluie et la restituent en période de sécheresse.
Les zones humides hébergent une flore et une faune très spécialisées. Ce sont des milieux remarquables qui jouent un rôle important pour la biodiversité. Elles sont essentielles pour la sauvegarde des espèces migratrices. Mais, la disparition de certaines espèces comme la loutre ou les menaces qui pèsent sur d’autres (le triton crêté, le vespertilion des marais, la couleuvre à collier  16, les butors 16, les butors  17, la rousserolle turdoïde) témoignent des pressions que subissent ces milieux. Le maintien des corridors biologiques y est essentiel, mais il est souvent confronté à l’artificialisation du sol qui ne permet pas d’assurer le continuum nécessaire. Chaque nouvel aménagement génère des conflits d’usage, qui révèlent soit une inadaptation des réglementations ou des encouragements 17, la rousserolle turdoïde) témoignent des pressions que subissent ces milieux. Le maintien des corridors biologiques y est essentiel, mais il est souvent confronté à l’artificialisation du sol qui ne permet pas d’assurer le continuum nécessaire. Chaque nouvel aménagement génère des conflits d’usage, qui révèlent soit une inadaptation des réglementations ou des encouragements  18, soit une méconnaissance des phénomènes qui devraient guider l’usage des sols. Le programme national de recherche sur les zones humides 18, soit une méconnaissance des phénomènes qui devraient guider l’usage des sols. Le programme national de recherche sur les zones humides  19 tente d’apporter des réponses à ces questions qui sont loin d’être spécifiques à la région Nord - Pas-de-Calais. 19 tente d’apporter des réponses à ces questions qui sont loin d’être spécifiques à la région Nord - Pas-de-Calais.
Les zones humides occupent aujourd’hui une place importante dans le débat régional sur le développement durable. Mais, elles sont encore très peu protégées, mises à part quelques exceptions comme les terrains publics de Guines, la réserve naturelle volontaire du Romelaëre et certains marais de la Scarpe et de l’Escaut (Chabaud-La-Tour).
 Les milieux secs Les milieux secs |
|
Comme pour les milieux humides, la majorité des pelouses sèches sont fortement liées aux activités humaines. Outre les pelouses dunaires, les pelouses euryhalines et les pelouses sur schistes miniers, on trouve en Nord - Pas-de-Calais des pelouses calcicoles sur les coteaux crayeux et les affleurements calcaires issues du défrichement (environ un millier d’hectares) et, de manière plus ponctuelle, des pelouses silicicoles  20 sur sols acides et pauvres. Toutes deux ont été maintenues par le pâturage itinérant, activité pratiquement inexistante à l’heure actuelle. D’une façon générale, ces pelouses régressent sur le territoire national et notamment dans la région. De leur maintien dépend la conservation d’espèces peu courantes : aceras hommependu, orchis pourpre, orchis mouche, gentiane d’Allemagne, blaireau. Dans le bassin minier, notamment dans les vallées de la Scarpe et de l’Escaut, on trouve des milieux très particuliers issus des anciennes activités industrielles et minières. Des espèces originales se développent sur les schistes des terrils et certains terrains pollués. On trouve des pelouses sur les schistes des terrils et des pelouses calaminaires à armérie de Haller sur les terrains pollués par les métaux lourds (zinc, plomb, cadmium). Les interventions des gestionnaires des espaces naturels favorisent le pâturage sur les pelouses calcicoles et les landes dont ils ont la gestion : départements du Nord et du Pas-de- Calais, Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais 20 sur sols acides et pauvres. Toutes deux ont été maintenues par le pâturage itinérant, activité pratiquement inexistante à l’heure actuelle. D’une façon générale, ces pelouses régressent sur le territoire national et notamment dans la région. De leur maintien dépend la conservation d’espèces peu courantes : aceras hommependu, orchis pourpre, orchis mouche, gentiane d’Allemagne, blaireau. Dans le bassin minier, notamment dans les vallées de la Scarpe et de l’Escaut, on trouve des milieux très particuliers issus des anciennes activités industrielles et minières. Des espèces originales se développent sur les schistes des terrils et certains terrains pollués. On trouve des pelouses sur les schistes des terrils et des pelouses calaminaires à armérie de Haller sur les terrains pollués par les métaux lourds (zinc, plomb, cadmium). Les interventions des gestionnaires des espaces naturels favorisent le pâturage sur les pelouses calcicoles et les landes dont ils ont la gestion : départements du Nord et du Pas-de- Calais, Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais  21, parcs naturels régionaux. On peut enfin noter que certaines végétations du Nord - Pas-de-Calais sont considérées comme endémiques de cette région : pelouses du cap Blanc-Nez et du coteau de Dannes et Camiers, pelouses sur sables décalcifiés du pré communal d’Ambleteuse et la dune fossile de Ghyvelde. 21, parcs naturels régionaux. On peut enfin noter que certaines végétations du Nord - Pas-de-Calais sont considérées comme endémiques de cette région : pelouses du cap Blanc-Nez et du coteau de Dannes et Camiers, pelouses sur sables décalcifiés du pré communal d’Ambleteuse et la dune fossile de Ghyvelde.
| |
|
 La colonisation des zones humides par les peupleraies entre 1991 et 1998 dans la région de Douai. La colonisation des zones humides par les peupleraies entre 1991 et 1998 dans la région de Douai.
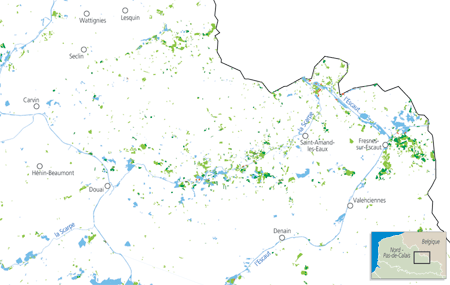
|
|
|
 Des forêts rares mais importantes pour la biodiversité Des forêts rares mais importantes pour la biodiversité |
|
Les surfaces forestières couvrent 111 563 hectares, soit plus de 60 % de la superficie naturelle ; elles ont augmenté de 3,5 % depuis 1993  22. Le taux de boisement au sens de l’Inventaire forestier national (IFN) est très faible en région, il ne concerne que 6,6 % de l’ensemble du territoire. Des massifs forestiers comme les forêts de Mormal, de Nieppe ou de Raismes participent à la richesse écologique de la région. 70 % des forêts de la région (feuillus ou résineux) sont classées en ZNIEFF et 10 % en ZICO. 35 320 hectares de forêt, essentiellement de feuillus, sont soumis au régime forestier ; 66 % de la production annuelle est prélevée chaque année à des fins de production de bois d’œuvre. Les boisements privés représentent 60 % de la superficie boisée. La pratique des plans simples de gestion garantit la préservation de la biodiversité. En revanche, la pratique de la populiculture, en zones humides, bien que stable depuis 1988, reste un facteur de pression sur ces milieux. 22. Le taux de boisement au sens de l’Inventaire forestier national (IFN) est très faible en région, il ne concerne que 6,6 % de l’ensemble du territoire. Des massifs forestiers comme les forêts de Mormal, de Nieppe ou de Raismes participent à la richesse écologique de la région. 70 % des forêts de la région (feuillus ou résineux) sont classées en ZNIEFF et 10 % en ZICO. 35 320 hectares de forêt, essentiellement de feuillus, sont soumis au régime forestier ; 66 % de la production annuelle est prélevée chaque année à des fins de production de bois d’œuvre. Les boisements privés représentent 60 % de la superficie boisée. La pratique des plans simples de gestion garantit la préservation de la biodiversité. En revanche, la pratique de la populiculture, en zones humides, bien que stable depuis 1988, reste un facteur de pression sur ces milieux.
 Deux zones bocagères remarquables Deux zones bocagères remarquables |
|
Avec 6,1 % des espaces naturels couverts de haies, boisements de faible densité et arbres épars, la région se situe dans la moyenne nationale (6,6 %). Pourtant, leur surface a diminué de 3 % entre 1993 et 2001. Dense et diversifié, le bocage est à la fois d’un grand intérêt écologique pour la biodiversité et d’un grand intérêt agronomique pour la protection des cultures et du bétail ainsi que pour la lutte contre l’érosion. Les haies constituent un biotope de substitution à de nombreuses espèces. Elles forment un réseau écologique qui permet le déplacement de la flore et les échanges entre différents biotopes, essentiels à la reproduction des espèces. Les noisetiers, l’aubépine, les saules ou les charmes têtards sont les espèces emblématiques des haies.
Les systèmes bocagers les plus exemplaires du Nord - Pas-de-Calais sont situés dans le Boulonnais et l’Avesnois. Le Boulonnais offre un paysage façonné par la diversité des substrats géologiques et par son histoire. C’est une véritable mosaïque de milieux naturels qui compte sept ZNIEFF. Héritier de deux mille ans d’histoire agraire, les sols argileux et la topographie vallonnée y entretiennent une humidité favorable à la vocation herbagère. Marquées par la présence du frêne et de l’aubépine, du hêtre et du houx, certaines haies patrimoniales, qui ont des siècles d’ancienneté, portent encore la trace d’anciennes pratiques de tressage  23. Dans l’Avesnois, où un bocage de haute qualité écologique s’est développé, les haies sont complétées par des alignements de charmes têtards. C’est une zone d’élevage et de production laitière qui se compose de parcelles souvent de petites dimensions et plantées de pommiers et de quelques cerisiers. 53 000 hectares de prairies et 12 000 kilomètres de haies ont été inventoriés dans le périmètre du parc naturel régional de l’Avesnois. Le bocage de Marache à Ecuélin dans le parc de l’Avesnois est désormais une réserve naturelle régionale. 23. Dans l’Avesnois, où un bocage de haute qualité écologique s’est développé, les haies sont complétées par des alignements de charmes têtards. C’est une zone d’élevage et de production laitière qui se compose de parcelles souvent de petites dimensions et plantées de pommiers et de quelques cerisiers. 53 000 hectares de prairies et 12 000 kilomètres de haies ont été inventoriés dans le périmètre du parc naturel régional de l’Avesnois. Le bocage de Marache à Ecuélin dans le parc de l’Avesnois est désormais une réserve naturelle régionale.
En Nord - Pas-de-Calais, comme partout en France, les haies sont menacées par les pratiques de l’agriculture intensive. Les surfaces toujours en herbe, surtout localisées en Avesnois, Thiérache, Boulonnais, haut pays d’Artois, Ternois et en aval de la vallée de la Scarpe, régressent. C’est pourquoi l’enjeu est aujourd’hui d’assurer la pérennité de ce patrimoine en favorisant les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Le parc des caps et des marais d’Opale et celui de l’Avesnois apportent des conseils sur les aménagements fonciers ou sur les remembrements afin de limiter la suppression des haies. Le parc de l’Avesnois a mis en œuvre un « plan bocage » qui vise à préserver les paysages (maillage des haies, mares prairiales, vergers, chemins ruraux, bois et forêts). Il développe dans ce cadre des actions diversifiées : inventaire et cartographie des haies, information des agriculteurs et animation, plantation de haie, entretien et valorisation économique du bocage, etc. De son côté, le parc des caps et des marais d’Opale mène des actions similaires, dont certaines reprennent les objectifs des mesures agri-environnementales dans le cadre des contrats territoriaux d’exploitation et, aujourd’hui, des contrats d’agriculture durable.
 Le rôle de la trame verte Le rôle de la trame verte |
|
La trame verte est le souhait politique partagé de protéger un réseau maillé d’espaces naturels ou de nature (espaces boisés, bordures de canaux et de cours d’eau, alignements, haies vives bocagères, terrils, parcs urbains et périurbains) qui joue un rôle paysager, de corridors biologiques, de préservation des milieux ou de création d’espaces de loisirs. C’est un élément déterminant du paysage régional qui recouvre une grande diversité de réalités. Pour certains acteurs, y contribuant, son rôle est avant tout paysager. Pour d’autres, elle participe au maintien de la biodiversité en établissant des continuités entre différents sites. Le profil environnemental régional souligne que si les « nœuds » (ou noyaux), c’est-à-dire les espaces incontournables de par leur fonction ou leur qualité sont bien identifiés, les espaces de liaison sont en revanche moins bien définis. Pour en faciliter l’élaboration et la gestion, il suggère de mieux préciser ces fonctions.
 Notes Notes
|
|
14 - Source : Scees, Teruti, 2001.
15 - In contribution régionale aux schémas de services collectifs.
16 - Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais.
17 - Plongions nain, grand butor.
18- Plantation de peupliers subventionnées et exonération fiscale.
19 - Voir http://www.oieau.fr/hydrosys/gip-zhpr.htm
20 - Avesnois.
21 - Voir http://www.conservatoiresitesnpc.org
22 - Source : Ifen - Scees, Teruti, 2002.
23 - Pratique consistant à rabattre les branches les plus basses.
|
|
|