|
 Les eaux littorales Les eaux littorales |
La qualité des eaux du littoral dépend de la qualité des eaux continentales et des activités littorales mais aussi des activités maritimes [les risques liés au transport de matières dangereuses sont abordés dans le chapitre Transports]. Le domaine public maritime est le milieu récepteur des cours d’eau, des fleuves côtiers et des canaux qui drainent l’essentiel des rejets industriels, agricoles, urbains et pluviaux. Ces rejets peuvent potentiellement menacer la qualité des eaux marines et entraîner l’eutrophisation, la non-conformité des produits conchylicoles ou le mauvais classement de certaines plages. Cependant, si l’on veut garantir certaines activités économiques, la qualité des eaux marines ne se limite pas seulement à celle des eaux de baignade mais aussi à la qualité microbiologique, conchylicole et chimique des coquillages ainsi qu’à la qualité nutritive phytoplanctonique des eaux.
 La qualité retrouvée des eaux de baignade La qualité retrouvée des eaux de baignade |
|
En 1988, l’agence de l’Eau Artois-Picardie dressait le constat de la qualité " catastrophique "  57. des plages du littoral du Nord - Pas-de-Calais : 50 % des eaux de baignade de la France métropolitaine de mauvaise qualité étaient alors dans la région. Depuis, des efforts considérables ont été réalisés. La qualité de l’eau de baignade s’est fortement améliorée, passant de 50 % de conformité vis-à-vis de la directive relative aux eaux de baignade en 1987 à 100 % en 1998. Cependant, depuis 1997, la part des plages classées en très bonne qualité se dégrade régulièrement passant de 47 % en 1997 à 30 % en 2000, puis à 24 % en 2001, pour atteindre 44 % en 2002. 57. des plages du littoral du Nord - Pas-de-Calais : 50 % des eaux de baignade de la France métropolitaine de mauvaise qualité étaient alors dans la région. Depuis, des efforts considérables ont été réalisés. La qualité de l’eau de baignade s’est fortement améliorée, passant de 50 % de conformité vis-à-vis de la directive relative aux eaux de baignade en 1987 à 100 % en 1998. Cependant, depuis 1997, la part des plages classées en très bonne qualité se dégrade régulièrement passant de 47 % en 1997 à 30 % en 2000, puis à 24 % en 2001, pour atteindre 44 % en 2002.
Ces bons résultats ont permis au littoral d’être l’élément fort de la politique de développement touristique de la région. Ils sont le fruit du travail amorcé depuis une dizaine d’années en matière de traitement des eaux  58. Cependant, il existe encore quelques problèmes en période pluvieuse car les stations d’épuration n’ont pas la capacité de traiter la totalité des flux. La plage de Boulogne-sur-Mer est toujours interdite à la baignade mais ce point noir devrait être rapidement résorbé. Des travaux sont en cours dans la station d’épuration (200 000 EH) afin de la mettre en conformité vis-à-vis de la directive relative aux eaux résiduaires urbaines. 58. Cependant, il existe encore quelques problèmes en période pluvieuse car les stations d’épuration n’ont pas la capacité de traiter la totalité des flux. La plage de Boulogne-sur-Mer est toujours interdite à la baignade mais ce point noir devrait être rapidement résorbé. Des travaux sont en cours dans la station d’épuration (200 000 EH) afin de la mettre en conformité vis-à-vis de la directive relative aux eaux résiduaires urbaines.
 La reconquête conchylicole La reconquête conchylicole |
|
La qualité des eaux conchylicoles s’améliore progressivement. Pour la première fois, une zone de production de coquillages (gisement conchylicole  59. du Gris-Nez) vient d’être classée A 59. du Gris-Nez) vient d’être classée A  60. du point de vue de la salubrité. Mais les gisements de production coquilliers de la région, qu’ils soient naturels ou d’élevage, restent pour l’essentiel encore aujourd’hui classés en B (qualité moyenne).Il subsiste cependant quelques zones à risques (où le ramassage et la commercialisation des coquillages sont interdits), notamment en baie de Canche 60. du point de vue de la salubrité. Mais les gisements de production coquilliers de la région, qu’ils soient naturels ou d’élevage, restent pour l’essentiel encore aujourd’hui classés en B (qualité moyenne).Il subsiste cependant quelques zones à risques (où le ramassage et la commercialisation des coquillages sont interdits), notamment en baie de Canche  61., mais la situation tend à s’améliorer 61., mais la situation tend à s’améliorer  62. Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Canche, à l’instar du SDAGE, prend d’ailleurs en compte ces problèmes conchylicoles. 62. Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Canche, à l’instar du SDAGE, prend d’ailleurs en compte ces problèmes conchylicoles.
L’Ifremer opère régulièrement des contrôles sur le littoral dans le cadre des réseaux  63. REMI, REPHY et RNO. Les analyses montrent une bonne qualité microbiologique des coquillages et jusqu’à présent, il n’a pas été fait état dans la région de phénomène phytoplanctonique à caractère toxique 63. REMI, REPHY et RNO. Les analyses montrent une bonne qualité microbiologique des coquillages et jusqu’à présent, il n’a pas été fait état dans la région de phénomène phytoplanctonique à caractère toxique  64., cependant, on observe de façon épisodique et en quantité infinitésimale des cellules potentiellement toxiques. Certains métaux comme le cadmium, le plomb, le mercure et le zinc sont peu présents 64., cependant, on observe de façon épisodique et en quantité infinitésimale des cellules potentiellement toxiques. Certains métaux comme le cadmium, le plomb, le mercure et le zinc sont peu présents  65. En revanche, pour les HCH et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les médianes locales sont supérieures aux médianes nationales pour l’ensemble des points de mesures (sans pour autant dépasser les teneurs autorisées). 65. En revanche, pour les HCH et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les médianes locales sont supérieures aux médianes nationales pour l’ensemble des points de mesures (sans pour autant dépasser les teneurs autorisées).
| |
|
 Qualité des eaux de baignade Saison balnéaire 2003 Qualité des eaux de baignade Saison balnéaire 2003
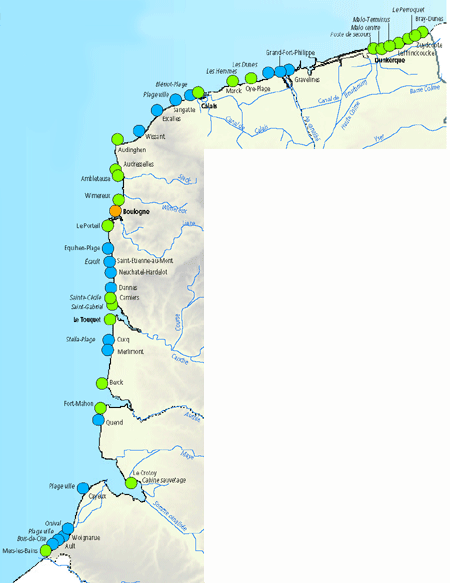
|
|
|
 Quelques blooms Quelques blooms  66. de phytoplancton 66. de phytoplancton |
|
Chaque année, la bande côtière du Nord - Pas-de-Calais  67. voit au printemps d’abondantes formations d’écume issues de la dégradation des colonies de phytoplancton marin du genre Phaeocystis. Les efflorescences printanières a Phaeocystis (plusieurs millions de cellules.l-1) entraînent un changement de coloration de l’eau et parfois une odeur nauséabonde. L’effet le plus visible de cette prolifération d’algue est la formation d’écume 67. voit au printemps d’abondantes formations d’écume issues de la dégradation des colonies de phytoplancton marin du genre Phaeocystis. Les efflorescences printanières a Phaeocystis (plusieurs millions de cellules.l-1) entraînent un changement de coloration de l’eau et parfois une odeur nauséabonde. L’effet le plus visible de cette prolifération d’algue est la formation d’écume  68. occasionnant une gêne pour les activités touristiques et la pêche. Il s’agit d’une manifestation connue depuis très longtemps. Dans l’état actuel des connaissances, notamment en l’absence de mesures fiables de l’ampleur du phénomène et du manque de recul 68. occasionnant une gêne pour les activités touristiques et la pêche. Il s’agit d’une manifestation connue depuis très longtemps. Dans l’état actuel des connaissances, notamment en l’absence de mesures fiables de l’ampleur du phénomène et du manque de recul  69., il est difficile d’en prévoir les évolutions. Le programme national d’environnement côtier (PNEC), en cours, permettra d’y voir plus clair et, éventuellement, d’établir un lien avec l’enrichissement en nutriments des eaux (essentiellement nitrate, phosphate et silicate 69., il est difficile d’en prévoir les évolutions. Le programme national d’environnement côtier (PNEC), en cours, permettra d’y voir plus clair et, éventuellement, d’établir un lien avec l’enrichissement en nutriments des eaux (essentiellement nitrate, phosphate et silicate  70.). Pour l’instant, il n’a pas été mis en évidence, dans la région, de phénomène d’anoxie (déficit en oxygène) lié aux blooms de Phaeocystis pouchetti. Les conditions physiques de la côte d’Opale (vent, marée, courants...) ne semblent pas favoriser l’eutrophisation 70.). Pour l’instant, il n’a pas été mis en évidence, dans la région, de phénomène d’anoxie (déficit en oxygène) lié aux blooms de Phaeocystis pouchetti. Les conditions physiques de la côte d’Opale (vent, marée, courants...) ne semblent pas favoriser l’eutrophisation  71. 71.
 La situation en mer du Nord La situation en mer du Nord |
|
Pourtant, même si le littoral du Nord - Pas-de-Calais n’est pas directement touché, le récent classement de l’ensemble de la région en zones " vulnérables aux nitrates " pour les eaux souterraines est en grande partie lié à la prolifération de certaines algues et au ris-que d’eutrophisation de la mer du Nord. Britanniques, Belges et Néerlandais sont également concernés. Ce classement prend en considération un jugement de la Cour de justice des communautés européennes  72. condamnant la France pour délimitation insuffisante des zones vulnérables, notamment au nord-ouest de la France. La cour a en effet estimé que cette zone participe à l’alimentation en nitrates de la mer du Nord qui connaît des problèmes d’eutrophisation. La France s’est engagée à réduire fortement les apports provenant des fleuves se jetant dans la Manche et dans la mer du Nord 72. condamnant la France pour délimitation insuffisante des zones vulnérables, notamment au nord-ouest de la France. La cour a en effet estimé que cette zone participe à l’alimentation en nitrates de la mer du Nord qui connaît des problèmes d’eutrophisation. La France s’est engagée à réduire fortement les apports provenant des fleuves se jetant dans la Manche et dans la mer du Nord  73. 73.
La mer du Nord reçoit plusieurs rivières, dont certaines transfrontalières qui y aboutissent après avoir traversé la France, la Belgique ou l’Allemagne. Selon l’Ifen  74., les apports directs en mer du Nord sont faibles en valeur absolue mais les concentrations sont élevées. Les apports s’élèveraient à 7 680 t/an d’azote (dont 5 600 d’azote nitrique) et 500 t/an de phosphore. Quant aux rivières transfrontalières, elles apporteraient de leur côté 39 700 t/an d’azote dont 73 % sous forme de nitrate et 2 400 t/an de phosphore. Le Rhin apporterait un flux d’azote nitrique 74., les apports directs en mer du Nord sont faibles en valeur absolue mais les concentrations sont élevées. Les apports s’élèveraient à 7 680 t/an d’azote (dont 5 600 d’azote nitrique) et 500 t/an de phosphore. Quant aux rivières transfrontalières, elles apporteraient de leur côté 39 700 t/an d’azote dont 73 % sous forme de nitrate et 2 400 t/an de phosphore. Le Rhin apporterait un flux d’azote nitrique  75. d’environ 12 000 t/an. Les flux de phosphore sont en revanche nettement inférieurs. Ils s’élèvent à 944 t/an, soit un ratio de 0,3 g/jour par habitant. Ce ratio très bas est imputé aux faibles apports domestiques, le phosphore étant désormais absent des détergents ménagers, et à la déphosphatation des effluents en Suisse et en Allemagne. 75. d’environ 12 000 t/an. Les flux de phosphore sont en revanche nettement inférieurs. Ils s’élèvent à 944 t/an, soit un ratio de 0,3 g/jour par habitant. Ce ratio très bas est imputé aux faibles apports domestiques, le phosphore étant désormais absent des détergents ménagers, et à la déphosphatation des effluents en Suisse et en Allemagne.
 Notes Notes
|
57 - Agence de l’Eau Artois-Picardie, 1999. " Le Touquet 10 ans... enfin ", Contre Courant, n° 28, Spécial qualité des plages, pp. 8-9.
58 - La protection sanitaire des zones de baignade et de conchyliculture peut justifier, en plus du traitement de la pollution carbonée et azotée, l’adjonction d’un dispositif de désinfection. Ce type de dispositif est d’autant plus efficace que l’élimination des matières organiques est élevée.
59 - Gisement naturel de moules.
60 - Dans une échelle qui comprend les classes A, B, C, D, la classe A correspond à une zone dans laquelle les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. L’élevage, la pêche professionnelle et la pêche de loisir peuvent être autorisés en zone de production, classée B, sous réserve de reparcage ou de purification. 39 - Ce retard était dû en partie à la nécessité de s’appuyer sur les préconisations du SDAGE du bassin Artois-Picardie dont la rédaction était en cours.
61 - Et à proximité des ports.
62 - Classe D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification. Toute activité de pêche ou d’élevage est interdite.
63 - Remi : réseau de contrôle microbiologique, Rephy : réseau de surveillance du phy-toplancton et des phycotoxines, RNO : réseau national d’observation de la qualité du milieu marin. Le rapport intitulé " Résultats de la surveillance de la qualité du milieu marin littoral " est téléchargeable sur le site de l’Ifremer : http://www.ifremer.fr
64 - DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning), PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) et ASP (Amnesic Shellfish Poisoning).
65 - Pour ces métaux, les médianes locales sont inférieures aux médianes nationales.
66 - Voir définition en fin de chapitre.
67 - Voir Ifremer, 2001. L’eutrophisation des eaux marines et saumâtres en Europe, en particulier en France. Issy-les-Moulineaux, p. 7.
68 - Il s’agit en fait de matériel mucilagineux qui, avec l’agitation de l’eau par les vagues, devient une émulsion.
69 - Les séries ne portent que sur dix à quinze ans.
70 - Les nutriments sont suivis grâce au " suivi régional des nutriments ". Il s’agit d’un contrat passé entre l’agence de l’Eau Artois-Picardie et l’Ifremer en 1992. Il a pour objectifs d’évaluer l’influence des apports continentaux sur le milieu marin et d’estimer l’impact de la mise en service de nouvelles stations d’épuration capables d’assurer la dénitrification.
71 - Le terme " eutrophe " signifie " bien nourri " ; cela suppose un milieu enrichi par rapport aux conditions naturelles hors apport anthropique. L’eutrophisation désigne un milieu eutrophe qui a atteint un niveau d’enrichissement tel que des dégradations ou des nuisances manifestes peuvent y être constatées. On parle aussi de milieu distrophe, c’est-à-dire présentant un déséquilibre entre les nutriments.
72 - 27 juin 2002.
73 - La convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR), qui remplace les précédentes conventions d’Oslo et de Paris, est entrée en vigueur en 1998. Celle-ci confirme l’objectif de réduire de 50 % les apports de nutriments et de substances dangereuses au milieu marin entre 1985 et 1995. Les parties contractantes s’y sont engagées en 1987. Mais, l’une des difficultés consiste à évaluer les apports en milieu marin.
74 - Ifen, 2002. " Flux à la mer : trop d’azote, mais moins de phosphore ", Les données de l’environnement, n° 72, 4 p.
75 - La seule à être évaluée.
|
|
|