|
 Les autres types de déchets Les autres types de déchets |
 Deux plans de gestion pour les déchets du BTP Deux plans de gestion pour les déchets du BTP |
|
Chaque année sont produites en France plus de 32 millions de tonnes de déchets de chantier du bâtiment  18 (2,6 millions de tonnes en Nord - Pas-de-Calais) et 100 millions de déchets des travaux publics 18 (2,6 millions de tonnes en Nord - Pas-de-Calais) et 100 millions de déchets des travaux publics  19. Les sept millions de tonnes de déchets des travaux publics de la région sont constituées à 86 % de déchets inertes dont 89 % pourraient être réemployés ou recyclés (on exclut les sols fins très humides et les boues). 19. Les sept millions de tonnes de déchets des travaux publics de la région sont constituées à 86 % de déchets inertes dont 89 % pourraient être réemployés ou recyclés (on exclut les sols fins très humides et les boues).
Afin d’atteindre les objectifs définis dans la circulaire du 15 février 2000  20, un plan régional de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics est en cours d’élaboration et un observatoire régional de la gestion des déchets de chantier du BTP sera prochainement mis en place. Pour favoriser le recyclage et le réemploi des déchets, trois orientations prioritaires ont été définies : 20, un plan régional de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics est en cours d’élaboration et un observatoire régional de la gestion des déchets de chantier du BTP sera prochainement mis en place. Pour favoriser le recyclage et le réemploi des déchets, trois orientations prioritaires ont été définies :
• obtenir des déchets plus homogènes, et donc plus faciles à utiliser, en améliorant le tri sur le chantier et dans les installations de regroupement ;
• promouvoir les produits recyclés et susciter l’expérimentation dans ce domaine ;
• préserver une concurrence loyale  21. 21.
Deux outils prolongent l’action des plans : une charte qualité, très volontariste, pour la gestion et la mise en œuvre des plans ainsi qu’un guide de recommandations pour la prise en compte des déchets du BTP dans les marchés publics destiné aux maîtres d’ouvrage.
| |
|
 L’estimation de la production de déchets du bâtiment et des travaux publics L’estimation de la production de déchets du bâtiment et des travaux publics
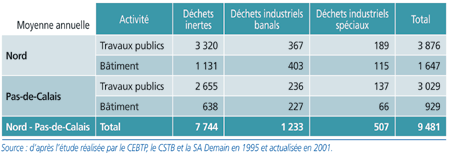
|
 Mobilisation en faveur de la collecte des DTQD Mobilisation en faveur de la collecte des DTQD |
|
Tout producteur de déchets est responsable de leur traitement, de leur conditionnement et de leur élimination  22. Les déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) représentent en Nord - Pas-de-Calais un gisement de plus de 20 000 tonnes 22. Les déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) représentent en Nord - Pas-de-Calais un gisement de plus de 20 000 tonnes  23. Or, leur élimination est mal maîtrisée, bien que leur toxicité puisse être importante. Du fait de la faiblesse des quantités individuelles générées, le producteur n’en a pas toujours conscience. Il les évacue parfois avec les déchets banals. L’organisation de la collecte et du traitement, secteur par secteur, sous la houlette d’un groupement professionnel, peut être une réponse à ce problème. Des actions de ce type ont été menées dans la région dans le domaine de l’imprimerie 23. Or, leur élimination est mal maîtrisée, bien que leur toxicité puisse être importante. Du fait de la faiblesse des quantités individuelles générées, le producteur n’en a pas toujours conscience. Il les évacue parfois avec les déchets banals. L’organisation de la collecte et du traitement, secteur par secteur, sous la houlette d’un groupement professionnel, peut être une réponse à ce problème. Des actions de ce type ont été menées dans la région dans le domaine de l’imprimerie  24, des entreprises de peinture en bâtiment et de l’ameublement. Ces secteurs ont su attirer des opérateurs pour éliminer leurs déchets. Désormais, pour eux, collecte, traitement et valorisation sont gérés collectivement. La problématique est assez comparable pour les déchets ménagers spéciaux (DMS) ou les déchets dangereux des ménages (DDM) qui sont également des déchets dispersés en très petite quantité. Le gisement est estimé à environ un kilogramme par an et par habitant, soit 4 000 à 5 000 tonnes pour la région. Quand il n’existe pas de dispositif de collecte organisée à l’échelle nationale (comme pour les huiles usagées et plus récemment les piles), ces déchets, lorsqu’ils sont sous forme liquide, sont alors directement rejetés dans le réseau d’évacuation d’eau pour se retrouver en bout de chaîne dans les boues de station d’épuration. L’agence de l’Eau Artois- Picardie a fait du traitement des DTQD, tout comme celui des DMS, un axe de travail de son huitième programme d’orientation. 24, des entreprises de peinture en bâtiment et de l’ameublement. Ces secteurs ont su attirer des opérateurs pour éliminer leurs déchets. Désormais, pour eux, collecte, traitement et valorisation sont gérés collectivement. La problématique est assez comparable pour les déchets ménagers spéciaux (DMS) ou les déchets dangereux des ménages (DDM) qui sont également des déchets dispersés en très petite quantité. Le gisement est estimé à environ un kilogramme par an et par habitant, soit 4 000 à 5 000 tonnes pour la région. Quand il n’existe pas de dispositif de collecte organisée à l’échelle nationale (comme pour les huiles usagées et plus récemment les piles), ces déchets, lorsqu’ils sont sous forme liquide, sont alors directement rejetés dans le réseau d’évacuation d’eau pour se retrouver en bout de chaîne dans les boues de station d’épuration. L’agence de l’Eau Artois- Picardie a fait du traitement des DTQD, tout comme celui des DMS, un axe de travail de son huitième programme d’orientation.
Les déchets ménagers spéciaux à l’état solide sont encore trop souvent éliminés avec les déchets résiduels des ménages pour être éliminés en décharge ou en usine d’incinération.
 Les déchets agricoles spéciaux : la collecte s’organise Les déchets agricoles spéciaux : la collecte s’organise |
|
La région a développé plusieurs filières de collecte et de valorisation des déchets agricoles. Un dispositif régional d’élimination des déchets agricoles est en cours d’élaboration  25. Un guide présentant toutes les filières d’élimination des déchets agricoles vient d’être réalisé. Sous l’impulsion d’une dynamique partenariale, le Nord - Pas-de-Calais a été une région pilote pour la collecte des emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP). Aujourd’hui, sous la coordination du groupement professionnel Adivalor, les emballages vides sont collectés après avoir été lavés par l’agriculteur. Cette opération a débuté en 2001. La collecte des produits phytosanitaires non utilisés (PPNU) se met également en place. Le gisement régional 25. Un guide présentant toutes les filières d’élimination des déchets agricoles vient d’être réalisé. Sous l’impulsion d’une dynamique partenariale, le Nord - Pas-de-Calais a été une région pilote pour la collecte des emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP). Aujourd’hui, sous la coordination du groupement professionnel Adivalor, les emballages vides sont collectés après avoir été lavés par l’agriculteur. Cette opération a débuté en 2001. La collecte des produits phytosanitaires non utilisés (PPNU) se met également en place. Le gisement régional  26 est difficile à estimer. Deux projets pilotes de collecte de bâches d’ensilage, de film d’enrubannage et de maraîchage sont en cours sur des territoires tests. Il s’agit d’évaluer le gisement. L’absence d’organisation nationale pour les films plastiques, à l’image de la récente structure Adivalor pour les produits phytosanitaires, est un obstacle majeur à la pérennité des collectes. Les volumes collectés sont insuffisants pour optimiser la filière. Pour les pneus, un organisme professionnel, Aliapur, se met en place. Mais, la collecte auprès des garagistes, des centres auto et des particuliers sera sans doute prioritaire avant d’éliminer les stocks chez les agriculteurs. Ces derniers, qui utilisaient les pneus usagés pour maintenir les bâches d’ensilage, servaient souvent d’exutoires aux garagistes. 26 est difficile à estimer. Deux projets pilotes de collecte de bâches d’ensilage, de film d’enrubannage et de maraîchage sont en cours sur des territoires tests. Il s’agit d’évaluer le gisement. L’absence d’organisation nationale pour les films plastiques, à l’image de la récente structure Adivalor pour les produits phytosanitaires, est un obstacle majeur à la pérennité des collectes. Les volumes collectés sont insuffisants pour optimiser la filière. Pour les pneus, un organisme professionnel, Aliapur, se met en place. Mais, la collecte auprès des garagistes, des centres auto et des particuliers sera sans doute prioritaire avant d’éliminer les stocks chez les agriculteurs. Ces derniers, qui utilisaient les pneus usagés pour maintenir les bâches d’ensilage, servaient souvent d’exutoires aux garagistes.
 Une région attractive pour le traitement des déchets des activités de soins Une région attractive pour le traitement des déchets des activités de soins |
|
En 2001, la production de déchets contaminés des activités de soins a été estimée à environ 10 000 tonnes par an. Une enquête l’avait auparavant évaluée entre 9 000 tonnes et 16 000 tonnes par an. S’il est difficile de déterminer la hausse ou la diminution des quantités produites, on constate par contre une amélioration de la qualité des productions grâce au développement du tri des déchets. Des entreprises susceptibles de transformer des déchets à risques en déchets banals sont présentes dans la région. Trois d’entre elles sont capables de banaliser d’importantes quantités de déchets. Un des établissements de soins de la région, équipé d’un appareil de décontamination, traite notamment sa propre production. L’incinérateur de Doulchy-les-Mines est autorisé à traiter la partie non banalisée de la production régionale de déchets, ainsi que celle produite par d’autres régions. Enfin, l’incinérateur de Noyelles-sous-Lens incinère les déchets de l’agglomération, mais une demande vient d’être déposée pour qu’il puisse élargir son périmètre de collecte.
La région est attractive pour le traitement des déchets contaminés des activités de soins. Si la collecte et la traçabilité des déchets sont effectuées de manière correcte pour les établissements, elles sont, en revanche, assurées de façon moins satisfaisante pour le réseau diffus des professionnels de santé. L’Observatoire des déchets d’activités de soins s’attache actuellement à résoudre ce problème.
 Les déchets nucléaires Les déchets nucléaires |
Le producteur de déchets nucléaires est lui aussi responsable de leur traitement, conditionnement et élimination. Pour assurer correctement cette responsabilité, il doit s’efforcer d’en réduire les volumes et les toxicités, réaliser le tri et s’assurer de la traçabilité de leur élimination. Par ailleurs, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et, localement, la Drire du Nord - Pas-de-Calais exercent un contrôle externe. Deux paramètres permettent d’appréhender le risque : l’activité, qui traduit le danger du déchet et sa durée de vie, c’est-à-dire la période au bout de laquelle la radiotoxicité est divisée par deux. On distingue les déchets de courte période (moins de trente ans) de ceux de longue période (plus de trente ans).
 Les déchets liés aux activités anciennes et actuelles Les déchets liés aux activités anciennes et actuelles |
|
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) dénombre, en région Nord - Pas-de- Calais, trente-neuf producteurs ou détenteurs de déchets radioactifs répartis sur trente-six sites géographiques. On trouve les sites habituels liés au domaine médical et à la recherche et, bien évidemment, la centrale nucléaire de Gravelines. Deux sites stockent les déchets liés à des activités anciennes. C’est le cas à Loos-Lez-Lille où l’exploitation, de 1934 à 1964, d’un atelier de traitement de minerai  27 a généré des résidus de très faible activité qui, après avoir été mélangés à d’autres déchets industriels minéraux, ont été stockés sur le site. 140 000 m3 de boues de filtration, contenant du thorium et de l’uranium, ont été mises en lagunes. Leur activité est estimée à 0,2 TBq. C’est aussi le cas de l’ancienne décharge de Menneville, fermée en 1994. Elle renferme 7 200 tonnes de déchets enfouis 27 a généré des résidus de très faible activité qui, après avoir été mélangés à d’autres déchets industriels minéraux, ont été stockés sur le site. 140 000 m3 de boues de filtration, contenant du thorium et de l’uranium, ont été mises en lagunes. Leur activité est estimée à 0,2 TBq. C’est aussi le cas de l’ancienne décharge de Menneville, fermée en 1994. Elle renferme 7 200 tonnes de déchets enfouis  28 sous plusieurs mètres de terre présentant une activité de 2,2 TBq. Enfin, à Maubeuge, une entreprise de maintenance de matériel nucléaire génère des déchets technologiques évacués régulièrement vers l’usine d’incinération et de fusion de Marcoule. 28 sous plusieurs mètres de terre présentant une activité de 2,2 TBq. Enfin, à Maubeuge, une entreprise de maintenance de matériel nucléaire génère des déchets technologiques évacués régulièrement vers l’usine d’incinération et de fusion de Marcoule.
 50 m3 par an de déchets hautement et moyennement actifs à vie longue 50 m3 par an de déchets hautement et moyennement actifs à vie longue |
|
La centrale nucléaire de Gravelines, qui comporte six réacteurs en service, génère des quantités de déchets hautement et moyennement actifs à vie longue, en rapport avec la taille du site. L’essentiel de ces déchets n’est pas produit sur le site de la centrale mais résulte du retraitement à La Hague du combustible usé. 140 tonnes de combustibles ont été retraitées en 2001, 160 t en 2000 et 100 t en 1999. L’activité totale de ces déchets est estimée à 0,29 EBq  29. Le combustible retraité en 2001 a généré 50 m3 de déchets composés de produits de fission de haute activité. Ces déchets se trouvent d’abord sous forme liquide puis concentrés, vitrifiés et enfin stockés dans des conteneurs spécifiques à La Hague. Les équipements du cœur de réacteur sont entreposés dans des piscines prévues à cet effet. 29. Le combustible retraité en 2001 a généré 50 m3 de déchets composés de produits de fission de haute activité. Ces déchets se trouvent d’abord sous forme liquide puis concentrés, vitrifiés et enfin stockés dans des conteneurs spécifiques à La Hague. Les équipements du cœur de réacteur sont entreposés dans des piscines prévues à cet effet.
 Une production variable de déchets faiblement et moyennement actifs à vie courte Une production variable de déchets faiblement et moyennement actifs à vie courte |
|
Après avoir été conditionnés, les déchets faiblement et moyennement actifs à vie courte de la centrale de Gravelines sont expédiés au centre de stockage de l’Aube pour un stockage en surface. Leur activité est estimée à 20 GBq. Même si, depuis 1989, leur quantité tend globalement à diminuer, les variations annuelles peuvent être d’assez grande ampleur. Ainsi, la centrale nucléaire de Gravelines a fourni 76 m3 de déchets par tranche en 1998, 127 m3 en 1999 et 79 m3 en 2000. Finalement, la production de déchets est repartie à la hausse en 2001 après une année 2000 particulièrement forte. Cette variabilité est liée au nombre d’arrêts et aux travaux effectués. Le plan d’action sur la propreté radiologique mené en 2001, tout comme la campagne de conditionnement et d’évacuation des déchets spécifiques en 1999, est à l’origine de la forte production de déchets ces années-là. Au fil du temps, neuf générateurs de vapeur usés ont été remplacés. Ils sont actuellement entreposés, certains depuis 1994, dans trois bâtiments spécifiques à l’intérieur même du site. Ils seront ainsi stockés durant une période permettant la décroissance de leur activité, jusqu’à un seuil acceptable pour l’opération de démantèlement.
 Un transport très encadré Un transport très encadré |
|
L’Autorité de sûreté nucléaire contrôle le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil. L’expéditeur est responsable de la sûreté du colis. Des contrôles sont effectués à l’arrivée et au départ des colis. Tous les moyens de transports peuvent être utilisés : route, train, air, mer, navigation fluviale. La région Nord - Pas-de-Calais est soumise à plusieurs flux. Comme pour le reste de la France, de nombreux petits colis de radio-isotopes à usage médical, pharmaceutique ou industriel transitent dans la région. Ils représentent pour la France les deux tiers des flux, soit 300 000 colis par an. Un autre flux résulte du transport des matières radioactives issues de la centrale électronucléaire de Gravelines : combustible, matériel d’entretien, etc. Enfin, il existe également un flux lié au transport international. Le Nord - Pas-de-Calais étant une région de transit, les colis de combustibles irradiés à destination de Sellafield en Grande-Bretagne, provenant de Suisse ou d’Allemagne, sont embarqués dans le port de Dunkerque.
 Notes Notes
|
18 - Plus de 70 % des déchets du bâtiment proviennent dans la région des activités de démolition, 20 % de la réhabilitation. La construction neuve ne génère que 5 % des déchets.
19 - Données issues de la circulaire du 15 février 2000.
20 - La circulaire a pour objectifs : la lutte contre les décharges sauvages, la mise en place d’un réseau de traitement, la réduction des déchets à la source, la réduction de la mise en décharge, le recyclage, la valorisation des déchets du BTP et l’implication des maîtres d’ouvrages publics et privés.
21 - Il s’agit de traduire ces orientations dans les marchés publics et privés en privilégiant à performance égale les matériaux recyclés, en intégrant le coût de la gestion des déchets (notamment du tri) et, enfin, en homogénéisant les conditions d’accès des artisans aux déchèteries.
22 - Selon les articles 5 et 8 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée en juillet 1992.
23 - L’estimation réalisée par l’agence de l’Eau est de 26 000 tonnes pour le bassin Artois- Picardie. Le Nord - Pas-de-Calais concentre 80 % du gisement de DTQD.
24 - Opération « Disiti ».
25 - Guide rédigé par la Chambre régionale d’Agriculture avec l’appui du Conseil scientifique de l’environnement et en partenariat avec le conseil régional, l’Ademe et l’agence de l’Eau Artois-Picardie.
26 - Les premières collectes devraient permettre de collecter une dizaine de tonnes environ.
27 - Les activités industrielles ont commencé en 1826.
28 - Déchets enfouis entre 1985 et 1986.
29 - 1 EBq (Exabecquerel) = 1018 becquerels.
|
|
|