|
 Les caractéristiques des sols Les caractéristiques des sols |
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les richesses faunistiques et floristiques, etc.
 Les grands types de sols Les grands types de sols |
|
La plaine maritime des Wateringues  2 et les Bas Champs Picards se caractérisent par la présence de sols formés sur des dépôts de sédiments marins récents. Ces formations sont souvent sableuses mais aussi limoneuses, argileuses, tourbeuses ou calcaires (tuf). Ces sols peuvent être hydromorphes dans les parties basses des plaines littorales. La plaine maritime des Wateringues a une altitude moyenne d’un mètre, celle des Bas Champs Picards d’environ quatre mètres. La nappe d’eau, proche de la surface, doit alors être maintenue en profondeur par un système de wateringues 2 et les Bas Champs Picards se caractérisent par la présence de sols formés sur des dépôts de sédiments marins récents. Ces formations sont souvent sableuses mais aussi limoneuses, argileuses, tourbeuses ou calcaires (tuf). Ces sols peuvent être hydromorphes dans les parties basses des plaines littorales. La plaine maritime des Wateringues a une altitude moyenne d’un mètre, celle des Bas Champs Picards d’environ quatre mètres. La nappe d’eau, proche de la surface, doit alors être maintenue en profondeur par un système de wateringues  3. Mis à part les plaines maritimes, les sols se sont formés sur une couverture limoneuse pléistocène continue ne laissant apparaître que de rares affleurements de matériaux ante quaternaires. Le développement des sols est influencé fortement par l’épaisseur de la couverture, sa nature plus ou moins argileuse, limoneuse ou sableuse et son drainage. Les basses plaines (plaine de la Lys, plaine de la Scarpe) sont fréquemment recouvertes de matériaux complexes (sables, limons sableux, limons, argiles, tourbes) généralement hydromorphes. Les affleurements crayeux du haut Boulonnais et de l’Artois se caractérisent souvent par des sols calcaires ayant une forte stabilité structurale et se ressuyant rapidement. Dans l’Artois (Cambrésis, pays de Montreuil, haut Artois, Ternois), la nature des sols varie suivant la position topographique : limons décalcifiés sur les plateaux et formations caillouteuses d’argile à silex sur les pentes. Ils ont une stabilité structurale limitée et sont particulièrement sensibles à la battance [voir définition en fin de chapitre]. D’autres petites régions (Boulonnais, Flandre intérieure, Thiérache, région de Lille pour partie) présentent sous le recouvrement limoneux un substrat plus ou moins argileux avec un risque d’engorgement des sols s’ajoutant au risque de battance superficielle. 3. Mis à part les plaines maritimes, les sols se sont formés sur une couverture limoneuse pléistocène continue ne laissant apparaître que de rares affleurements de matériaux ante quaternaires. Le développement des sols est influencé fortement par l’épaisseur de la couverture, sa nature plus ou moins argileuse, limoneuse ou sableuse et son drainage. Les basses plaines (plaine de la Lys, plaine de la Scarpe) sont fréquemment recouvertes de matériaux complexes (sables, limons sableux, limons, argiles, tourbes) généralement hydromorphes. Les affleurements crayeux du haut Boulonnais et de l’Artois se caractérisent souvent par des sols calcaires ayant une forte stabilité structurale et se ressuyant rapidement. Dans l’Artois (Cambrésis, pays de Montreuil, haut Artois, Ternois), la nature des sols varie suivant la position topographique : limons décalcifiés sur les plateaux et formations caillouteuses d’argile à silex sur les pentes. Ils ont une stabilité structurale limitée et sont particulièrement sensibles à la battance [voir définition en fin de chapitre]. D’autres petites régions (Boulonnais, Flandre intérieure, Thiérache, région de Lille pour partie) présentent sous le recouvrement limoneux un substrat plus ou moins argileux avec un risque d’engorgement des sols s’ajoutant au risque de battance superficielle.
| |
|
 Le schéma pédologique Le schéma pédologique
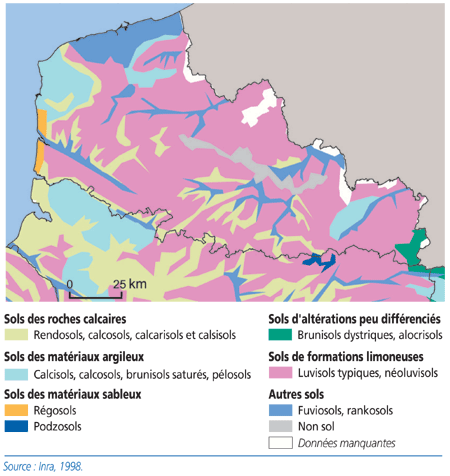
|
| |
|
 Le stock des sols en matière organique Le stock des sols en matière organique
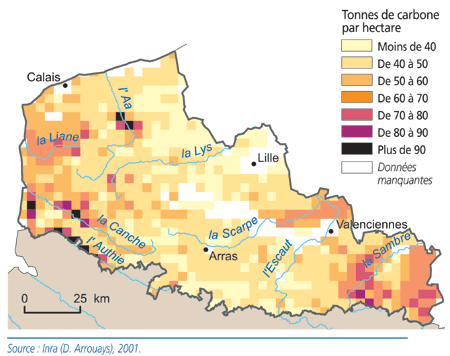
|
 Moins de matière organique dans les zones de cultures intensives Moins de matière organique dans les zones de cultures intensives |
|
Les stocks de carbone organique des sols de la région Nord - Pas-de-Calais sont évalués en moyenne à 48,5 tonnes/ha. Ils présentent une forte variabilité qui est principalement liée à l’occupation du sol et aux pratiques agricoles. Les stocks les plus faibles sont essentiellement localisés dans les zones de cultures intensives sur des sols limoneux instables (Flandre intérieure, plaine de la Lys, sud de l’Artois). Ils sont inférieurs à la moyenne nationale des stocks observés sous culture (qui est de 43 t/ha). Ceci est probablement dû aux effets conjugués de l’existence de cultures très intensives à faibles restitutions organiques (légumes, pomme de terre) et à une faible stabilisation de la matière organique dans ces sols peu argileux. Des stocks plus importants sont observés dans les zones où persistent des prairies permanentes et de l’élevage bovin (Boulonnais, Thiérache). Les stocks les plus élevés correspondent aux zones où les forêts sont prédominantes (par exemple dans quelques secteurs des Champs Picards, de la plaine de la Scarpe, du Hainaut et de la Thiérache) et dans les zones les plus froides et les plus humides (forêts et landes tourbeuses du plateau Ardennais).
 L’érosion L’érosion |
Le sol est une ressource naturelle non renouvelable à l’échelle de temps historique. L’une des causes majeures de sa dégradation est l’érosion dont la prise en compte est essentielle car elle revêt un caractère d’irréversibilité. L’érosion provoque des dégâts aux terres agricoles mais a aussi des conséquences au-delà du sol lui-même : elle entraîne une dégradation de la qualité des eaux et le déplacement de sédiments qu’il faut ensuite gérer. Elle est aussi souvent à l’origine de coulées de boues qui peuvent entraîner des dégâts importants faisant l’objet de demandes d’indemnisation des particuliers ou des collectivités, au titre des catastrophes naturelles. L’érosion a d’importantes conséquences humaines, matérielles et environnementales : coulées de boues (pouvant présenter des risques pour la population), pertes de terres (avec notamment la disparition des horizons fertiles), turbidité  4 et pollution des cours d’eau, difficultés culturales, colmatage des réseaux d’assainissements, etc. 4 et pollution des cours d’eau, difficultés culturales, colmatage des réseaux d’assainissements, etc.
 Une région fortement touchée par l’érosion Une région fortement touchée par l’érosion |
|
La région est en grande partie couverte de sols limoneux de grande valeur agronomique ayant une bonne capacité de rétention en eau et en éléments chimiques. Ces sols sont très propices à l’érosion en raison de leur battance, notamment quand ils ne sont pas protégés par un couvert végétal suffisant en automne, en hiver et lors des semis de printemps au moment où les précipitations sont importantes. En effet, sur les terrains nus ou peu couverts, imperméabilisés par une croûte de battance, une pluie faible déclenche un ruissellement, y compris sur des pentes faibles (inférieures à 1 %). Enfin, la diminution du taux de matière organique et du calcium, ainsi que le travail excessif du sol peuvent aussi accentuer l’érosion en raison de l’instabilité accrue de l’horizon supérieur du sol.
La région Nord - Pas-de-Calais fait partie des régions de France les plus concernées par l’aléa érosion en toutes saisons. L’érosion est une menace parce que les sols sont laissés nus pendant une longue période et que les précipitations sont importantes. Le ravinement est plus fort là où les pentes sont plus prononcées comme dans les collines de l’Artois, le pays de Montreuil (vallées de la Canche et de l’Authie). Dans le Nord, autour de Lille, les sols sont peu sensibles à l’érosion (seules quelques coulées boueuses ont été déclarées) mais, comme la zone est urbanisée, les conséquences peuvent être importantes. À l’est de la région, le bocage a protégé jusqu’ici les sols de la Thiérache. Néanmoins, en raison de la sensibilité potentielle de ces sols à la battance dans un relief ondulé, le risque d’érosion ne serait pas nul dans les secteurs où le bocage et les aménagements hydrauliques seraient supprimés. Les observations sont identiques dans le Boulonnais et, dans une moindre mesure, dans la Flandre intérieure.
L’érosion et les coulées boueuses entraînent la destruction de sols agricoles pouvant avoir une grande valeur agronomique. Le Nord - Pas-de-Calais est parmi les régions françaises comptabilisant le plus grand nombre de coulées boueuses (plus de cinq coulées par 100 km2). De 1985 à 2000, près de 46 % des communes de la région ont été touchés par les coulées boueuses (soit environ 6 % des communes françaises concernées). Ce constat doit être cependant nuancé dans la mesure où la densité de l’habitat est importante et où le nombre de sinistres enregistrés est lié à cette densité.
| |
|
 L’aléa d’érosion des sols L’aléa d’érosion des sols
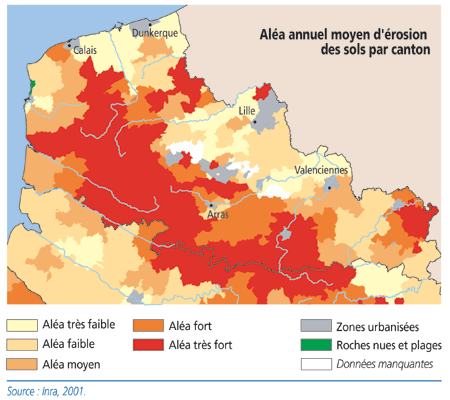
|
| |
|
 Les coulées boueuses Les coulées boueuses
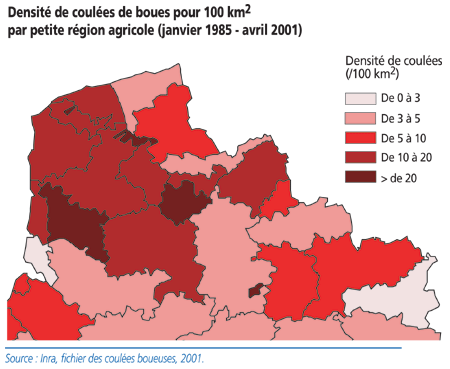
|
 L’érosion affecte la qualité de l’eau de certains cours d’eau L’érosion affecte la qualité de l’eau de certains cours d’eau |
|
L’érosion peut affecter la qualité de l’eau de certaines rivières à cause des matières en suspension qu’elle entraîne. C’est notamment le cas des bassins versants du Bléquin, de l’Aa, de la Liane, du Wimereux, de l’Authie aval et de la Scarpe amont. Le ruissellement n’entraîne pas que des particules solides, mais aussi des pesticides. C’est pourquoi les cours d’eau des bassins versants touchés par l’érosion présentent fréquemment des problèmes de pollution par les pesticides et les nitrates comme dans le cas de l’Yser, d’Airon Saint-Vaast et de l’Escrebieux.
L’érosion des sols dans le bassin de la Canche a fait l’objet de nombreuses mesures. Les pertes annuelles moyennes de terre mesurées sur le site expérimental de Tubersent près d’Étaples s’élèvent en moyenne à 10 tonnes par hectare et par an. En situation orageuse, elles peuvent se chiffrer localement en centaines de tonnes par hectare. En décembre 1999, une station de mesure de l’agence de l’Eau installée à Attin a enregistré des quantités records de matières en suspension : 34 000 tonnes, soit l’équivalent de 10 hectares de terres arables, ont transité en trois jours. Un inventaire réalisé par l’Institut géographique national (IGN) en 1995 dans le pays de Montreuil a comptabilisé 350 kilomètres de traces d’érosion, soit environ 100 000 tonnes de terres emportées vers la Canche.
 L’épandage L’épandage |
La capacité épuratoire des sols est de plus en plus sollicitée en Nord - Pas-de-Calais où le volume des effluents épandus ne cesse de croître d’année en année [voir le chapitre Agriculture]. Plusieurs causes sont à l’origine de cette augmentation : extension du parc de stations d’épuration urbaines, montée en puissance du compostage, développement de certaines activités industrielles (comme l’agroalimentaire) et d’élevage (volaille notamment) mais, aussi, amélioration de la qualité des boues. En effet, la réglementation impose désormais aux exploitants un certain nombre d’analyses annuelles des boues en ce qui concerne la valeur agronomique (VA), les éléments traces métalliques (ETM), les composés traces organiques (CTO) et les germes pathogènes. Faire appel aux capacités d’épuration du sol est aujourd’hui la solution la moins coûteuse. Mais si les boues ont des qualités fertilisantes (azote, phosphore), elles n’en demeurent pas moins des déchets sur le plan juridique. Leur épandage implique donc des précautions afin de garantir leur innocuité vis-à-vis des sols et de la chaîne alimentaire.
 Des facteurs limitants Des facteurs limitants |
|
Une étude effectuée, en 2000, par l’Institut supérieur d’agriculture (ISA) de Lille sur l’aptitude des sols français à l’épandage révèle une grande hétérogénéité entre les régions. Ces travaux, basés sur l’utilisation de la base de données d’analyses des terres (BDAT), montre que les sols du Nord - Pas-de-Calais sont globalement aptes à l’épandage des boues. Cependant, il existe plusieurs facteurs limitants tels que l’engorgement temporaire des sols dans les zones à substrat imperméable et les basses plaines ou encore l’existence de sols filtrants peu épais dans les zones d’affleurement crayeux. La densité de l’urbanisation ainsi que celle du réseau hydraulique constituent également des obstacles. La réserve de sols aptes à l’épandage est donc limitée. Cette situation devrait constituer un frein aux transferts provenant d’autres régions et de la Belgique voisine.
 Surveiller les concentrations d’éléments traces métalliques Surveiller les concentrations d’éléments traces métalliques |
|
L’épandage des boues suscite des questions sur le comportement à long terme des éléments traces métalliques qui sont toujours présents dans les boues (même si les quantités diminuent) et qui comportent des risques éventuels pour la qualité des eaux, la faune et la flore. Les bilans annuels des deux Services d’assistance technique à la gestion des épandages  5 (Satege) montrent que, dans la région, les teneurs en éléments traces métalliques restent assez faibles au regard des limites fixées par la réglementation. Dans les boues urbaines, les teneurs stagnent pour certains éléments et tendent à régresser pour d’autres, notamment pour le plomb, le mercure 5 (Satege) montrent que, dans la région, les teneurs en éléments traces métalliques restent assez faibles au regard des limites fixées par la réglementation. Dans les boues urbaines, les teneurs stagnent pour certains éléments et tendent à régresser pour d’autres, notamment pour le plomb, le mercure  6 et le cadmium. Selon les éléments, ces teneurs variaient en 2001 entre 5 % et 35 % des valeurs limites réglementaires. Quant aux effluents industriels, leurs teneurs en ETM sont globalement faibles quelle que soit la branche industrielle. Elles oscillent dans le Pas-de-Calais, en 2001, entre 2 % et 15 % de la valeur limite réglementaire. Néanmoins, des phénomènes cumulatifs pouvant se produire, il est essentiel de suivre l’évolution des teneurs en ETM du sol sur les parcelles soumises aux épandages. Pour mesurer ces évolutions, il est prévu de comparer les analyses du sol à l’état initial à celles qui seront réalisées dans dix ans, c’est-à-dire lorsque la parcelle sera définitivement retirée du plan d’épandage 6 et le cadmium. Selon les éléments, ces teneurs variaient en 2001 entre 5 % et 35 % des valeurs limites réglementaires. Quant aux effluents industriels, leurs teneurs en ETM sont globalement faibles quelle que soit la branche industrielle. Elles oscillent dans le Pas-de-Calais, en 2001, entre 2 % et 15 % de la valeur limite réglementaire. Néanmoins, des phénomènes cumulatifs pouvant se produire, il est essentiel de suivre l’évolution des teneurs en ETM du sol sur les parcelles soumises aux épandages. Pour mesurer ces évolutions, il est prévu de comparer les analyses du sol à l’état initial à celles qui seront réalisées dans dix ans, c’est-à-dire lorsque la parcelle sera définitivement retirée du plan d’épandage  7. 7.
Les effluents n’ont pas tous le même potentiel de fertilisation ni les mêmes conséquences sur la stabilité du sol. Certains des effluents liquides des industries agroalimentaires et pâteux de l’industrie papetière ont de fortes teneurs en azote et en phosphore. Les effluents solides de l’industrie papetière  8 ont des caractéristiques agronomiques intéressantes. Riches en carbone et carencés en azote 8 ont des caractéristiques agronomiques intéressantes. Riches en carbone et carencés en azote  9, ils peuvent apporter de la matière organique à des cultures exigeantes (légumes, cultures industrielles) ainsi qu’aux sols battants de la région, particulièrement sensibles à l’érosion. Des essais in situ 9, ils peuvent apporter de la matière organique à des cultures exigeantes (légumes, cultures industrielles) ainsi qu’aux sols battants de la région, particulièrement sensibles à l’érosion. Des essais in situ  10 sont conduits actuellement par le Satege du Pas-de-Calais afin d’évaluer les impacts environnementaux de ces épandages, notamment en ce qui concerne les quantités d’azote lessivées 10 sont conduits actuellement par le Satege du Pas-de-Calais afin d’évaluer les impacts environnementaux de ces épandages, notamment en ce qui concerne les quantités d’azote lessivées  11. 11.
| |
|
 L’indice d’aptitude des sols à l’épandage des boues (IAE) L’indice d’aptitude des sols à l’épandage des boues (IAE)
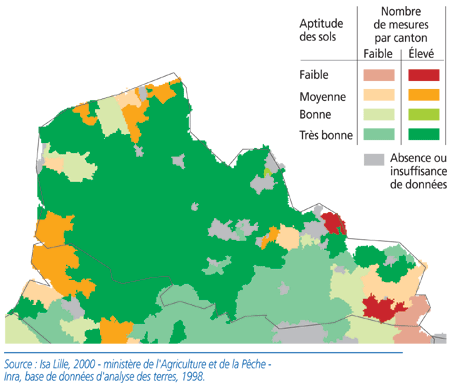
|
 Notes Notes
|
2 - Un ancien golfe comblé par les dépôts marins récents.
3 - Canal servant à la lutte contre les intrusions salées.
4 - État d’un liquide trouble.
5 - Le Service d’assistance technique à la gestion des épandages (Satege) est un service de la chambre d’Agriculture du Nord et de celle du Pas-de-Calais, créé en 1999, en partenariat avec l’agence de l’Eau Artois-Picardie.
6 - Cette baisse résulte de l’amélioration des traitements et de la suppression de certains produits en amont : essence sans plomb, amélioration du traitement des déchets médicaux pour le mercure, mise en place de séparateur d’amalgame dentaire, etc.
7 - Dans le bassin Artois-Picardie, le Satege de la Somme mène une étude sur l’impact des épandages sur la qualité des sols et des récoltes. À l’issue des deux premières années d’expérimentation, il n’a pas pu être démontré de différence significative entre les parcelles qui ont reçu des boues et les parcelles témoins, aussi bien pour la qualité des sols que celle des cultures.
8 - Les colorants utilisés sont le plus souvent des colorants alimentaires.
9 - Ces boues essentiellement composées de lignine et de cellulose ont un rapport carbone/azote (C/N) supérieur à 25.
10 - Le Satege du Pas-de-Calais conduit des essais sur une parcelle de l’Artois avec trois effluents papetiers représentatifs de l’ensemble des boues papetières épandues dans la région.
11 - Cette expérimentation a pour but de démontrer que l’épandage des effluents de papeterie en zone vulnérable sans culture intermédiaire est possible.
|
|
|