|
 Une volonté de maîtrise de l’énergie et des émissions de CO2 Une volonté de maîtrise de l’énergie et des émissions de CO2 |
 Une volonté politique déjà ancienne Une volonté politique déjà ancienne |
|
Tout en diversifiant son offre énergétique, la région s’est attaquée très tôt à la maîtrise de l’énergie et s’est tenue à cette orientation durant la période peu propice des années quatre-vingt-dix où l’énergie était « bon marché ». Les deux grands axes de la politique régionale de maîtrise de l’énergie s’inscrivent aujourd’hui dans la mise en œuvre concrète d’un développement durable de la région. Il s’agit, d’une part, de renforcer les économies d’énergie et de réduire la demande en contribuant à une meilleure efficacité énergétique ; d’autre part, de satisfaire la demande en valorisant les ressources énergétiques locales, renouvelables ou non, même si leur part dans le bilan énergétique régional reste marginal.
Par ailleurs, l’environnement est perçu au travers de cette politique énergétique comme un facteur de développement économique de la région, l’émergence de nouvelles filières énergétiques renouvelables ou la structuration d’une filière d’habitations « haute qualité environnementale » (HQE) pouvant avoir des retombées économiques.
C’est ainsi que le conseil régional et l’Ademe se sont fixé un double objectif dans le cadre du contrat de plan État-Région 2000-2006 : maintenir en 2006 la consommation finale d’énergie  23 à 14,2 Mtep (contre 14,4 Mtep en 2001) et les émissions de CO2 à 35 millions de tonnes (contre 35,4 millions de tonnes en 2001). 23 à 14,2 Mtep (contre 14,4 Mtep en 2001) et les émissions de CO2 à 35 millions de tonnes (contre 35,4 millions de tonnes en 2001).
 Les outils et mécanismes de soutien aux projets Les outils et mécanismes de soutien aux projets |
|
Pour mettre en œuvre sa politique de maîtrise de l’énergie, la région s’est appuyé sur l’Agence régionale de l’énergie  24, et sur des outils comme le programme régional pour l’air, la maîtrise de l’énergie et les déchets (Pramed) 24, et sur des outils comme le programme régional pour l’air, la maîtrise de l’énergie et les déchets (Pramed)  25, l’Observatoire des consommations d’énergie par type de secteur en fonction des usages (Norener) 25, l’Observatoire des consommations d’énergie par type de secteur en fonction des usages (Norener)  26, ainsi que l’Observatoire de la production décentralisée d’énergie recensant l’ensemble des sites producteurs d’énergie renouvelable 26, ainsi que l’Observatoire de la production décentralisée d’énergie recensant l’ensemble des sites producteurs d’énergie renouvelable  27. La mise en réseau des acteurs, indispensable au travail sur le terrain, a été renforcée côté entreprises par la mise en place de chargés de mission environnement au sein des treize Chambres de Commerce et d’Industrie de la région, en relation avec les actions menées par l’Ademe. 27. La mise en réseau des acteurs, indispensable au travail sur le terrain, a été renforcée côté entreprises par la mise en place de chargés de mission environnement au sein des treize Chambres de Commerce et d’Industrie de la région, en relation avec les actions menées par l’Ademe.
Les actions menées par des entreprises ou des collectivités peuvent profiter des soutiens financiers du conseil régional et de l’Ademe, notamment du fonds régional d’aide à la maîtrise de l’énergie et de l’environnement (Framee) prévu par le contrat de plan État-Région et du soutien des fonds européens de développement régional (Feder) dans le cadre du programme Objectif 2.
Entre 2000 et 2002, les 780 projets, qui ont bénéficié au total de 27 millions d’euros d’aide du Framee, ont ainsi permis d’économiser 41 000 tep et d’éviter l’émission de 135 000 tonnes de CO2  28. Près de la moitié des 19 millions d’euros de subventions du Framee, apportées par le conseil régional et l’Ademe en 2002, ont concerné des projets liés à l’énergie (20 %), aux transports et à la qualité de l’air (20 %) et aux potentiels énergétiques locaux (2 %). Les collectivités peuvent également bénéficier du contrat Atenee (actions territoriales pour l’environnement et l’efficacité énergétique) qui leur est plus spécifiquement dédié. Il s’agit d’un contrat pluriannuel, proposé et soutenu financièrement par l’Ademe, destiné à tout territoire volontaire (pays, agglomération, parc naturel régional) pour améliorer sa situation vis-à-vis de l’énergie. 28. Près de la moitié des 19 millions d’euros de subventions du Framee, apportées par le conseil régional et l’Ademe en 2002, ont concerné des projets liés à l’énergie (20 %), aux transports et à la qualité de l’air (20 %) et aux potentiels énergétiques locaux (2 %). Les collectivités peuvent également bénéficier du contrat Atenee (actions territoriales pour l’environnement et l’efficacité énergétique) qui leur est plus spécifiquement dédié. Il s’agit d’un contrat pluriannuel, proposé et soutenu financièrement par l’Ademe, destiné à tout territoire volontaire (pays, agglomération, parc naturel régional) pour améliorer sa situation vis-à-vis de l’énergie.
 L’utilisation rationnelle de l’énergie : le gisement d’économie le plus important L’utilisation rationnelle de l’énergie : le gisement d’économie le plus important |
|
La politique régionale d’utilisation rationnelle de l’énergie repose sur le développement des technologies propres et du management environnemental dans l’industrie, sur la diversification des sources d’énergie et une intermodalité accrue et mieux organisée dans les transports, sur une meilleure maîtrise de la demande en énergie (MDE), principalement dans les secteurs résidentiel et industriel et, enfin, sur la promotion de la « haute qualité environnementale » dans les bâtiments neufs et l’existant (isolation, chauffage, éclairage). Le potentiel d’économies possibles à compter de 2015 est estimé  29 à 90 000 tep/an dans les transports, 190 000 tep/an dans le résidentiel 29 à 90 000 tep/an dans les transports, 190 000 tep/an dans le résidentiel  30, 330 000 tep/an dans le tertiaire et 1 770 000 tep/an dans l’industrie. 30, 330 000 tep/an dans le tertiaire et 1 770 000 tep/an dans l’industrie.
Le remplacement d’installations de combustion anciennes est une opération classique, qui permet de diminuer aussi bien la consommation d’énergie que les émissions de CO2 et d’autres polluants. Ainsi, quatre nouvelles chaudières « haute performance environnementale » (HPE) ont été installées, en 2002 : Bénédicta à Seclin, BPL Légumes à Vaulx-Vraucourt, Brasserie Duyck à Jenlain, Duquennoy et Lepers à Chéreng. Plus globalement, les engagements volontaires d’industriels en faveur de limitations de leurs émissions de CO2 pourraient apporter des gains supplémentaires en efficacité énergétique  31. 31.
Par ailleurs, les réseaux de chaleur en milieu urbain (Dunkerque, Lens) ou industriel (Française de Mécanique à Douvrin), en permettant une concentration des équipements de production de chaleur, favorisent un meilleur renouvellement technologique, une diversification énergétique plus souple et la valorisation des ressources locales. Enfin, la puissance actuellement installée en cogénération pourrait être considérablement augmentée.
Cependant, la demande de mobilité progressant plus rapidement que l’offre, c’est dans les transports que les actions en faveur d’une amélioration paraissent les plus complexes à mettre en œuvre. Il s’agit en effet d’intervenir sur un grand nombre de facteurs : contenir la périurbanisation, mieux organiser les transports collectifs, rationaliser le transport de marchandises, développer l’intermodalité route-fer-eau et enfin choisir les investissements d’infrastructures les plus pertinents [voir le chapitre Transports].
| |
|
 Les zones propices au développement de l’énergie éolienne Les zones propices au développement de l’énergie éolienne
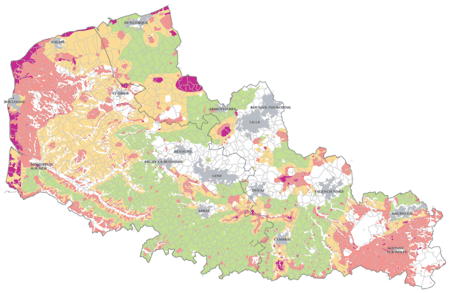
|
|
|
 La valorisation des ressources énergétiques renouvelables locales La valorisation des ressources énergétiques renouvelables locales |
|
Le potentiel de ressources énergétiques locales est estimé à 1 Mtep, à comparer aux 14,4 Mtep de la consommation d’énergie finale totale. L’objectif du contrat de plan État-Région est de doubler la production d’énergie renouvelable de la région entre 2000 et 2006. Si l’objectif est déjà atteint pour la production d’électricité (105 356 MWh en 2002 contre 48 500 en 2000), il paraît plus difficile à atteindre pour la production de chaleur (474 990 MWh en 2002 contre 405 000 en 2000)  32. 32.
La part non renouvelable du potentiel énergétique local est déjà partiellement exploitée. Il s’agit essentiellement du gaz des anciennes exploitations minières de Liévin (600 GWh/an), dont la valorisation permet de sécuriser les anciens sites miniers. Les gaz de certains hauts-fourneaux de l’industrie métallurgique (Solac) sont d’ores et déjà valorisés par la centrale thermique EDF de Dunkerque (qui fournit, en retour, les importantes quantités d’électricité nécessaires à cette industrie). La prochaine nouvelle centrale thermique au gaz de GDF d’une puissance de 800 MW, susceptible de fournir de meilleurs rendements aussi bien pour ces gaz que pour le gaz naturel, prendra le relais en 2005.
La part renouvelable, plus diversifiée, est surtout marquée par l’essor de l’éolien. Par ailleurs, 15,1 % des ordures ménagères collectées en 2001, soit 510 000 tonnes, ont subi une valorisation énergétique  33. Le biogaz, dont le gisement régional est estimé à 100 000 tep/an 33. Le biogaz, dont le gisement régional est estimé à 100 000 tep/an  34, est valorisé dans une dizaine de stations d’épuration urbaines et une vingtaine de stations industrielles. 34, est valorisé dans une dizaine de stations d’épuration urbaines et une vingtaine de stations industrielles.
Hors usage domestique, l’utilisation actuelle du bois-énergie au sein de quelques chaufferies collectives et d’une vingtaine d’installations industrielles s’élève à 9 000 tep/an pour un gisement estimé à 50 000 tep/an  35. Les deux installations au bois, acquises par les sociétés Coramine et Scierie et palette du littoral, avec le soutien financier de la région, vont permettre d’éviter les rejets annuels de 685 tonnes de CO2. 35. Les deux installations au bois, acquises par les sociétés Coramine et Scierie et palette du littoral, avec le soutien financier de la région, vont permettre d’éviter les rejets annuels de 685 tonnes de CO2.
La petite hydroélectricité, avec un potentiel estimé à 6 MW pour 1 MW installé aujourd’hui, ne constitue qu’une ressource très limitée. De même, le niveau d’ensoleillement incite peu au développement du solaire, qu’il soit thermique (moins de trente chauffe-eau solaires individuels sont recensés)  36 ou photovoltaïque, malgré l’avancée réglementaire fixant un prix de rachat par EDF du kWh produit 36 ou photovoltaïque, malgré l’avancée réglementaire fixant un prix de rachat par EDF du kWh produit  37. Si quelques réalisations concrètes comme celui de la société ERM électronique à Fleurbaix, qui s’est équipée de 110 m2 de capteurs capables de fournir 10 000 kWh/an, peuvent servir d’exemple, c’est davantage l’essor de la construction HQE qui devrait promouvoir l’utilisation du solaire comme alternative ou complément énergétique. 37. Si quelques réalisations concrètes comme celui de la société ERM électronique à Fleurbaix, qui s’est équipée de 110 m2 de capteurs capables de fournir 10 000 kWh/an, peuvent servir d’exemple, c’est davantage l’essor de la construction HQE qui devrait promouvoir l’utilisation du solaire comme alternative ou complément énergétique.
 Des conditions propices au développement de l’éolien Des conditions propices au développement de l’éolien |
|
Région côtière, le Nord - Pas-de-Calais présente un fort potentiel éolien en raison des vitesses moyennes annuelles du vent à 50 m au-dessus du niveau du sol, comprises entre 5,5 et 7,5 m/s  38. La cartographie du potentiel éolien montre que 77 % du territoire seraient propices 38. La cartographie du potentiel éolien montre que 77 % du territoire seraient propices  39 au développement de l’énergie éolienne. Néanmoins, les projets développés sur le territoire régional devront être envisagés au regard de leur incidence sur l’environnement et le paysage et intégrer les spécificités des territoires. D’anciens sites industriels ou miniers à reconquérir et à réhabiliter pourraient potentiellement accueillir de nouvelles implantations. 39 au développement de l’énergie éolienne. Néanmoins, les projets développés sur le territoire régional devront être envisagés au regard de leur incidence sur l’environnement et le paysage et intégrer les spécificités des territoires. D’anciens sites industriels ou miniers à reconquérir et à réhabiliter pourraient potentiellement accueillir de nouvelles implantations.
La région s’est impliquée dès 1990 dans le développement de cette filière, avant même le lancement en 1996 du programme national « Éole 2005 »  40, qui visait alors à doter le pays d’un potentiel d’électricité éolienne de 250 à 500 MW à l’horizon 2005. Ainsi, l’éolienne de Bondues, qui est toujours en activité, a été une des premières installées en France (1993). Par ailleurs, la région a accueilli la première centrale éolienne française dans le port autonome de Dunkerque (1996) : neuf éoliennes pour une puissance totale de 2,7 MW. 40, qui visait alors à doter le pays d’un potentiel d’électricité éolienne de 250 à 500 MW à l’horizon 2005. Ainsi, l’éolienne de Bondues, qui est toujours en activité, a été une des premières installées en France (1993). Par ailleurs, la région a accueilli la première centrale éolienne française dans le port autonome de Dunkerque (1996) : neuf éoliennes pour une puissance totale de 2,7 MW.
Fin 2002, la puissance régionale installée, répartie sur cinq parcs « on shore », est de 11,43 MW, soit 7,5 % de la puissance nationale (153 MW)  41. Elle a pratiquement triplé en deux ans, avec l’installation de 3 MW (quatre éoliennes de 750 MW) au Portel en 2002 et 4,5 MW (six éoliennes de 750 MW) à Widehem en 2001. 41. Elle a pratiquement triplé en deux ans, avec l’installation de 3 MW (quatre éoliennes de 750 MW) au Portel en 2002 et 4,5 MW (six éoliennes de 750 MW) à Widehem en 2001.
L’important potentiel de développement régional de cette énergie repose aussi sur l’existence d’un pôle local de recherche  42 et sur le renforcement d’une éco-activité locale spécialisée : bureaux d’étude, constructeur ou distributeur d’éoliennes, exploitants de parcs 42 et sur le renforcement d’une éco-activité locale spécialisée : bureaux d’étude, constructeur ou distributeur d’éoliennes, exploitants de parcs  43. 43.
Aujourd’hui, la poursuite du développement régional de l’énergie éolienne profite de l’obligation de rachat de l’électricité éolienne par EDF à un prix fixe  44. Cette disposition est à mettre en relation avec l’objectif, accepté par la France et fixé par la directive 2001/77/CE 44. Cette disposition est à mettre en relation avec l’objectif, accepté par la France et fixé par la directive 2001/77/CE  45, qui précise que 21 % de la consommation intérieure d’électricité devra être d’origine renouvelable à l’horizon 2010 45, qui précise que 21 % de la consommation intérieure d’électricité devra être d’origine renouvelable à l’horizon 2010  46. La récente programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité 46. La récente programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité  47 prévoit déjà d’installer 2 000 à 6 000 MW supplémentaires d’ici 2007. L’ambition nationale est d’atteindre au total de 10 000 à 15 000 MW à l’horizon 2010. 47 prévoit déjà d’installer 2 000 à 6 000 MW supplémentaires d’ici 2007. L’ambition nationale est d’atteindre au total de 10 000 à 15 000 MW à l’horizon 2010.
Enfin, un schéma régional éolien a été élaboré en 2003 afin de faciliter un développement cohérent de l’éolien  48. Il apporte des recommandations techniques et renseigne sur les données exploitables pour l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des projets éoliens. Il établit la cartographie des zones potentielles d’installation de parcs éoliens, issue du croisement de la carte du gisement éolien théorique avec celles relatives aux contraintes environnementales, aux sensibilités paysagères et ornithologiques, etc. 48. Il apporte des recommandations techniques et renseigne sur les données exploitables pour l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des projets éoliens. Il établit la cartographie des zones potentielles d’installation de parcs éoliens, issue du croisement de la carte du gisement éolien théorique avec celles relatives aux contraintes environnementales, aux sensibilités paysagères et ornithologiques, etc.
Si l’éolien apparaît aujourd’hui comme une des réponses à l’infléchissement nécessaire des politiques énergétiques en faveur des énergies renouvelables, son développement ne pourra cependant pas se faire sans l’intégration des sensibilités environnementales et paysagères du site.
 Notes Notes
|
23 - Soutes maritimes incluses.
24 - Voir http://www.are-npdc.org
25 - Opérationnel jusqu’en 2000.
26 - Voir http://www.norener.com (conseil régional Nord - Pas-de-Calais, direction environnement, service prospective). Ce site est en cours de restauration.
27 - Photovoltaïque, éolien, micro-hydraulique, solaire thermique, héliogéothermie, boisénergie, valorisation énergétique des déchets, cogénération et récupération d’énergie.
28 - Source : Ademe Nord - Pas-de-Calais.
29 - Source : Norener, 2003. Ces chiffres correspondent aux différentiels de consommations finales d’énergie observés en 2015 pour chaque secteur entre les deux scenarii « haut » et « bas » de l’exercice de prospective précédemment reporté. Les estimations faites pour 2020 par le schéma de services collectifs de l’énergie en 1999 sont parfois divergentes : 770 000 tep/an pour les transports, 360 000 tep/an pour l’industrie, 200 000 tep/an pour le résidentiel, 440 000 tep/an pour le tertiaire.
30 - Les économies d’énergie possibles dans le résidentiel neuf ou ancien au niveau des installations de chauffage et de l’isolation thermique sont freinées par une proportion d’habitations individuelles supérieure et des revenus inférieurs par rapport aux moyennes nationales.
31 - Fondée en septembre 2002 par le patronat français, l’Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre comprend 21 industriels (Pechiney, Ciments Lafarge, Saint-Gobain, etc.) et trois producteurs d’énergie, dont EDF. En 2001, ces entreprises représentaient 56 % des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie manufacturière, des producteurs d’énergie et des raffineurs de pétrole. Les 24 entreprises se sont fixé comme objectif de réduire de 14 % le total de leurs émissions (soit 18 millions de tonnes équivalent CO2) d’ici à 2007 par rapport à 1990.
32 - Ademe Nord - Pas-de-Calais, 2002. Rapport d’activité 2002. Douai. 41 p.
33 - Ademe Nord - Pas-de-Calais, 2002. Rapport d’activité 2002. Douai. 41 p.
34 - Gisement issu des décharges, des stations d’épuration, de la méthanisation de la fraction organique des ordures ménagères. Source : Schéma de services collectifs de l’énergie, 1999.
35 - Déchets de bois et bois de rebuts (industrie du bois, exploitation des forêts). Source : Schéma de services collectifs de l’énergie, 1999.
36 - Observatoire de la production décentralisée d’énergie, Ademe Nord - Pas-de-Calais, 2002.
37 - Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, à 15,25 centimes d’euros le kWh.
38 - Source : European Wind Energy Atlas, Troen & Pedersen, 1989.
39 - La densité d’énergie calculée à 50 m au niveau du sol y est supérieure à 200 W/m2, correspondant à une vitesse minimale de vent de 5,4 m/s et 2 000 heures équivalent de fonctionnement à pleine puissance. Pour la cartographie complète, voir http://www.schemaregionaleolien-npdc.org
40 - À l’initiative du ministère chargé de l’Industrie, de l’Ademe et d’EDF.
41 - Source : Observ’ER, 2003. Au 12 juin 2003, la puissance nationale était de 193,15 MW. Pour le détail des installations, voir http://www.suivi-eolien.com
42 - Constitué de l’université de Valenciennes, de l’Institut de mécanique des fluides de Lille, de l’École polytechnique de Mons et d’entreprises.
43 - Par exemple, bureaux d’étude : Forclum ingénierie, Espace Éolien Développement ; constructeur d’éoliennes : Jeumont SA ; distributeur d’éoliennes : InnoVent ; exploitants de parcs : SAEML (société anonyme d’économie mixte locale) Éolienne Nord - Pas-de-Calais.
44 - Arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, à 8 centimes d’euros le kWh.
45 - Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JOCE du 27 octobre 2001).
46 - Cet objectif s’inscrit dans la politique européenne de diminution des émissions de gaz à effet de serre, tout en renforçant l’indépendance et la sécurité d’approvisionnement en énergie.
47 - Arrêté du 7 mars 2003, JO du 18 mars 2003.
48 - Voir http://www.schemaregionaleolien-npdc.org
|
|
|