|
 Les déchets ménagers et assimilés Les déchets ménagers et assimilés |
En 2001, la région a produit environ 1,6 million de tonnes de déchets industriels banals (DIB)  3 et 2,3 millions de tonnes de déchets de type ménager collectés par le service public. Avec un taux de valorisation (matière, énergétique et biologique) de 33 % en 2000, la performance de la région est inférieure au niveau national (42 %) en raison, notamment, du faible taux de valorisation énergétique. Mais, avec la récente mise en service du centre de valorisation énergétique d’Halluin, qui traite 340 000 tonnes par an de déchets ménagers, la situation s’est fortement améliorée depuis 2001. 3 et 2,3 millions de tonnes de déchets de type ménager collectés par le service public. Avec un taux de valorisation (matière, énergétique et biologique) de 33 % en 2000, la performance de la région est inférieure au niveau national (42 %) en raison, notamment, du faible taux de valorisation énergétique. Mais, avec la récente mise en service du centre de valorisation énergétique d’Halluin, qui traite 340 000 tonnes par an de déchets ménagers, la situation s’est fortement améliorée depuis 2001.
En 2001, chaque habitant était à l’origine de 601 kilogrammes de déchets. Ce chiffre ne cesse de croître. Il a augmenté de plus de 7 % en trois ans malgré les efforts en faveur de la sensibilisation des populations à ce problème. Cette valeur élevée peut s’expliquer de plusieurs manières. Dans une région fortement urbanisée où les habitants n’ont pas d’autres moyens pour éliminer leurs déchets, la généralisation de la collecte porte-à-porte et le développement des services permettent une très bonne captation du gisement. Enfin, les déchets d’entreprises (commerce, artisanat, etc.) peuvent s’ajouter aux déchets ménagers et être collectés par le service public  4. 4.
 La montée en puissance de l’incinération La montée en puissance de l’incinération |
|
On assiste aujourd’hui à la montée en puissance de nouvelles usines après une vague de fermeture. Entre 1997 et 2002, neuf usines non conformes ou obsolètes ont cessé leur activité, ce qui a, dans un premier temps, contribué à diminuer considérablement la capacité d’incinération. L’unité d’Halluin, près de Lille, a été fermée en raison de la présence de dioxines dans son environnement proche (lait contaminé). Conscients des risques encourus, les élus de la communauté urbaine de Lille ont pris alors la décision de fermer simultanément les trois usines de l’agglomération qui étaient toutes trois non conformes. Puis, la remise aux normes d’unités anciennes s’avérant impossible, les fermetures se sont enchaînées dans la région : Dunkerque, Arras, Saint- Omer, etc.
La réouverture du centre d’Hénin-Beaumont et la mise en service de la nouvelle unité de valorisation énergétique d’Halluin ont permis d’accroître le tonnage incinéré. Désormais, sept usines  5 sont en fonctionnement dans la région et deux projets sont en cours. L’incinération est elle-même source de déchets, dont certains peuvent être valorisés, comme par exemple dans les travaux publics. Ainsi, la quasi-totalité des mâchefers produits par les incinérateurs de la région, soit 199 225 tonnes, a subi un traitement de déferraillage pour récupérer les métaux. Les 17 976 tonnes de Refiom 5 sont en fonctionnement dans la région et deux projets sont en cours. L’incinération est elle-même source de déchets, dont certains peuvent être valorisés, comme par exemple dans les travaux publics. Ainsi, la quasi-totalité des mâchefers produits par les incinérateurs de la région, soit 199 225 tonnes, a subi un traitement de déferraillage pour récupérer les métaux. Les 17 976 tonnes de Refiom  6 sont des déchets dangereux enfouis en décharge de classe I hors de la région. 6 sont des déchets dangereux enfouis en décharge de classe I hors de la région.
| |
|
 Le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés en 2000 Le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés en 2000
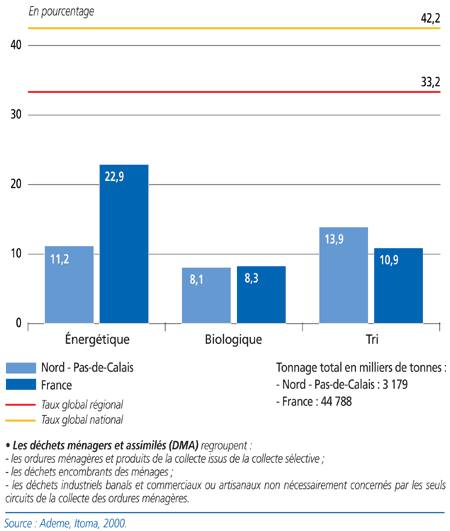
|
| |
|
 La valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés au lieu de traitement en 2000 La valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés au lieu de traitement en 2000
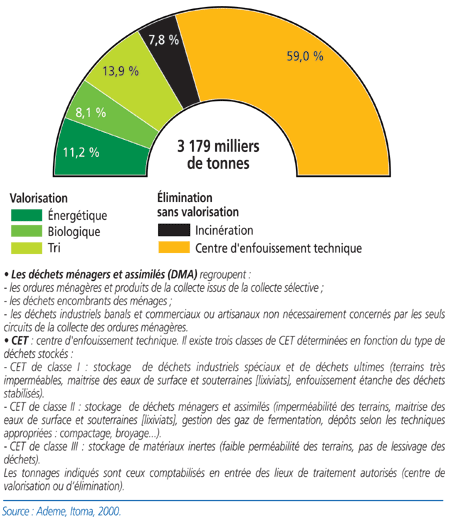
|
| |
|
 La valorisation et l’élimination des ordures ménagères au lieu de traitement en 2000 La valorisation et l’élimination des ordures ménagères au lieu de traitement en 2000
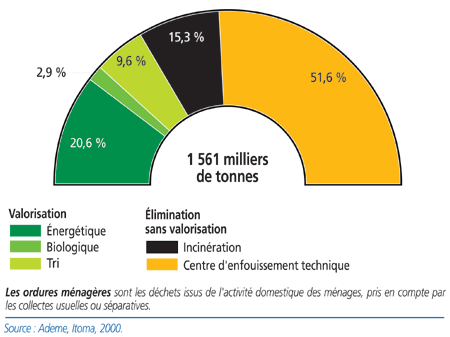
|
 60 % des déchets ménagers et assimilés vont en décharge 60 % des déchets ménagers et assimilés vont en décharge  7 7 |
|
Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont encore en majorité enfouis dans des décharges alors que la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets demandait qu’au 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes y soient stockés. À la suite de la fermeture de plusieurs usines d’incinération depuis 1997, les tonnages acceptés en décharge ont augmenté pour atteindre près de 2 millions de tonnes en 1999 et redescendre ensuite à 1,8 million de tonnes en 2001. Pour faire face à cette croissance, les déchets ont été en partie acheminés hors de la région durant cette période. En 2001, 60 % des déchets ménagers et assimilés traités en Nord - Pas-de- Calais, soit 1,8 million de tonnes  8, ont été enfouis dans les quinze décharges autorisées de la région susceptibles d’accueillir ce type de déchets (classe II). Ils étaient composés à 50 % des déchets de type ménagers collectés par le service public et à 38 % de déchets industriels banals. Petit à petit, le nombre de décharges diminue. Il y avait vingt installations en 1999, seize en 2000, quinze en 2001 et dix fin 2002. On peut espérer à moyen terme une réduction des tonnages mis en décharge grâce à la généralisation du tri sélectif et à la mise en service de nouvelles unités d’incinération. 8, ont été enfouis dans les quinze décharges autorisées de la région susceptibles d’accueillir ce type de déchets (classe II). Ils étaient composés à 50 % des déchets de type ménagers collectés par le service public et à 38 % de déchets industriels banals. Petit à petit, le nombre de décharges diminue. Il y avait vingt installations en 1999, seize en 2000, quinze en 2001 et dix fin 2002. On peut espérer à moyen terme une réduction des tonnages mis en décharge grâce à la généralisation du tri sélectif et à la mise en service de nouvelles unités d’incinération.
 La méconnaissance de décharges brutes La méconnaissance de décharges brutes |
|
Environ cent cinquante décharges brutes ont été recensées dans la région lors d’un inventaire non exhaustif effectué en 1998. Faute de nouvelle enquête, ni la connaissance du nombre d’anciennes décharges autorisées, et plus encore des décharges non autorisées, ni celle des produits stockés n’a évolué. Si toutes les décharges brutes autorisées sont désormais fermées, elles ne sont pas pour autant réhabilitées. Or, les risques qui peuvent être liés au stockage de certains produits persistent. La gestion de ces sites devant s’effectuer dans la durée, il est essentiel d’en connaître la localisation.
 Rechercher l’organisation territoriale optimale Rechercher l’organisation territoriale optimale |
|
Le territoire régional se compose de 78 structures intercommunales et de 93 communes indépendantes compétentes pour effectuer la collecte et/ou le traitement des déchets au titre du service public. Il existe de fortes disparités entre les structures intercommunales, tant dans l’étendue de leurs compétences que dans leur poids démographique. Certaines se limitent à une simple collecte en déchèteries, d’autres assurent la gestion globale du service, de la collecte jusqu’au traitement des déchets. Elles regroupent de quelques milliers d’habitants à plus d’un million d’habitants. Ainsi, 52 collectes desservent moins de 25 000 habitants (elles regroupent 15 % de la population régionale). Onze collectivités sont de taille moyenne, entre 25 000 et 50 000 habitants. Les autres sont des intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Enfin, la communauté urbaine de Lille est de loin la plus grande avec plus d’un million d’habitants. Ces disparités peuvent être un obstacle à une gestion cohérente des déchets. Un périmètre de compétence trop restreint ou une population trop réduite empêchent de mettre en place un traitement efficace à un coût acceptable. De nouvelles solidarités intercommunales sont recherchées pour optimiser les services de collecte et de traitement.
 Plus de services pour plus de valorisation Plus de services pour plus de valorisation |
|
Les petites structures intercommunales ont en général de plus faibles ratios de production que les grandes. Les ratios élevés se retrouvent dans les zones touristiques, urbaines, et industrielles : littoral, bassin minier, métropole lilloise et bassin de la Sambre. Ils correspondent souvent à un niveau de services élevé. Les structures qui ont les meilleures performances sont celles qui ont mis en place un programme complet de valorisation incluant une collecte de bio-déchets, une collecte des déchets d’emballages ménagers et journaux-magazines, ainsi qu’un réseau de déchèteries. Un tel programme permet de dépasser 225 kilogrammes par habitant et par an en vue d’une valorisation matière. En 2000, trente-quatre collectivités parvenaient à valoriser plus de 25 % des déchets collectés. Sept d’entre elles dépassaient les 40 % et trois les 50 % (le Sivom de Bapaume, la Ville de Saillysur- Lys et le Sivom du bas pays de l’Artois). Ces collectivités atteignaient les objectifs fixés par la circulaire du 28 avril 1998  9 qui fixait un taux de valorisation national de 50 % des déchets collectés par les collectivités, par réutilisation, recyclage, traitement biologique ou épandage sur terres agricoles. 9 qui fixait un taux de valorisation national de 50 % des déchets collectés par les collectivités, par réutilisation, recyclage, traitement biologique ou épandage sur terres agricoles.
 Réduire les distances entre les lieux de collecte et de traitement Réduire les distances entre les lieux de collecte et de traitement |
|
La fermeture des décharges brutes et des incinérateurs trop anciens pour être mis aux normes a considérablement augmenté le transport des ordures ménagères. En 2000, on estimait à 25 kilomètres en moyenne la distance entre le lieu de collecte et le centre de traitement. Pour chaque habitant, ce sont donc, en moyenne, l’équivalent de 17 tonnes-kilomètres de déchets qui sont transportées. Ce chiffre montre toute la marge de progrès possible. Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés des départements du Nord et du Pas-de-Calais proposent le développement du transport des déchets par voie d’eau ou par rail à partir de centres de transfert. Ils prévoient de rendre ces modes de transports accessibles pour toutes les nouvelles installations (transfert, incinération, tri, etc.). Certains centres de transfert existent déjà, d’autres restent à implanter.
 La collecte sélective : le développement se poursuit La collecte sélective : le développement se poursuit |
|
En 2001, 2,6 millions d’habitants disposaient d’une collecte des recyclables et 1,7 million d’habitants bénéficiaient d’un dispositif de collecte des bio-déchets. Au total, 76 % de la population régionale, soit environ trois millions d’habitants, pouvaient, d’une manière ou d’une autre, effectuer le geste de tri au quotidien. La population non encore desservie est la plus difficile à atteindre, soit parce qu’elle est située en hypercentre ou qu’il s’agit d’habitat vertical, soit parce que les acteurs locaux ne sont pas encore convaincus de son intérêt.
 La valorisation : d’importants progrès La valorisation : d’importants progrès  10 10 |
|
La poubelle standard produite annuellement par habitant (601 kilogrammes de déchets) se compose essentiellement de verre, journaux-magazines, emballages ménagers et déchets organiques. Trente-quatre kilogrammes de verre ménager ont été collectés par habitant. Au total, 529 000 tonnes ont été collectées en vue d’une valorisation matière, soit 22 % du tonnage global collecté dans le cadre du service public, ce qui représente 133 kilogrammes par an et par habitant. Les déchets d’emballages ménagers ont contribué à hauteur de 64 kilogrammes par an et par habitant à la valorisation matière. Ce sont finalement près de 300 000 tonnes de matériaux qui ont été effectivement livrées aux filières de valorisation. Le verre représentait 36 % des matériaux valorisés, le compost 24 %, les journaux-magazines 14 %, les papiers-cartons d’emballage 8 %, les plastiques 3 % et les autres matériaux recyclables de déchèteries 14 %. La valorisation matière concerne environ 2 000 emplois dans la région.
| |
|
 La valorisation de la fraction sèche recyclable des ordures ménagères (en sortie de centre de trie) en 2001 La valorisation de la fraction sèche recyclable des ordures ménagères (en sortie de centre de trie) en 2001
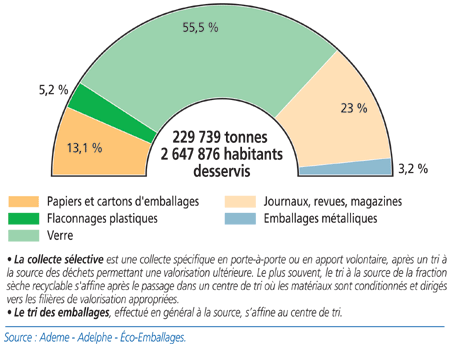
|
 Notes Notes
|
3 - 1,5 million de tonnes de déchets industriels banals et 125 000 tonnes de déchets banals issus du BTP.
4 - Ils représenteraient environ 20 % des déchets collectés.
5 - Halluin, Maubeuge, Saint-Saulve, Douchy-les-Mines, Hénin-Beaumont, Noyelles-sous- Lens, Labeuvière.
6 - Refiom : résidu d’épuration des fumées d’incinération d’ordures ménagères.
7 - Données extraites de : Drire, 2002. L’industrie au regard de l’environnement. Douai, 265 p.
8 - Ce chiffre est légèrement sous-estimé. Des déchets peuvent aller dans des petites décharges autorisées ou des décharges brutes.
9 - La circulaire du 28 avril 1998 concerne les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
10 - Données extraites de l’Atlas valorisation matière, Agence régionale de l’énergie, bilan 2000.
|
|
|