|
 Les tendances du transport régional Les tendances du transport régional |
 Un transport routier de plus en plus consommateur d’énergie Un transport routier de plus en plus consommateur d’énergie |
|
Les estimations de l’évolution de la consommation énergétique du transport routier réalisées par la délégation Nord - Pas-de-Calais de l’Ademe et le conseil régional Nord - Pas-de-Calais  1 traduisent l’augmentation importante des trafics régionaux. 1 traduisent l’augmentation importante des trafics régionaux.
La hausse de la consommation énergétique du transport routier, entre 1990 et 2000, est plus importante que la tendance nationale : + 20 % dans la région contre + 15 % sur l’ensemble du territoire national. Elle est particulièrement forte (+ 38 %) pour le transport de marchandises (poids lourds et véhicules utilitaires légers) alors qu’elle a été plus modérée (+ 11 %) pour le transport de voyageurs (voitures particulières). Quant à la croissance très rapide du trafic de véhicules utilitaires légers, elle a accompagné le développement du transport de marchandises en milieu urbain. La part du transport de marchandises dans la consommation énergétique de la circulation routière est donc en nette augmentation.
Le PIB régional a augmenté, entre 1990 et 2000, à un rythme légèrement inférieur à la moyenne nationale mais, dans la région, la croissance de la consommation énergétique du transport routier de marchandises a été deux fois supérieure à l’accroissement de la création de richesse (PIB en volume)  2. 2.
Le faible accroissement de la population du Nord - Pas-de-Calais sur la période 1990-1999 (+ 0,8 %) explique en partie que la consommation énergétique des voitures particulières se soit accrue à un rythme moins soutenu à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale  3. 3.
| |
|
 La fragmentation des zones écologiques par les infrastructures et les zones urbanisées La fragmentation des zones écologiques par les infrastructures et les zones urbanisées
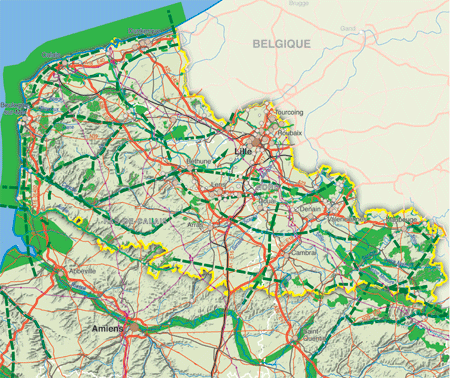
|
|
|
| |
|
 L’évolution de la consommation énergétique du transport routier L’évolution de la consommation énergétique du transport routier
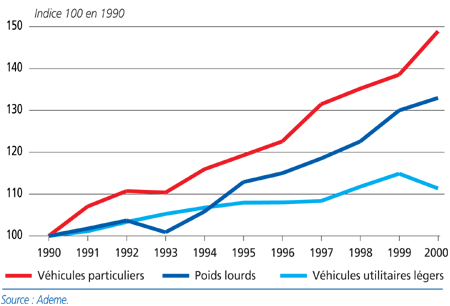
|
 Une évolution mitigée des performances environnementales du parc automobile Une évolution mitigée des performances environnementales du parc automobile |
|
Selon les calculs de la délégation régionale de l’Ademe et du conseil régional Nord - Pas-de-Calais, les émissions de CO2 du transport routier se sont accrues de 17 % entre 1995 et 2000. Les impacts sanitaires de la pollution de l’air n’ont pas augmenté au même rythme. Les progrès technologiques sur l’émission des polluants locaux du transport routier ont en effet compensé, entre 1995 et 2000, la hausse du trafic  4. Il est donc difficile de conclure sur le sens de l’évolution de la somme des impacts de la pollution de l’air et de l’effet de serre sur cette période. La forte diésélisation du parc des voitures particulières de la région (35 % contre 30,8 % au niveau national en 1997) a, certes, réduit les consommations unitaires, mais elle a aussi aggravé la pollution de l’air. Les filtres à particules réduisent aujourd’hui les émissions des particules fines émises par les nouveaux véhicules « diesel » mais, avec le vieillissement des automobiles, leur généralisation dans le parc roulant nécessite de plus en plus de temps. 4. Il est donc difficile de conclure sur le sens de l’évolution de la somme des impacts de la pollution de l’air et de l’effet de serre sur cette période. La forte diésélisation du parc des voitures particulières de la région (35 % contre 30,8 % au niveau national en 1997) a, certes, réduit les consommations unitaires, mais elle a aussi aggravé la pollution de l’air. Les filtres à particules réduisent aujourd’hui les émissions des particules fines émises par les nouveaux véhicules « diesel » mais, avec le vieillissement des automobiles, leur généralisation dans le parc roulant nécessite de plus en plus de temps.
| |
|
 L’âge moyen du parc automobile L’âge moyen du parc automobile
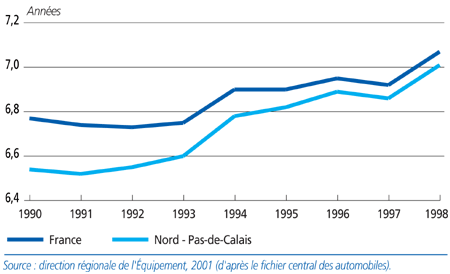
|
 Une dépendance à l’automobile de plus en plus forte Une dépendance à l’automobile de plus en plus forte |
|
L’enquête Inrets  5 sur le parc automobile montre que les véhicules à la disposition des ménages ont parcouru en 1998 l’équivalent de la moyenne nationale annuelle, soit 13 600 km par véhicule pour un nombre inférieur de véhicules par ménage (– 11 %) et un nombre supérieur de personne par ménage (+ 9 %). En contrepartie, la région est caractérisée par de plus forts taux de remplissage et donc un usage plus rationnel des capacités 5 sur le parc automobile montre que les véhicules à la disposition des ménages ont parcouru en 1998 l’équivalent de la moyenne nationale annuelle, soit 13 600 km par véhicule pour un nombre inférieur de véhicules par ménage (– 11 %) et un nombre supérieur de personne par ménage (+ 9 %). En contrepartie, la région est caractérisée par de plus forts taux de remplissage et donc un usage plus rationnel des capacités  6 des véhicules et ceci malgré la tendance, comme ailleurs, à l’individualisation des déplacements. 6 des véhicules et ceci malgré la tendance, comme ailleurs, à l’individualisation des déplacements.
Selon le recensement de la population de 1999, les actifs de la région parcourent, lors de leurs déplacements domicile-travail, une distance moindre que les actifs français (9 km contre 9,7 km). Néanmoins, comme ils sont 71 % contre 65 % à utiliser l’automobile pour leurs déplacements quotidiens, les actifs du Nord - Pasde- Calais, au final, parcourent en voiture une distance équivalente à la moyenne nationale pour leurs trajets domicile-travail. Ainsi, la densité élevée de population a permis de contenir l’allongement des déplacements quotidiens mais l’usage de l’automobile reste important par rapport aux transports collectifs.
Les enquêtes Ménages déplacements  7 viennent confirmer la place de l’automobile dans les déplacements quotidiens urbains : à Lille, en 1997, 86 % 7 viennent confirmer la place de l’automobile dans les déplacements quotidiens urbains : à Lille, en 1997, 86 %  8 de l’ensemble de ces déplacements en modes mécanisés sont réalisés en voiture (contre 82 % en 1986). Les parts de marché des transports collectifs et du vélo ne cessent donc de diminuer dans cette zone urbaine dense où les impacts sanitaires de l’automobile sont les plus forts. Comme le nombre journalier de déplacements par personne atteint un niveau record de 3,9 8 de l’ensemble de ces déplacements en modes mécanisés sont réalisés en voiture (contre 82 % en 1986). Les parts de marché des transports collectifs et du vélo ne cessent donc de diminuer dans cette zone urbaine dense où les impacts sanitaires de l’automobile sont les plus forts. Comme le nombre journalier de déplacements par personne atteint un niveau record de 3,9  9, de nombreux déplacements automobiles se réalisent sur des trajets courts, c’est-àdire les plus polluants. 9, de nombreux déplacements automobiles se réalisent sur des trajets courts, c’est-àdire les plus polluants.
Le faible équipement en automobile des ménages régionaux (74,7 % contre 79,6 % au niveau national) ne peut pas être interprété, comme en Île-de-France, par une moindre dépendance à l’automobile. Dans cette région marquée par un chômage élevé où les migrations alternantes semblent jouer un rôle d’ajustement sur le marché du travail, l’absence de véhicule est souvent liée à un niveau insuffisant des revenus  10 et participe alors au phénomène d’exclusion sociale. 10 et participe alors au phénomène d’exclusion sociale.
| |
|
 Les navettes domicile-travail Les navettes domicile-travail
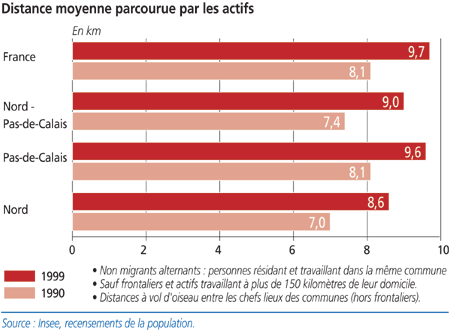
|
 Une croissance spectaculaire du flux terrestre de marchandises Une croissance spectaculaire du flux terrestre de marchandises |
|
En 1999, près de 254 millions de tonnes ont été transportées à destination ou en provenance du Nord - Pasde- Calais, ce qui représente 8,3 %  11 des volumes traités par la France. 40 % de ces flux concernent l’international (96 millions de tonnes), soit 18 % des échanges extérieurs de la France (tous modes de transport confondus) 11 des volumes traités par la France. 40 % de ces flux concernent l’international (96 millions de tonnes), soit 18 % des échanges extérieurs de la France (tous modes de transport confondus)  12. 12.
En Nord - Pas-de-Calais, les deux tiers du trafic national (tonnes chargées et déchargées en France) sont constitués du trafic interne. Comme la distance moyenne parcourue au titre du trafic interne est seulement de 39 km, il n’est pas surprenant d’y constater la prépondérance du mode routier : celui-ci assure en effet 94,8 % du tonnage de ces flux terrestres (contre 3,7 % pour le fer et 1,7 % pour les voies navigables qui permettent notamment d’acheminer les minéraux bruts). Ces flux internes routiers, pour lesquels il n’est pas réaliste d’envisager un transfert modal important, ont augmenté de 29 % entre 1993 et 2000.
Une partie de ces flux internes routiers provient ou est dirigée vers des plates-formes logistiques intermodales et correspond donc à du transport combiné qui minimise les trajets routiers initiaux et terminaux. Il apparaît cependant que les transporteurs routiers utilisent peu le ferroutage. En effet, en ce qui concerne le tiers restant du trafic national pour lequel le fer est concurrentiel (la distance moyenne est nettement plus importante  13), la route contribue encore pour 74 % des tonnages transportés aux flux interrégionaux. Les parts du rail et des voies navigables (25 % et 1 %) restent faibles d’autant que les pondéreux (comme les minéraux bruts et les matériaux de construction) représentent 33 % des flux interrégionaux 13), la route contribue encore pour 74 % des tonnages transportés aux flux interrégionaux. Les parts du rail et des voies navigables (25 % et 1 %) restent faibles d’autant que les pondéreux (comme les minéraux bruts et les matériaux de construction) représentent 33 % des flux interrégionaux  14. Depuis 1993, la part du transport routier dans le transport interrégional de marchandises a globalement progressé. 14. Depuis 1993, la part du transport routier dans le transport interrégional de marchandises a globalement progressé.
Les produits pétroliers occupent une grande part des tonnages importés (39 %) dans les ports de la région mais ils transitent en grande partie par oléoducs. Si l’on exclut le transport d’hydrocarbures (qui a augmenté de manière plus modérée), la croissance du transport international a été régulière et soutenue. Pendant la période 1993-2000, elle a suivi le rythme de la croissance du transport national (40 %) à destination ou en provenance du Nord - Pas-de-Calais.
Dans les échanges internationaux, si l’on se limite aux échanges avec l’Union européenne  15, le principal mode de transport est également la route, avec environ 55 % des volumes échangés pour les importations comme pour les exportations. Le mode maritime occupe le deuxième rang avec 19,4 % des volumes échangés, alors que le ferroviaire compte pour 6 % et la voie d’eau 5 %. 15, le principal mode de transport est également la route, avec environ 55 % des volumes échangés pour les importations comme pour les exportations. Le mode maritime occupe le deuxième rang avec 19,4 % des volumes échangés, alors que le ferroviaire compte pour 6 % et la voie d’eau 5 %.
| |
|
 Les flux de marchandises (traffic interrégional) en 2001 Les flux de marchandises (traffic interrégional) en 2001
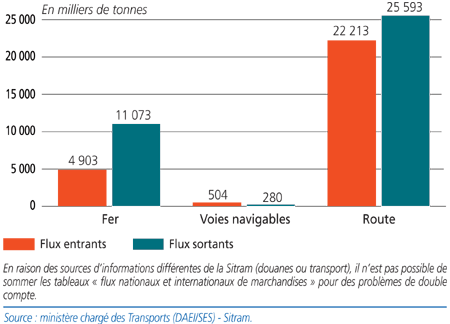
|
| |
|
 L’évolution des modes de transport de marchandises (traffic national) L’évolution des modes de transport de marchandises (traffic national)
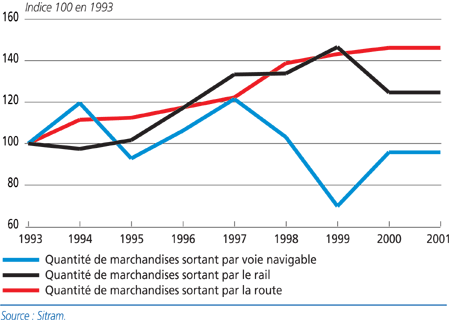
|
 Les dynamiques du transport maritime : complémentarité, concurrence et risques de pollution maritime Les dynamiques du transport maritime : complémentarité, concurrence et risques de pollution maritime |
|
L’économie du Nord - Pas-de-Calais, région pourvue d’une large façade littorale, repose en partie sur l’activité portuaire. Ainsi, 46 millions de tonnes de marchandises ont transité dans les trois ports relevant de la compétence de l’État : Dunkerque, Calais et Boulogne. Proches les uns des autres (moins de 50 kilomètres les séparent), chacun des ports a un profil très marqué qui tend à se renforcer :
• Boulogne s’est spécialisé dans la pêche et le traitement du poisson ;
• Calais, tourné vers le trafic transmanche, a longtemps eu une vocation de transport de passagers. Mais la fréquentation des voyageurs tend à se contracter avec la montée en puissance du trafic du tunnel, même si 14 millions de passagers transitaient encore en 2001 par ce port. Dans le trafic transmanche, le fret surprend par son dynamisme. Entre 1990 et 2001, les mouvements du port de Calais en marchandises diverses (exclusivement non conteneurisées) ont augmenté de 47 % et représentent, en 2001, avec 31,2 millions de tonnes, un tiers des mouvements portuaires nationaux de ce type de produits. En trente ans, Calais est ainsi passé de la neuvième place en 1973 à la quatrième place en 1998 dans la hiérarchie du transport maritime de marchandises  16 ; 16 ;
• Dunkerque, troisième port de commerce français, s’est spécialisé, en lien avec son importante zone industrialoportuaire, dans le transport de fret. Il permet les entrées maritimes en France de 7 % des produits pétroliers (9,8 millions de tonnes en 2001) et surtout un tiers du vrac solide (19,3 millions de tonnes), mais sa contribution au trafic des autres marchandises diverses (conteneurisées ou non) reste relativement faible.
La forte concurrence des ports voisins de Zeebrugge, Gand, Le Havre, Anvers et Rotterdam influe sur les fluctuations des activités portuaires du Nord - Pas-de-Calais, qui doivent répondre aux attentes des armateurs et des chargeurs. Leur développement passe par une augmentation de leur capacité d’accueil, de manutention et d’entreposage ainsi que par des infrastructures terrestres. D’autres éléments, comme le coût de passage et les services (ravitaillement, fonctionnement de la douane, contrôle au port pour améliorer la sécurité maritime, etc.) participent à la compétitivité des places portuaires.
La capacité d’accueil et de desserte terrestre ne sera peut-être bientôt plus le seul facteur limitant du trafic portuaire de la région. Dans le détroit du Pas de Calais, le Cross  17 de Gris-Nez évalue, en 2000, le trafic annuel à 200 000 bateaux et enregistre un transit d’hydrocarbures de 99 millions de tonnes. 17 de Gris-Nez évalue, en 2000, le trafic annuel à 200 000 bateaux et enregistre un transit d’hydrocarbures de 99 millions de tonnes.
Malgré la séparation du trafic dans le rail  18, les risques de collision et de pollution accidentelle sont particulièrement importants dans le détroit du Pas de Calais. Le naufrage du Tricolor en 2002 a alerté les autorités et la population sur la nécessité de contrôler davantage la circulation dans le détroit. À ces risques de pollution accidentelle par les hydrocarbures s’ajoutent les risques liés au transport d’autres substances nocives (minerais, soufre, produits chimiques, glycol) mais aussi celui des pollutions produites lors des opérations de routine ou illicites (comme le déballastage et le lavage de citernes). 18, les risques de collision et de pollution accidentelle sont particulièrement importants dans le détroit du Pas de Calais. Le naufrage du Tricolor en 2002 a alerté les autorités et la population sur la nécessité de contrôler davantage la circulation dans le détroit. À ces risques de pollution accidentelle par les hydrocarbures s’ajoutent les risques liés au transport d’autres substances nocives (minerais, soufre, produits chimiques, glycol) mais aussi celui des pollutions produites lors des opérations de routine ou illicites (comme le déballastage et le lavage de citernes).
| |
|
 "Chevelu" des navires dans le détroit du Pas de Calais "Chevelu" des navires dans le détroit du Pas de Calais
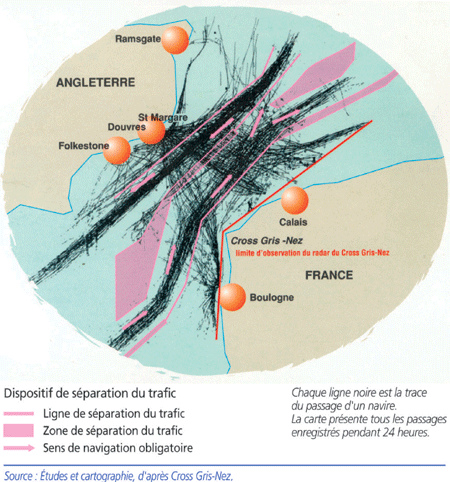
|
 Notes Notes
|
1 - Source : Ademe, Région Nord - Pas-de-calais, 2002.
2 - Sur le territoire métropolitain, la consommation énergétique du transport routier de marchandises a, entre 1990 et 2000, augmenté de 26 %. Dans le même temps, le PIB en volume a augmenté de 20 %.
3 - La livraison de carburant utilisée pour les voitures particulières a augmenté en France de 17 % entre 1990 et 2000 pour une croissance de la population de 3,6 % entre 1990 et 1999.
4 - Entre 1995 et 2000, les émissions de particules (PM10) ont baissé de 8 %, celles de monoxyde de carbone (CO) de 2 %, mais les émissions de composés organiques volatils (COV) et d’oxyde d’azote (NO et NO2) ont légèrement augmenté.
5 - Source : Inrets, 2000.
6 - Aussi bien à Douai qu’à Valenciennes, les enquêtes Ménages déplacements (Source : Certu, 2002) révèlent des taux d’occupation (respectivement 1,46 et 1,43) nettement supérieurs à la moyenne nationale. Sachant que les taux sont généralement plus faibles dans les grandes villes, Lille se caractérise également par un fort taux d’occupation (1,37 personne par véhicule personnel en 1997).
7 - Source : Certu, 2002.
8 - Ce taux peut être comparé à la part de marché de l’automobile dans les autres villes « millionnaires » : Paris (68 % en 1998), Lyon (77 % en 1995) et Marseille (81 % en 1997).
9 - Seuls les Strasbourgeois se déplacent davantage mais la part de marché du vélo parmi les modes mécanisés est trois fois supérieure à celle de Lille et celle des transports collectifs est également supérieure.
10 - La région se situe au 18e rang en termes de PIB/habitant.
11 - En comparaison, la contribution de la région au PIB national n’est que de 5,4 %.
12 - Source : Datar, 2002.
13 - 343 kilomètres pour l’ensemble des flux entrants et 332 kilomètres pour les flux sortants.
14 - Source : Insee, 2000.
15 - Pour les échanges plus lointains, le transport maritime est alors prépondérant, le transport aérien étant réservé aux biens à forte valeur ajoutée. Seulement 38 710 tonnes de fret ont été traitées à l’aéroport de Lille au cours de l’année 2002. Mais il faut noter la forte progression annuelle du tonnage (+ 6 %).
16 - Source : Reclus, 2000.
17 - Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
18 - Le trafic est organisé en autoroutes maritimes qui séparent les flux de sens inverse.
|
|
|