|
 La situation actuelle La situation actuelle |
 Les risques technologiques : un enjeu majeur Les risques technologiques : un enjeu majeur |
|
Par le nombre d’établissements industriels classés à risques élevés, selon la directive européenne « Seveso », la région se place en troisième position derrière Rhône- Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par risques, on entend :
• les risques toxiques résultant de la libération de gaz toxiques (éclatement ou rupture d’une canalisation) ;
• les risques d’explosion liés notamment aux installations de gaz combustibles liquéfiés ou à l’utilisation et au stockage d’explosifs ;
• les risques thermiques liés par exemple au stockage de liquides inflammables de grande capacité.
Entre 1992 et 2001, 343 accidents, dont l’intensité varie entre le niveau 0 (anomalie) et le niveau 4 (accident important) sur une échelle de gravité mise au point par l’Union européenne et l’OCDE  1., sont survenus dans les usines de la région. La majorité des événements répertoriés sont d’un niveau de gravité faible (anomalie ou incident), mais il peut se produire des accidents particulièrement graves comme dans le cas de l’explosion survenue le 27 mars 2003 à l’usine Nitrochimie de Billy-Berclau dans le Pas-de-Calais. Cet accident a causé la mort de trois personnes et la disparition d’une quatrième. Cette usine, classée Seveso, produit de la dynamite et du nitrate de fioul dans un site de soixante-dix hectares où travaillent une centaine de personnes. Le plan d’opération interne (POI) a tout de suite été déclenché et les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont pu éteindre les foyers d’incendie. 1., sont survenus dans les usines de la région. La majorité des événements répertoriés sont d’un niveau de gravité faible (anomalie ou incident), mais il peut se produire des accidents particulièrement graves comme dans le cas de l’explosion survenue le 27 mars 2003 à l’usine Nitrochimie de Billy-Berclau dans le Pas-de-Calais. Cet accident a causé la mort de trois personnes et la disparition d’une quatrième. Cette usine, classée Seveso, produit de la dynamite et du nitrate de fioul dans un site de soixante-dix hectares où travaillent une centaine de personnes. Le plan d’opération interne (POI) a tout de suite été déclenché et les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont pu éteindre les foyers d’incendie.
Les risques occasionnés par la société Metaleurop à Noyelles-Godault sont d’une autre nature. Les émissions de plomb imprègnent en effet durablement les sols des cinq communes situées autour de Metaleurop  2. [voir le chapitre Industrie]. Différentes études ont été réalisées afin de dépister les cas de saturnisme infantile dans les cinq communes situées autour de Noyelles-Godault. Une première étude, effectuée en 1994-1995 par l’Observatoire régional de la santé (ORS) auprès de 621 enfants 2. [voir le chapitre Industrie]. Différentes études ont été réalisées afin de dépister les cas de saturnisme infantile dans les cinq communes situées autour de Noyelles-Godault. Une première étude, effectuée en 1994-1995 par l’Observatoire régional de la santé (ORS) auprès de 621 enfants  3. de moins de six ans, révélait des taux de plombémie supérieurs à 100 µg de plomb par litre de sang (valeur guide : 100 µg/l pour une moyenne française de 34 µg/l) chez 13 % d’entre eux. Cette proportion atteignait 24 % parmi les enfants résidant à moins de 1 km du site. Un second programme de dépistage étendu aux cinq communes avoisinant l’usine a fait le même constat : sur 270 enfants dépistés, 10 % avaient une plombémie supérieure ou égale à 100 µg/l ; ce taux grimpe à 31 % chez les enfants d’Evin-Malmaison (la commune la plus proche). Une plombémie comprise entre 100 et 400 µg/l entraîne des troubles du développement psychomoteur ou intellectuel et des troubles du comportement chez l’enfant. 3. de moins de six ans, révélait des taux de plombémie supérieurs à 100 µg de plomb par litre de sang (valeur guide : 100 µg/l pour une moyenne française de 34 µg/l) chez 13 % d’entre eux. Cette proportion atteignait 24 % parmi les enfants résidant à moins de 1 km du site. Un second programme de dépistage étendu aux cinq communes avoisinant l’usine a fait le même constat : sur 270 enfants dépistés, 10 % avaient une plombémie supérieure ou égale à 100 µg/l ; ce taux grimpe à 31 % chez les enfants d’Evin-Malmaison (la commune la plus proche). Une plombémie comprise entre 100 et 400 µg/l entraîne des troubles du développement psychomoteur ou intellectuel et des troubles du comportement chez l’enfant.
| |
|
 Les activités à risques Les activités à risques
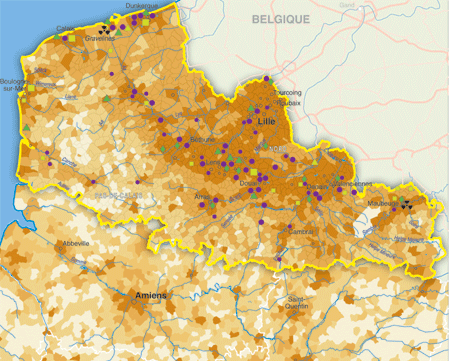
|
|
|
| |
|
 Les accidents technologiques Les accidents technologiques
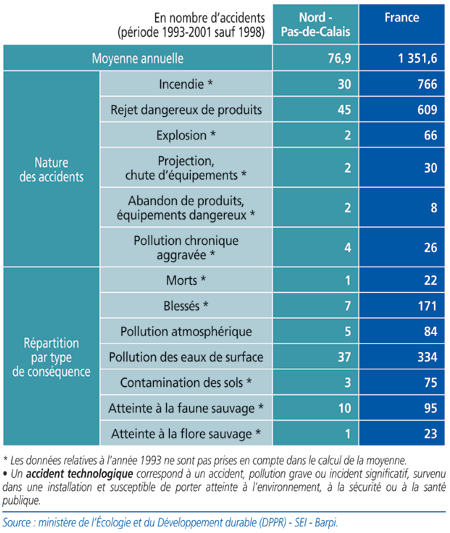
|
| |
|
 Les installations à risques Les installations à risques
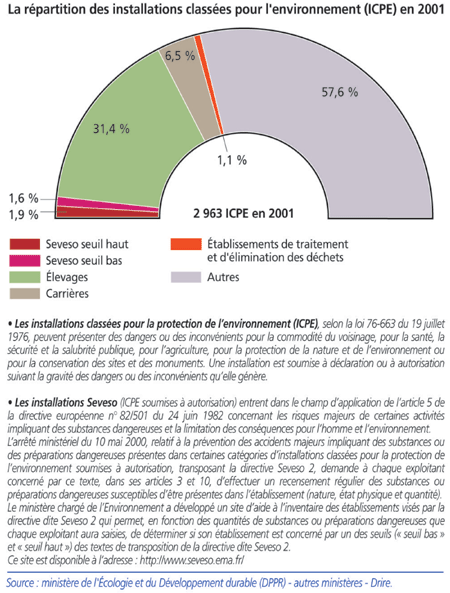
|
 Les inondations : un nombre élevé de communes à risques Les inondations : un nombre élevé de communes à risques |
|
Ce sont les inondations de plaine qui semblent les plus préoccupantes. En effet, le temps de submersion particulièrement long lié à la faiblesse du relief occasionne dans bien des cas des dommages importants aux biens matériels.
Les principaux cours d’eau concernés sont la Sambre et ses affluents, la Lys et ses affluents, l’Aa, la Liane et la Canche et, dans une moindre mesure, la Slack, le Wimereux, l’Authie, la Hem, l’Yser, la Marque, la Scarpe et les affluents de l’Escaut.
Entre 1982 et 2002, 462 communes du Nord  4. et 560 du Pas-de-Calais 4. et 560 du Pas-de-Calais  5. ont été concernées par une inondation (arrêté de catastrophe naturelle). Pour l’ensemble de la région, en 2002, seulement 46 communes avaient intégré dans leurs documents d’urbanisme les prescriptions des plans de prévention des risques (PPR). 5. ont été concernées par une inondation (arrêté de catastrophe naturelle). Pour l’ensemble de la région, en 2002, seulement 46 communes avaient intégré dans leurs documents d’urbanisme les prescriptions des plans de prévention des risques (PPR).
La plaine de la Flandre maritime est une zone particulièrement sensible aux inondations avec ses wateringues qui concernent près de 30 % du territoire de la côte d’Opale. À marée haute, le niveau d’eau des terres les plus basses est inférieur de 4 à 5 mètres à celui de la mer et des pompes de relèvement sont indispensables pour évacuer les eaux. Dans ce secteur, le risque provient essentiellement d’incidents graves sur les ouvrages d’évacuation à la mer et les écluses fluviales.
Enfin, il convient de souligner le cas particulier des risques d’inondation dus à l’extraction minière. La cessation de toute activité liée au charbon a entraîné l’effondrement des galeries d’extraction et des affaissements de la surface du sol provoquant l’apparition de cuvettes topographiques parfois étendues, dans lesquelles les eaux de ruissellement se sont accumulées et ont créé des zones marécageuses.
Pour combattre les inondations, les Houillères du bassin Nord - Pas-de-Calais ont installé pas moins de 62 stations de relevage des eaux réparties sur une bande de 15 km du nord au sud et de 80 km d’ouest en est. Les zones inondables du bassin houiller couvrent 5 400 hectares dans le Nord et 600 hectares dans le Pas-de-Calais.
 L’érosion côtière : un phénomène à prendre au sérieux L’érosion côtière : un phénomène à prendre au sérieux |
|
Le littoral de la côte d’Opale s’étend sur quelque 156 km, dont 25 km de côtes à falaises et 125 km de côtes dunaires basses. Sous l’action de la mer, du vent et des eaux continentales, ce littoral évolue en permanence, ce qui se traduit par l’avancée ou le recul du trait de côte. À l’image du littoral français, la côte d’Opale est actuellement victime d’un phénomène érosif important comme en témoigne l’important recul du trait de côte à l’ouest de Sangatte. L’ensemble, constitué par les falaises du Boulonnais, entrecoupées de remarquables massifs dunaires et estuaires, demeure en effet le secteur le plus préoccupant en termes d’érosion côtière, avec en particulier les sites de Wissant et de Wimereux.
Un schéma de conservation et de gestion du trait de côte sur le littoral de la côte d’Opale, engagé sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte de la côte d’Opale, aux côtés d’Espace naturel régional en collaboration avec les services de l’État, est destiné à prédire l’évolution future du littoral et à estimer la valeur des biens potentiellement menacés pour proposer des solutions de gestion.
Les coûts associés à la protection côtière sont variables et dépendent des techniques employées (180 euros le mètre pour des pieux en bois et jusqu’à 1 500 euros le mètre pour une digue). En Nord - Pas-de-Calais, sur dix années d’aménagement (de 1984 à 1994), les sommes dépensées se montent à environ 15,2 millions d’euros avec une forte proportion investie dans la construction des ouvrages.
 Les mouvements de terrain : craie et argiles en cause Les mouvements de terrain : craie et argiles en cause |
|
Un grand nombre de communes de la région seraient concernées par le risque de mouvement de terrain lié aux anciennes carrières d’exploitation souterraine de craie phosphatée. Un inventaire réalisé par le BRGM (2003) dans le Pas-de-Calais montre l’ampleur du phénomène : la quasi-totalité des communes du département sont sujettes à des risques d’effondrement. La fréquence des incidents a conduit plus de 200 communes à mettre en place un Syndicat mixte pour la surveillance des cavités souterraines. Dans ce département, les notaires conseillent aux acquéreurs de biens immobiliers de se renseigner sur l’existence de cavités souterraines dans la propriété dont ils visent l’achat.
Un autre problème préoccupant concerne le « retrait gonflement » des sols argileux. Après des périodes de pluie, certains sols argileux se rétractent sous l’effet de la sécheresse en causant des dégâts parfois importants aux habitations. Le département du Nord fait partie des tout premiers territoires affectés par ce phénomène en France (après ceux de l’Île-de-France) avec 170 communes concernées et 2 500 à 3 000 sinistres chaque année.
 Notes Notes
|
1 - Cette échelle varie de 0 (anomalie) à 7 (catastrophe).
2 - Courcelles, Evin-Malmaison, Noyelles-Godault, Declerq et Leforest.
3 - Soit un tiers des enfants concernés.
4 - Le département du Nord compte 653 communes.
5 - Le département du Pas-de-Calais compte 894 communes
|
|
|