|
 Les enjeux Les enjeux |
 Un renouvellement urbain nécessaire Un renouvellement urbain nécessaire |
|
La région urbaine se caractérise par un accroissement
des disparités spatiales et des enjeux urbains qui diffèrent d’une
ville à l’autre. Certaines villes tirent leur épingle du jeu (comme
Lille, Arras, Dunkerque et Saint-Omer) alors que les villes du bassin
minier et celles de l’est de la région connaissent des difficultés
persistantes. Pour la métropole lilloise, il s’agit plutôt de mettre
en œuvre une gestion plus équilibrée du territoire, de renforcer
les pôles d’excellence et de favoriser un système de déplacement
plus efficace et plus durable. Pour le bassin minier, marqué par
un marché du logement atone et une surreprésentation des logements
publics, les enjeux sont plutôt la requalification du cadre de vie,
l’environnement et la gestion future du territoire. À Dunkerque,
où l’industrie, l’habitat et les infrastructures composent des micro-territoires
déstructurés et sans grande qualité urbaine, l’objectif est surtout
d’achever la restructuration de l’espace tout en développant l’économie.
La nécessité de restructurer et de renouveler le tissu urbain est
un point commun que partagent la plupart des villes de la région.
C’est donc la région urbaine dans son ensemble, y compris l’agglomération
lilloise, qui est concernée par la reconquête de son cadre de vie
urbain (requalification, traitement des friches, mise en conformité
de l’habitat, espaces verts, etc.), ce qui suppose la recherche
de l’esthétique du paysage urbain et l’embellissement de certains
espaces publics pour lesquels de nombreux outils réglementaires
ou contractuels existent : plan local d’urbanisme, zone de protection
du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), contrat
d’agglomération, pays urbains, etc.
Les agglomérations doivent faire
face également à des problèmes de
ségrégation sociale sur leur territoire.
L’enjeu ne concerne pas seulement
les grands ensembles urbains
nés dans les années soixante-dix
mais aussi la réhabilitation de quartiers
entiers, souvent plus anciens,
dans les villes et les agglomérations
industrielles de la région. Face à l’ampleur
des difficultés, le contrat de
plan État-Région 2000-2006 prévoit
de consacrer 236 millions d’euros
à la politique de la ville, dont une
grande partie pour améliorer la qualité
et le cadre de vie dans ces quartiers.
Par ailleurs, la région compte
six grands projets de ville (GPV)  7 et
deux opérations de renouvellement
urbain (ORU) 7 et
deux opérations de renouvellement
urbain (ORU)  8. L’Institut régional
de la ville (IREV) 8. L’Institut régional
de la ville (IREV)  9, potentiellement
lieu d’échanges, de formation et
d’information sur tous les grands
enjeux de la société urbaine, en
particulier sur les questions du développement
d’une ville « durable », a
pour vocation la qualification des
acteurs (élus, techniciens, associatifs,
habitants), la capitalisation des projets
et des méthodes et l’évaluation
des actions. 9, potentiellement
lieu d’échanges, de formation et
d’information sur tous les grands
enjeux de la société urbaine, en
particulier sur les questions du développement
d’une ville « durable », a
pour vocation la qualification des
acteurs (élus, techniciens, associatifs,
habitants), la capitalisation des projets
et des méthodes et l’évaluation
des actions.
 La faiblesse des centralités La faiblesse des centralités |
|
La région vit un paradoxe : sa population est à
forte dominante urbaine mais son projet urbain reste
à construire. La ville est en crise pour avoir délaissé ses
fonctions d’urbanité. D’après les premiers travaux du
schéma régional d’aménagement et de développement
du territoire  10, à l’aune des critères urbains, la plupart
des villes de la région présentent des signes de faiblesse.
Historiquement, elles sont constituées d’un assemblage
de quartiers autour des centres de production et ne
présentent pas de fonctions de centralité bien articulées.
Elles ont souvent hérité d’une structure urbaine
dispersée, où l’urbanisation s’est faite au service exclusif
de pratiques et d’industries aujourd’hui disparues. La
faiblesse des centralités est une spécificité régionale
qui pose problème au regard de l’objectif de développement
durable. L’étalement urbain menace la qualité
de vie. Il entraîne l’augmentation des déplacements mais
aussi, de manière connexe, la transformation des espaces
ruraux et des milieux naturels en aire de loisirs urbains.
Le renforcement des centralités suppose une offre
d’équipements et de services adaptés, mais aussi une
politique de l’habitat à même de répondre à la demande
de la population. Le patrimoine du bassin minier pourrait
répondre à cet objectif sous réserve de rénovation 10, à l’aune des critères urbains, la plupart
des villes de la région présentent des signes de faiblesse.
Historiquement, elles sont constituées d’un assemblage
de quartiers autour des centres de production et ne
présentent pas de fonctions de centralité bien articulées.
Elles ont souvent hérité d’une structure urbaine
dispersée, où l’urbanisation s’est faite au service exclusif
de pratiques et d’industries aujourd’hui disparues. La
faiblesse des centralités est une spécificité régionale
qui pose problème au regard de l’objectif de développement
durable. L’étalement urbain menace la qualité
de vie. Il entraîne l’augmentation des déplacements mais
aussi, de manière connexe, la transformation des espaces
ruraux et des milieux naturels en aire de loisirs urbains.
Le renforcement des centralités suppose une offre
d’équipements et de services adaptés, mais aussi une
politique de l’habitat à même de répondre à la demande
de la population. Le patrimoine du bassin minier pourrait
répondre à cet objectif sous réserve de rénovation  11. 11.
| |
 L’occupation
artificielle des sols en 2002 L’occupation
artificielle des sols en 2002
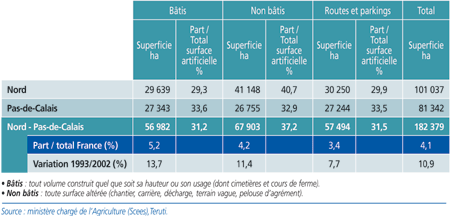
|
 Recycler l’espace Recycler l’espace |
|
L’abandon ou le déplacement des activités économiques
s’est traduit par la présence de 10 000 hectares
de friches dans la région en 1993, soit près de 50 % des
friches industrielles françaises  12. Affrontant un lourd
héritage, le Nord - Pas-de-Calais a mené une politique
active de résorption des friches industrielles. Cependant,
si de très grandes friches minières et sidérurgiques
ont aujourd’hui disparu, ce n’est pas le cas d’espaces
dégradés en zones urbaines, moins étendus mais plus
sensibles sur le plan de l’environnement et donc plus
complexes à traiter. Pourtant, la maîtrise de l’étalement
urbain et la lutte contre le mitage du territoire passent
par le « recyclage » de ces espaces dégradés ainsi que
par la reconstruction « de la ville sur la ville ». Ainsi, le
schéma directeur de Lille, qui limite l’extension de l’urbanisation
à 3 500 hectares 12. Affrontant un lourd
héritage, le Nord - Pas-de-Calais a mené une politique
active de résorption des friches industrielles. Cependant,
si de très grandes friches minières et sidérurgiques
ont aujourd’hui disparu, ce n’est pas le cas d’espaces
dégradés en zones urbaines, moins étendus mais plus
sensibles sur le plan de l’environnement et donc plus
complexes à traiter. Pourtant, la maîtrise de l’étalement
urbain et la lutte contre le mitage du territoire passent
par le « recyclage » de ces espaces dégradés ainsi que
par la reconstruction « de la ville sur la ville ». Ainsi, le
schéma directeur de Lille, qui limite l’extension de l’urbanisation
à 3 500 hectares  13, ne pourra tenir cet objectif
qu’en redensifiant son tissu urbain et en réutilisant des
friches ou des espaces dégradés. Certaines villes, comme
Dunkerque avec la reconquête de l’ancien chantier
naval, se sont déjà engagées dans de vastes programmes
de restructuration urbaine et de recyclage de l’espace. 13, ne pourra tenir cet objectif
qu’en redensifiant son tissu urbain et en réutilisant des
friches ou des espaces dégradés. Certaines villes, comme
Dunkerque avec la reconquête de l’ancien chantier
naval, se sont déjà engagées dans de vastes programmes
de restructuration urbaine et de recyclage de l’espace.
 Développer la trame verte Développer la trame verte |
|
La trame verte est constituée d’espaces verts, boisés
ou en culture pouvant jouer un rôle paysager, de corridors
biologiques, de préservation des milieux ou de création
d’espaces de loisirs. Ce sont d’anciens sites industriels
ou miniers « renaturés », des espaces boisés, des espaces
verts ou des liaisons vertes le long des rivières ou canaux.
La requalification d’anciennes friches minières ou industrielles
a permis de constituer des espaces naturels au
cœur du tissu urbain ou périurbain, notamment dans le
bassin minier. Avec les massifs boisés et les espaces agricoles,
les parcs et les jardins sont les espaces de « respiration
» essentiels au bien-être de la population, dans une
région où les villes présentent un déficit d’espaces verts
et récréatifs. C’est notamment le cas de l’agglomération
lilloise où, malgré les efforts des pouvoirs publics pour
développer la trame verte et bleue  14, les espaces verts
ne parviennent pas à répondre à une demande sociale
qui augmente avec la population. 14, les espaces verts
ne parviennent pas à répondre à une demande sociale
qui augmente avec la population.
 L’importance de l’agriculture périurbaine L’importance de l’agriculture périurbaine |
|
En Nord - Pas-de-Calais, la question urbaine est liée
de manière très étroite à celle de l’espace rural. Les espaces
ruraux font partie du cadre de vie et de l’identité
régionale, y compris pour les urbains. Dans une région
aussi urbanisée et densément peuplée, ils assurent des
fonctions diversifiées : production agricole, production
d’aménités, usages récréatifs, etc. Avec seulement 12,3 %
d’espaces naturels (Teruti), la région offre peu d’espaces
pour les loisirs de la population. Elle est d’ailleurs au dernier
rang des régions françaises pour la surface forestière
pour mille habitants : 21 ha contre une moyenne nationale
de 235 ha (Inventaire forestier national). Dans ce
contexte, les zones agricoles, insérées au sein des zones
urbaines, constituent les espaces « de respiration » qui
structurent et ouvrent le paysage. Même si la pression
urbaine sur les espaces ruraux est aujourd’hui moins
prégnante que dans les années quatre-vingt-dix, ils peuvent
encore être localement menacés. C’est notamment
le cas aux abords de l’agglomération lilloise, en pleine
expansion, où l’agriculture urbaine joue plusieurs rôles :
maintien des emplois liés au maraîchage, préservation
des espaces naturels contre la périurbanisation, création
d’aménités pour les citadins, ouverture du paysage. C’est
pourquoi son schéma directeur [voir le chapitre Agriculture]
prévoit de conserver à l’agriculture au moins 50 % du
territoire de l’arrondissement, soit 44 000 hectares en
2015. La dynamique actuelle de constitution de schémas
de cohérence territoriale (Scot) et de pays urbains  15,
englobant l’urbain et le rural dans un même projet de
développement, est essentielle. En facilitant l’émergence
d’un projet commun de territoire, elle devrait favoriser
une gestion économe de l’espace. 15,
englobant l’urbain et le rural dans un même projet de
développement, est essentielle. En facilitant l’émergence
d’un projet commun de territoire, elle devrait favoriser
une gestion économe de l’espace.
 Une forte pression urbaine et industrielle sur le littoral Une forte pression urbaine et industrielle sur le littoral |
|
Même si elle tend à se stabiliser, la pression urbaine
sur le littoral se situe déjà à un niveau très élevé. Deux
zones urbanisées se distinguent de part et d’autre du cap
Gris-Nez : la plaine littorale de Calais à Dunkerque et le
Boulonnais au sud de la côte d’Opale (de Boulogne-sur-
Mer à Berck). D’après le diagnostic de territoire réalisé
pour le programme de démonstration sur l’aménagement
intégré des zones côtières  16, sur 147 kilomètres de littoral,
71 kilomètres du linéaire côtier (48 %) sont urbanisés
ou industrialisés. Le littoral du Nord - Pas-de-Calais est
la deuxième région côtière française la plus densément
peuplée (près de 700 habitants/km2) après la Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Les espaces artificialisés représentent
près du tiers de la superficie des 36 communes littorales.
L’analyse de l’occupation du sol, entre 1977 et 1992, a
montré la croissance de l’urbanisation (+ 15,7 %) dans
une bande littorale de deux kilomètres. Cette urbanisation
ne semble pas ralentir puisque l’analyse actuelle des
zones urbanisables dans les plans d’occupation des sols 16, sur 147 kilomètres de littoral,
71 kilomètres du linéaire côtier (48 %) sont urbanisés
ou industrialisés. Le littoral du Nord - Pas-de-Calais est
la deuxième région côtière française la plus densément
peuplée (près de 700 habitants/km2) après la Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Les espaces artificialisés représentent
près du tiers de la superficie des 36 communes littorales.
L’analyse de l’occupation du sol, entre 1977 et 1992, a
montré la croissance de l’urbanisation (+ 15,7 %) dans
une bande littorale de deux kilomètres. Cette urbanisation
ne semble pas ralentir puisque l’analyse actuelle des
zones urbanisables dans les plans d’occupation des sols  17 laisse présager sur l’ensemble des communes littorales
une augmentation de 33 % des espaces artificialisés. En
2000, au moment où a été réalisé le
diagnostic de la côte d’Opale, seulement
neuf communes sur les trentesix
communes littorales que compte
la région avaient un plan d’occupation
des sols compatible avec la loi
« littoral ». À l’exception des espaces
naturels encore préservés, la côte
est désormais un grand ensemble
urbain. Cette pression est renforcée
par le tourisme mais aussi par de
grandes infrastructures majeures,
comme le tunnel sous la Manche,
et par les activités industrielles, notamment avec la zone
industrialo-portuaire de Dunkerque, qui s’étalent sur plus
d’une dizaine de kilomètres. Cependant, on peut penser
que les futurs schémas de cohérence territoriale 17 laisse présager sur l’ensemble des communes littorales
une augmentation de 33 % des espaces artificialisés. En
2000, au moment où a été réalisé le
diagnostic de la côte d’Opale, seulement
neuf communes sur les trentesix
communes littorales que compte
la région avaient un plan d’occupation
des sols compatible avec la loi
« littoral ». À l’exception des espaces
naturels encore préservés, la côte
est désormais un grand ensemble
urbain. Cette pression est renforcée
par le tourisme mais aussi par de
grandes infrastructures majeures,
comme le tunnel sous la Manche,
et par les activités industrielles, notamment avec la zone
industrialo-portuaire de Dunkerque, qui s’étalent sur plus
d’une dizaine de kilomètres. Cependant, on peut penser
que les futurs schémas de cohérence territoriale  18 et les
plans locaux d’urbanisme seront à même d’enrayer cette
tendance à l’urbanisation et l’artificialisation. 18 et les
plans locaux d’urbanisme seront à même d’enrayer cette
tendance à l’urbanisation et l’artificialisation.
 Des améliorations notables Des améliorations notables |
|
Globalement, l’environnement urbain s’améliore.
La reconquête urbaine est en marche. Les friches sont
requalifiées petit à petit, notamment grâce à l’action
de l’Établissement public foncier. Un important programme
d’amélioration de l’habitat avec démolition
mais aussi réhabilitation et reconstruction a été lancé :
de 1997 à 2000, 3 250 logements sociaux ont été réalisés
en moyenne chaque année et l’achèvement de la réhabilitation
des cités minières est prévu pour 2006. Sous
l’impulsion du conseil régional, la filière « haute qualité
environnementale » pour le bâtiment s’est structurée. Le
tri sélectif des déchets progresse et désormais plus de
deux millions d’habitants disposent d’une collecte des
recyclables. Les caractéristiques de la pollution atmosphérique
de la région évoluent : la pollution d’origine
industrielle diminue, notamment en ce qui concerne
les émissions de dioxyde de soufre. Les plans de déplacement
urbain des grandes villes de la région mettent
l’accent sur les transports collectifs. Celui de Lille prévoit
de stabiliser le trafic automobile généré par les habitants
et de doubler l’usage des transports en commun à l’horizon
2015. Des efforts considérables  19 en faveur des
déplacements interurbains par train ont été réalisés. Le
train fonctionne désormais comme un transport urbain.
Ainsi, sur l’axe le plus fréquenté (Lille, Valenciennes,
Maubeuge), les trains sont plus fréquents (40 % de trains
supplémentaires depuis 1998) et plus rapides. Le résultat
ne s’est pas fait attendre, la fréquentation a augmenté
de 12,5 % en deux ans. 19 en faveur des
déplacements interurbains par train ont été réalisés. Le
train fonctionne désormais comme un transport urbain.
Ainsi, sur l’axe le plus fréquenté (Lille, Valenciennes,
Maubeuge), les trains sont plus fréquents (40 % de trains
supplémentaires depuis 1998) et plus rapides. Le résultat
ne s’est pas fait attendre, la fréquentation a augmenté
de 12,5 % en deux ans.
 Notes Notes
|
7 - Lille-Roubaix-Tourcoing,
Lens-Liévin, Valenciennes, Dunkerque, Maubeuge
et Boulogne-sur-Mer.
8 - Calais et Bruay-La-Buissière.
9 - Il s’agit d’un groupement d’intérêt
public créé en 1999 par l’État,
le conseil régional et les conseils généraux
du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que la Caisse de
dépôts et consignations.
10 - Schéma régional d’aménagement
et de développement du territoire, 2002. Rapport
de synthèse du groupe « Région urbaine
».
11 - Cette idée est évoquée dans
les travaux du SRADT.
12 - Il n’en restait plus que 5 000 hectares en
1997. Aucun nouvel inventaire n’a été
réalisé depuis.
13 - Chiffre déjà très élevé.
14 - La trame bleue représente les espaces naturels
et récréatifs situés le long des
rivières et canaux : plan paysager de la Lys,
vallée de la Deûle et de la Marque, canal
de Roubaix, etc.
15 - Des pays urbains sont en cours d’élaboration
à Boulogne, Calais, Saint-Omer, Sambre-Avesnois,
Arras, etc.
16 - Diagnostic de territoire de la côte d’Opale,
septembre 2000.
17 - Zones NA, Zac, et NDb dans la partie nord.
18 - Comme, par exemple, celui du Dunkerquois qui est
en cours d’élaboration.
19 - SNCF et conseil régional.
|
|
|