| |
 Sommaire Sommaire |
 |
|
 Des formes spécifiques d’action publique en matière de concertation Des formes spécifiques d’action publique en matière de concertation |
Au début des années quatre-vingt-dix, la région cumulait les handicaps : aux séquelles environnementales liées au passé industriel s’ajoutait le déclin économique dû à la fin de ces activités. Les dommages environnementaux mettaient en péril le redémarrage économique de la région et, notamment, celui du bassin minier. Victime de son image, le Nord - Pas-de-Calais était peu attractif pour les activités. C’est alors que pour dépasser des politiques de reconversion traditionnelles, les acteurs vont chercher, grâce à la concertation, la voie d’un nouveau développement.
| |
|
 Zonages européens, pays et parcs naturels régionaux Zonages européens, pays et parcs naturels régionaux
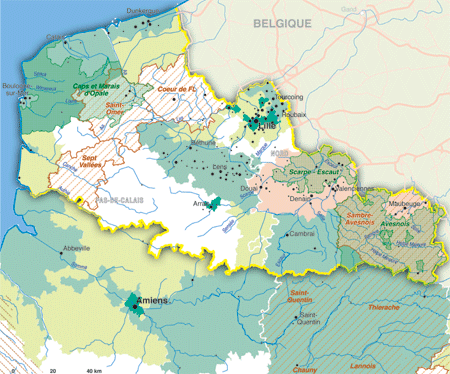
|
|
|
 Des démarches informelles innovantes Des démarches informelles innovantes |
|
Le Centre national de recherche sur les sites et sols pollués (CNRSSP) a été créé à Douai en 1996. Ce centre, qui a pour mission de mettre en place et développer des programmes de recherche sur les sols pollués, d’être une force de proposition au niveau national sur ce thème et de favoriser le transfert de connaissance, regroupe une dizaine de partenaires : industriels, organismes de recherche publics et privés, écoles d’ingénieurs, partenaires institutionnels. Le partenariat institué entre des organismes locaux (conseil régional, École nationale supérieure des techniques industrielles des mines de Douai, Institut Pasteur de Lille) et des organismes nationaux  6 a dynamisé les acteurs régionaux sur ce thème. C’est ainsi que pour répondre au problème majeur des sites et sols pollués, les acteurs de la région ont inventé une structure originale adaptée au contexte local et répondant au besoin de concertation : le pôle de compétence « Sites et sédiments pollués » 6 a dynamisé les acteurs régionaux sur ce thème. C’est ainsi que pour répondre au problème majeur des sites et sols pollués, les acteurs de la région ont inventé une structure originale adaptée au contexte local et répondant au besoin de concertation : le pôle de compétence « Sites et sédiments pollués »  7. Ce lieu d’échange et de débat, ouvert à tout acteur intéressé par cette problématique, a pour mission de trouver des réponses en matière de dépollution et de reconquête des friches industrielles. Sans créer de structure institutionnelle supplémentaire, il cherche à favoriser les synergies, la cohérence et les complémentarités entre acteurs régionaux. Le pôle de compétence est conçu comme un outil d’aide à la décision. 7. Ce lieu d’échange et de débat, ouvert à tout acteur intéressé par cette problématique, a pour mission de trouver des réponses en matière de dépollution et de reconquête des friches industrielles. Sans créer de structure institutionnelle supplémentaire, il cherche à favoriser les synergies, la cohérence et les complémentarités entre acteurs régionaux. Le pôle de compétence est conçu comme un outil d’aide à la décision.
Le renouveau du bassin minier a été marqué, quant à lui, par la conférence permanente du bassin minier (1996), initiée par le conseil régional. Son but était de favoriser l’émergence d’un projet de territoire et d’accompagner le processus de sortie de concession minière. En ouvrant le débat à des citoyens d’horizons divers, cette démarche informelle, qui s’est traduite par un document de synthèse « Le Livre blanc : une ambition partagée pour l’après-charbon »  8, a encouragé l’expression locale. Par son approche globale, cette démarche a permis au bassin minier, territoire jusqu’alors morcelé et affaibli par son histoire, de se construire une vision partagée, vecteur d’un nouveau développement. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Lors du Comité interministériel d’Aménagement et de Développement du territoire (CIADT) du 15 décembre 1998, l’État a décidé d’apporter son soutien financier au bassin minier. Cet effort s’est ensuite poursuivi au travers du volet « Après-mine » du contrat de plan État-Région 8, a encouragé l’expression locale. Par son approche globale, cette démarche a permis au bassin minier, territoire jusqu’alors morcelé et affaibli par son histoire, de se construire une vision partagée, vecteur d’un nouveau développement. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Lors du Comité interministériel d’Aménagement et de Développement du territoire (CIADT) du 15 décembre 1998, l’État a décidé d’apporter son soutien financier au bassin minier. Cet effort s’est ensuite poursuivi au travers du volet « Après-mine » du contrat de plan État-Région  9 (CPER) avec notamment la création de la mission bassin minier. 9 (CPER) avec notamment la création de la mission bassin minier.
Cet inventaire n’est pas exhaustif. D’autres initiatives, comme les différentes démarches prospectives informelles menées à l’échelon régional  10 ou au niveau local, pourraient être citées. Dans le val de Sambre et l’Avesnois, par exemple, une réflexion prospective a été menée en 2001. Cet exercice original, qui a impliqué une centaine d’habitants, n’entendait pas se substituer aux acteurs publics : « ces citoyens de bonne volonté » 10 ou au niveau local, pourraient être citées. Dans le val de Sambre et l’Avesnois, par exemple, une réflexion prospective a été menée en 2001. Cet exercice original, qui a impliqué une centaine d’habitants, n’entendait pas se substituer aux acteurs publics : « ces citoyens de bonne volonté »  11 souhaitaient simplement participer au débat sur l’avenir de leur territoire. 11 souhaitaient simplement participer au débat sur l’avenir de leur territoire.
 Notes Notes
|
6 - Ministère chargé de l’Équipement, ministère chargé de l’Industrie, ministère de l’Écologie et du Développement durable, BRGM, Ademe, CEA, VNF, GDF, agences de l’Eau, Charbonnage de France, Écoles nationales supérieures des techniques industrielles des mines de Paris et de Saint-Etienne, Total-Fina-Elf, etc.
7 - Ce pôle est né en 1995 à l’initiative de l’État et du conseil régional. Placé auprès de l’Établissement public foncier, il bénéficie d’un large partenariat financier mobilisant différents services du conseil régional et de l’État, y compris ses établissements publics, l’Ademe, l’Établissement public foncier Nord - Pas-de-Calais et l’agence de l’Eau Artois-Picardie.
8 - Conseil régional et conférence permanente du bassin minier, 1998. Livre blanc : une ambition partagée pour l’après-charbon. Lille.173 p.
9 - Montant financier prévu dans le contrat de plan : 104,9 millions d’euros au total. 65,1 millions d’euros sont apportés par l’État, 26,1 millions d’euros par le conseil régional et 13,7 millions d’euros par les conseils généraux.
10 - Le travail des services de l’État « Une région, des territoires » constitue une référence étayée. Le conseil régional a mené, en 1999, une réflexion prospective définie comme « Un exercice de démocratie » (éditorial de Michel Delebarre). Ce travail a débouché sur un ouvrage : Stevens J.-F., 2000. Petit guide de prospective Nord - Pas-de-Calais 2020. Lille, Éditions de l’Aube Nord, 125 p.
11 - Introduction (page 4) in Loinger G., 2002. Réflexion prospective pour la Sambre- Avesnois 2000-2015. Document de synthèse : contribution du groupe Prospective & Action. Maubeuge, 42 p.
|
|
|
|
|