|
 un climat océanique sans grands contrastes un climat océanique sans grands contrastes |
|
 Des pluies efficaces importantes Des pluies efficaces importantes
L’importance des pluies saisonnières, notamment hivernales, est l’élément déterminant d’une bonne recharge des nappes. Le volume de pluie efficace, c’est-à-dire la part de la pluie qui contribue effectivement à l’alimentation des nappes, est évalué pour le bassin Artois-Picardie à 4 milliards de m3 par an en moyenne  6. Cela peut, a priori, sembler suffisant par rapport aux prélèvements ; pourtant, certains secteurs sont déficitaires. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ces déficits : la variabilité de la pluviométrie selon les saisons et les zones, la nature des sols, la pollution des eaux souterraines 6. Cela peut, a priori, sembler suffisant par rapport aux prélèvements ; pourtant, certains secteurs sont déficitaires. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ces déficits : la variabilité de la pluviométrie selon les saisons et les zones, la nature des sols, la pollution des eaux souterraines  7. qui limitent les possibilités de prélèvements, les besoins considérables en certains points du territoire où se concentrent la population et des activités économiques. C’est pourquoi la marge existante entre les prélèvements et la ressource disponible est faible : environ 10 % à 20 % des prélèvements annuels. 7. qui limitent les possibilités de prélèvements, les besoins considérables en certains points du territoire où se concentrent la population et des activités économiques. C’est pourquoi la marge existante entre les prélèvements et la ressource disponible est faible : environ 10 % à 20 % des prélèvements annuels.
 La qualité de l’air La qualité de l’air |
 Un réseau de surveillance bien développé Un réseau de surveillance bien développé |
|
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par quatre réseaux : Arema Lille Métropole, Aremartois, Aremasse, Opal’air. Il est constitué de deux stations de mesures mobiles et d’environ 80 stations fixes représentant 234 analyseurs d’air implantés sur le territoire régional. Ce réseau est complété par des mesures différées, mises en œuvre par l’école des Mines de Douai, et par certains industriels dans le cadre de la surveillance de l’impact de leurs propres rejets atmosphériques. Il couvre toutes les grandes villes de la région et les grandes zones industrielles : Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Calais, Boulogne-sur-Mer, Béthune, Lens, etc. En cas de forte pollution, une procédure d’alerte se déclenche. Elle permet d’informer le public, notamment les personnes sensibles et les autorités, qui peuvent ainsi prendre des mesures visant à réduire la pollution. La procédure d’alerte concerne trois polluants principaux : le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote (NOx), l’ozone. Les poussières en suspension, le monoxyde de carbone (CO), le benzène, le toluène, les métaux lourds (plomb, cadmium, nickel, arsenic) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont également mesurés. Toutes les données produites par les réseaux sont consultables quotidiennement sur le site Internet des associations  2. 2.
 L’indice ATMO : quelques épisodes de pollution L’indice ATMO : quelques épisodes de pollution |
|
L’indice ATMO est un indicateur synthétique de la qualité de l’air, calculé chaque jour à partir des stations urbaines et périurbaines d’une agglomération. Avec un indice ATMO supérieur ou égal à 6 durant dix-huit jours dans l’année, Dunkerque est l’agglomération la moins bien classée de la région. Cependant, si on compare ces résultats à la moyenne des 52 villes françaises où cet indice est calculé, Dunkerque n’est qu’au quinzième rang et présente des valeurs inférieures à la moyenne  3. La qualité de l’air est globalement bonne la plus grande partie de l’année dans les grandes villes de la région, mais quelques pointes de pollution sont enregistrées chaque année. L’indice 10 correspondant à une très mauvaise qualité de l’air a été atteint dans certaines villes (Dunkerque, Douai, Valenciennes) lors d’un épisode de pollution qui a affecté toute la région au cours de l’hiver 2001. Les teneurs en poussières en suspension, dépassant 124 µg/m3, ont atteint des niveaux records. Même si l’on manque de recul pour se prononcer avec certitude, l’indice n’étant calculé que depuis deux ans dans certaines villes de la région, les teneurs en dioxyde de soufre et en dioxyde d’azote ne semblent pas affecter l’indice ATMO. Cependant, les seuils réglementaires pour l’ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les poussières sont dépassés plusieurs fois dans l’année. À proximité de Dunkerque, les pics de pollution sont surtout liés à un excès de poussières, et plutôt à l’ozone près de Valenciennes, Lille, Lens et Douai. 3. La qualité de l’air est globalement bonne la plus grande partie de l’année dans les grandes villes de la région, mais quelques pointes de pollution sont enregistrées chaque année. L’indice 10 correspondant à une très mauvaise qualité de l’air a été atteint dans certaines villes (Dunkerque, Douai, Valenciennes) lors d’un épisode de pollution qui a affecté toute la région au cours de l’hiver 2001. Les teneurs en poussières en suspension, dépassant 124 µg/m3, ont atteint des niveaux records. Même si l’on manque de recul pour se prononcer avec certitude, l’indice n’étant calculé que depuis deux ans dans certaines villes de la région, les teneurs en dioxyde de soufre et en dioxyde d’azote ne semblent pas affecter l’indice ATMO. Cependant, les seuils réglementaires pour l’ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les poussières sont dépassés plusieurs fois dans l’année. À proximité de Dunkerque, les pics de pollution sont surtout liés à un excès de poussières, et plutôt à l’ozone près de Valenciennes, Lille, Lens et Douai.
 Les pluies acides Les pluies acides |
|
Le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote sont les principales causes des pluies acides dans la région. Les émissions de dioxyde de soufre sont liées à la combustion des combustibles fossiles et de certaines activités industrielles (comme la sidérurgie-métallurgie). En 1995, le Nord - Pas-de-Calais a contribué pour 5,9 % à l’accroissement des pluies acides en France. Ces chiffres sont du même ordre de grandeur que la participation de la région (7 %) à la valeur ajoutée nationale.
 Une forte baisse des émissions de dioxyde de soufre Une forte baisse des émissions de dioxyde de soufre
Le Nord - Pas-de-Calais représentait 8 % des émissions nationales de dioxyde de soufre en 1994  4. L’industrie fournissait à elle seule 80 % des rejets de la région. Aujourd’hui, ses émissions ont considérablement baissé : les rejets de l’industrie régionale estimés à 400 000 tonnes en 1978 n’étaient plus que de 51 930 tonnes en 2001 4. L’industrie fournissait à elle seule 80 % des rejets de la région. Aujourd’hui, ses émissions ont considérablement baissé : les rejets de l’industrie régionale estimés à 400 000 tonnes en 1978 n’étaient plus que de 51 930 tonnes en 2001  5. Cependant, de 1994 à 2000, les émissions de l’industrie et de l’énergie ont diminué moins vite dans la région (- 6 %) 5. Cependant, de 1994 à 2000, les émissions de l’industrie et de l’énergie ont diminué moins vite dans la région (- 6 %)  6 qu’au niveau national (- 30 %) 6 qu’au niveau national (- 30 %)  7. La baisse des émissions de dioxyde de soufre s’explique par le développement de la maîtrise de l’énergie : usage de combustibles moins soufrés, utilisation du gaz à la place du fioul dans les chaufferies urbaines et emploi de procédés d’épuration. 7. La baisse des émissions de dioxyde de soufre s’explique par le développement de la maîtrise de l’énergie : usage de combustibles moins soufrés, utilisation du gaz à la place du fioul dans les chaufferies urbaines et emploi de procédés d’épuration.
La sidérurgie-métallurgie, avec la désulfuration du minerai, et la chimie-pétrole, avec la désulfuration du pétrole, sont responsables de 64 % des émissions industrielles de la région. D’après la Drire, dix-huit établissements, rejetant plus de 500 tonnes de dioxyde de soufre par an, sont à l’origine de 84 % des rejets industriels. Les principaux émetteurs sont : Total Raffinage Distribution à Loon-Plage, Metaleurop Nord  8 à Noyelles-Godault, Sollac Atlantique à Dunkerque, Aluminium Dunkerque à Loon, les centrales thermiques d’EDF à Hornaing et Bouchain. La répartition géographique des émissions dans la région fait ressortir les zones où se concentre l’industrie lourde, notamment la zone industrielle de Dunkerque et le Douaisis. Hormis quelques rares pics de pollution enregistrés dans des stations industrielles, ce polluant n’est plus préoccupant en milieu urbain. 8 à Noyelles-Godault, Sollac Atlantique à Dunkerque, Aluminium Dunkerque à Loon, les centrales thermiques d’EDF à Hornaing et Bouchain. La répartition géographique des émissions dans la région fait ressortir les zones où se concentre l’industrie lourde, notamment la zone industrielle de Dunkerque et le Douaisis. Hormis quelques rares pics de pollution enregistrés dans des stations industrielles, ce polluant n’est plus préoccupant en milieu urbain.
| |
|
 La contribution de la région à l’accroissement des pluies acides en 1995 La contribution de la région à l’accroissement des pluies acides en 1995
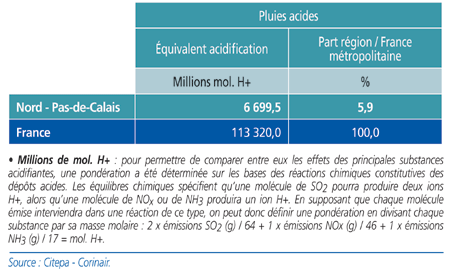
|
| |
|
 Les émissions totales de polluants atmosphériques Les émissions totales de polluants atmosphériques
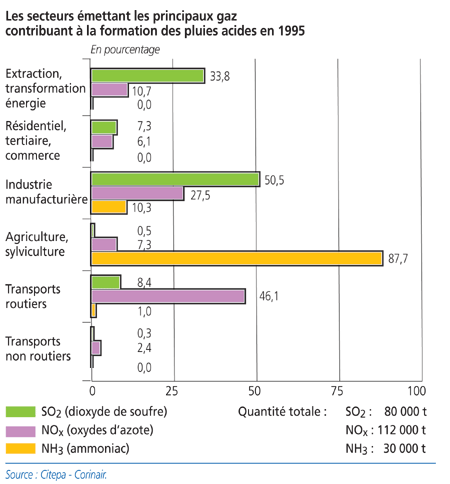
|
 Toujours plus d’oxydes d’azote dans les zones urbaines Toujours plus d’oxydes d’azote dans les zones urbaines
Les rejets d’oxydes d’azote  9 sont principalement émis par les véhicules automobiles et certaines installations industrielles. En 1994, le Nord - Pas-de-Calais représentait 6 % des rejets nationaux 9 sont principalement émis par les véhicules automobiles et certaines installations industrielles. En 1994, le Nord - Pas-de-Calais représentait 6 % des rejets nationaux  10. Les pôles urbains et industriels présentent le taux le plus élevé, notamment les agglomérations de Lille et de Dunkerque ainsi que la zone Lens - Douai - Arras 10. Les pôles urbains et industriels présentent le taux le plus élevé, notamment les agglomérations de Lille et de Dunkerque ainsi que la zone Lens - Douai - Arras  11. Dès que l’on s’éloigne des agglomérations, les concentrations diminuent. En 2001, plusieurs stations de mesures, situées en zones urbaines (Valenciennes, Lille, etc.), ont dépassé la moyenne annuelle 11. Dès que l’on s’éloigne des agglomérations, les concentrations diminuent. En 2001, plusieurs stations de mesures, situées en zones urbaines (Valenciennes, Lille, etc.), ont dépassé la moyenne annuelle  12 de 40 µg/m3 correspondant aux seuils réglementaires. Ces dépassements étaient liés au trafic automobile. Par exemple, l’Arema Lille Métropole estime que 75 % des émissions de l’agglomération lilloise proviennent des transports. Quant aux rejets de l’industrie, ils sont concentrés sur quelques points : la zone industrielle de Dunkerque et l’ouest du bassin minier. La sidérurgiemétallurgie et la chimie-pétrole sont à l’origine de la grande majorité des émissions industrielles. Un établissement, Sollac à Dunkerque, fournit à lui seul un quart des émissions d’oxydes d’azote de l’industrie. 12 de 40 µg/m3 correspondant aux seuils réglementaires. Ces dépassements étaient liés au trafic automobile. Par exemple, l’Arema Lille Métropole estime que 75 % des émissions de l’agglomération lilloise proviennent des transports. Quant aux rejets de l’industrie, ils sont concentrés sur quelques points : la zone industrielle de Dunkerque et l’ouest du bassin minier. La sidérurgiemétallurgie et la chimie-pétrole sont à l’origine de la grande majorité des émissions industrielles. Un établissement, Sollac à Dunkerque, fournit à lui seul un quart des émissions d’oxydes d’azote de l’industrie.
 L’agriculture responsable des émissions d’ammoniac L’agriculture responsable des émissions d’ammoniac
D’après le Citepa, l’agriculture est le grand responsable des émissions d’ammoniac (NH3) dans la région. Elle fournit à elle seule 88 % des rejets d’ammoniac, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale (96 %).
 Les gaz à effet de serre Les gaz à effet de serre  13 13 |
|
 Le dioxyde de carbone (CO2) Le dioxyde de carbone (CO2)
D’après le Citepa, en 1995, la région a contribué pour 7 % à l’effet de serre national. Elle représentait 9 % des émissions nationales de dioxyde de carbone. L’industrie et l’énergie généraient plus de la moitié des rejets alors que ces deux secteurs d’activité ne produisaient que 35 % des émissions nationales. Cette situation résulte du poids de l’industrie lourde et notamment de la production d’aluminium.
| |
|
 La contribution de la région à l’accroissement de l’effet de serre en 1995 La contribution de la région à l’accroissement de l’effet de serre en 1995
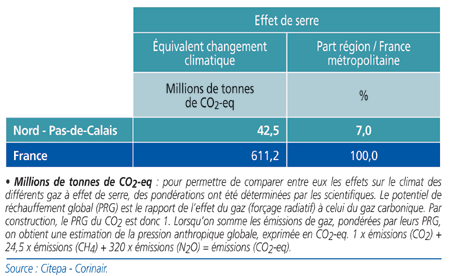
|
| |
|
 Les émissions totales de polluants atmosphériques Les émissions totales de polluants atmosphériques
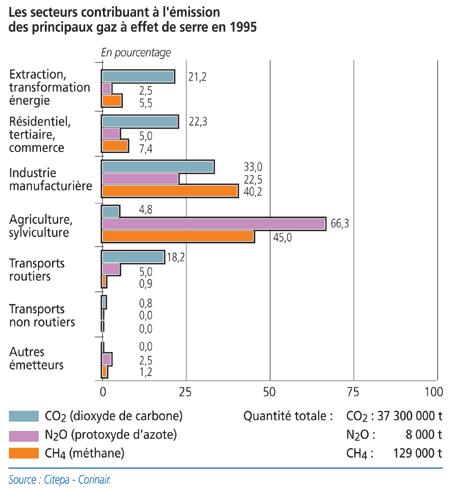
|
 Le méthane (CH4) Le méthane (CH4)
D’après le Citepa, les émissions de méthane proviennent essentiellement de l’agriculture (45 %) et de l’industrie (40 %). La part de l’industrie est pratiquement le double de la moyenne nationale (23 %).
 Le protoxyde d’azote (N2O) Le protoxyde d’azote (N2O)
D’après le Citepa, l’agriculture est responsable de 66 % des émissions de protoxyde d’azote.
 De fortes concentrations d’ozone en zones littorales et rurales De fortes concentrations d’ozone en zones littorales et rurales |
|
L’ozone est un gaz naturellement présent en grande quantité dans les hautes couches de l’atmosphère où il filtre le rayonnement ultraviolet solaire. Dans la basse atmosphère où nous vivons, l’ozone est néfaste pour la santé et l’environnement. C’est un polluant secondaire, formé sous l’action du soleil à partir des oxydes d’azote et des hydrocarbures. Le trafic routier et certaines industries  14 favorisent sa formation. Lorsque l’air est stable avec peu de vent, l’ozone s’accumule et les concentrations augmentent. En raison de l’ensoleillement et de la chaleur, c’est entre mai et septembre que l’on rencontre les teneurs en ozone les plus élevées. 14 favorisent sa formation. Lorsque l’air est stable avec peu de vent, l’ozone s’accumule et les concentrations augmentent. En raison de l’ensoleillement et de la chaleur, c’est entre mai et septembre que l’on rencontre les teneurs en ozone les plus élevées.
Les réseaux de surveillance de la qualité de l’air du nord de la France  15 ont réalisé une étude de grande ampleur en 2000 et 2001. Son objectif était de connaître la répartition spatiale de l’ozone et du dioxyde d’azote. Pour réaliser cette étude, d’importants moyens de mesures ont été mis en œuvre : 200 sites de mesures ont été équipés d’appareils de mesures mais aussi de dispositifs permettant d’évaluer la qualité de celles-ci. 15 ont réalisé une étude de grande ampleur en 2000 et 2001. Son objectif était de connaître la répartition spatiale de l’ozone et du dioxyde d’azote. Pour réaliser cette étude, d’importants moyens de mesures ont été mis en œuvre : 200 sites de mesures ont été équipés d’appareils de mesures mais aussi de dispositifs permettant d’évaluer la qualité de celles-ci.
Les plus fortes concentrations d’ozone sont enregistrées en zones rurales et littorales. Près du littoral, le phénomène de brise de mer, lié à la différence de température entre la mer et la terre, induit une circulation des nappes d’air pollué.
On constate que les zones à forte teneur en dioxyde d’azote, c’est-à-dire les pôles urbains et industriels, ont généralement de faibles teneurs en ozone. Ce phénomène est lié au cycle de formation/destruction de l’ozone  16 : plus il y a d’oxydes d’azote, plus l’ozone tend à être détruit. En conséquence, les sites proches des grands axes routiers ou en centre-ville, c’est-à-dire à proximité des sources d’oxydes d’azote, présentent des niveaux d’ozone moyens moins élevés qu’en périphérie 16 : plus il y a d’oxydes d’azote, plus l’ozone tend à être détruit. En conséquence, les sites proches des grands axes routiers ou en centre-ville, c’est-à-dire à proximité des sources d’oxydes d’azote, présentent des niveaux d’ozone moyens moins élevés qu’en périphérie  17. 17.
Enfin, les conditions météorologiques ont une grande importance. Hors agglomération, les moyennes hebdomadaires de concentration en ozone lors des semaines chaudes et ensoleillées s’échelonnent de 70 à 100 µg/m3 et entre 50 à 70 µg/m3 les semaines pluvieuses (ce qui correspond à la teneur naturelle en ozone). Ces concentrations sont à peu près stables depuis 1998. Néanmoins, les seuils de vigilance  18 et d’information sont dépassés chaque année à plusieurs reprises sans jamais atteindre le seuil d’alerte maximum 18 et d’information sont dépassés chaque année à plusieurs reprises sans jamais atteindre le seuil d’alerte maximum  19. Ces épisodes de pollution durent généralement trois ou quatre jours car ils résultent d’une situation météorologique stable : temps chaud et ensoleillé, absence de vent, anticyclone. 19. Ces épisodes de pollution durent généralement trois ou quatre jours car ils résultent d’une situation météorologique stable : temps chaud et ensoleillé, absence de vent, anticyclone.
| |
|
 La répartition de l’ozone sur le nord de la France du 26 juin au 4 septembre 2000 La répartition de l’ozone sur le nord de la France du 26 juin au 4 septembre 2000
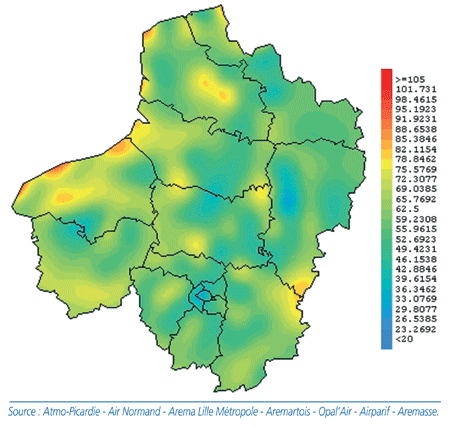
|
 Le monoxyde de carbone (CO) Le monoxyde de carbone (CO) |
|
Les valeurs restent faibles et sont plutôt orientées à la baisse. Le CO provient de la combustion incomplète des combustibles à la sortie des pots d’échappement des véhicules ou des évacuations des appareils de chauffage ; il participe aux mécanismes de formation de l’ozone.
 Une répartition diffuse des composés organiques volatils (COV) Une répartition diffuse des composés organiques volatils (COV) |
|
Les composés organiques volatils (benzène, toluène, xylène) interviennent dans les phénomènes de pollution photochimique. Ils proviennent surtout des transports et des procédés industriels tels que le raffinage du pétrole, le dégraissage des métaux, l’application de peinture et de vernis. Ils se trouvent dans les solvants qui sont à base d’hydrocarbures. Les secteurs de la chimie-pétrole, de la mécanique et de l’imprimerie contribuent à la majorité des émissions industrielles régionales. D’après la Drire, les constructeurs automobiles de la région sont les premiers émetteurs. Les stockages d’hydrocarbures, les raffineries et les industries chimiques sont également à l’origine de rejets diffus, difficiles à quantifier. La grande diversité des sources d’émissions entraîne une répartition diffuse sur le territoire. Toutes les zones industrielles sont concernées : Dunkerque, le bassin minier, la métropole lilloise et la vallée de la Sambre.
En milieu urbain, des mesures sont désormais réalisées. Mais elles sont trop récentes pour en tirer des conclusions. La campagne de mesures effectuées par Aremasse en 2002 montre l’importance du trafic automobile dans les émissions en centre-ville (à Douai et Valenciennes). La pollution en benzène d’origine industrielle autour des grands pôles industriels n’est pas flagrante, hormis pour l’agglomération de Maubeuge qui semble touchée par l’industrie automobile.
 Les poussières, une situation préoccupante Les poussières, une situation préoccupante |
|
Les poussières liées à l’activité humaine proviennent du transport automobile, des procédés industriels mettant en œuvre des produits solides pulvérulents (sidérurgie, fabrication d’engrais, cimenteries, etc.), de l’agriculture, des installations de combustion utilisant des combustibles fossiles (industrie, secteur résidentiel, etc.) ou des déchets (usines d’incinération de déchets ménagers ou industriels). Les effets des poussières sont variables en fonction de leur taille et de leur composition. Les particules les plus fines peuvent transporter des composés toxiques et accentuent les effets des polluants naturels. Le Citepa  20 estime qu’au niveau national, 40 % des poussières proviennent de l’industrie, 33 % de l’agriculture et 16 % des transports. 20 estime qu’au niveau national, 40 % des poussières proviennent de l’industrie, 33 % de l’agriculture et 16 % des transports.
En raison de la multiplicité et de la variabilité des sources dans la région, le profil annuel des poussières en suspension ne met pas en évidence de variations saisonnières significatives. L’hiver, les émissions proviennent plutôt des centrales de combustion et des dispositifs de chauffage ; tout au long de l’année, elles ont pour origine le trafic automobile et l’industrie. Passant de 20 000 à 8 625 tonnes, la quantité de poussières émise par l’industrie régionale a été considérablement réduite entre 1992 et 2001. La sidérurgie est de loin le premier émetteur. Sollac, à Dunkerque, est à l’origine de 40 % des rejets industriels. Malgré des progrès significatifs, la quantité de poussières en suspension reste préoccupante et les dépassements horaires et journaliers sont fréquents. Un épisode de pollution a été enregistré sur toute la région au cours de l’hiver 2001.
 Les métaux toxiques Les métaux toxiques |
|
 Des rejets de plomb liés à l’industrie Des rejets de plomb liés à l’industrie
Depuis l’arrêt de l’essence plombée, les rejets atmosphériques dans la région sont essentiellement liés au traitement des minerais et des métaux (première et deuxième fusion) et en moindre quantité, aux usines d’incinération des ordures ménagères. La toxicité du plomb est très aiguë, notamment chez les enfants. Les rejets de plomb des principales installations industrielles émettrices ont été réduits de 90 % en quinze ans. La région accueille une quinzaine d’établissements utilisateurs de plomb et elle hébergeait, jusqu’à sa fermeture en 2003, l’unique producteur français de plomb à partir du minerai (première fusion) : Metaleurop Nord à Noyelles-Godault. Si la grande majorité des établissements rejette dans l’atmosphère moins d’une tonne de plomb par an, les émissions de deux usines dépassaient les 10 tonnes en 2001 : 13,5 tonnes pour Sollac à Dunkerque, 18,4 tonnes pour Metaleurop. Sous l’impulsion du ministère chargé de l’Environnement, une campagne de mesure a été lancée en 2000 et reconduite les années suivantes. Des sources de plomb inconnues jusqu’alors ont ainsi pu être identifiées et des actions pour limiter les émissions ont été engagées. En 2001, Sollac a réduit ses émissions de 43 %, mais cette baisse est en partie liée à une baisse de production et à l’arrêt d’un haut-fourneau.
 Cadmium, mercure, Nickel Cadmium, mercure, Nickel
Ces trois métaux peuvent avoir plusieurs origines : la métallurgie des non ferreux, les installations d’incinération d’ordures ménagères et de déchets industriels, certains procédés de fabrication. Les mesures des métaux toxiques dans l’air sont opérationnelles sur la métropole lilloise depuis 1984 et viennent d’être lancées sur quelques stations de mesures dans le reste de la région. Il n’existe donc pas d’historique régional.
 Les dioxines et furannes Les dioxines et furannes |
|
Sous le terme de dioxines, on désigne des composés tricycliques chlorés. Un grand nombre de combinaisons sont possibles mais seulement quelques-unes d’entre elles sont toxiques. Les principales causes d’émissions de dioxines et furannes sont la combustion et l’incinération ainsi que l’industrie sidérurgique. Les deux plus gros émetteurs de la région sont Sollac à Dunkerque et l’unité d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de Maubeuge  21. Depuis 1998, première année de mesures effectuées par la Drire, les émissions de dioxines ont été considérablement réduites. D’importants investissements de dépollution ayant été engagés par les industriels, les rejets des seize sites suivis annuellement par la Drire ont globalement diminué de 84 %. 21. Depuis 1998, première année de mesures effectuées par la Drire, les émissions de dioxines ont été considérablement réduites. D’importants investissements de dépollution ayant été engagés par les industriels, les rejets des seize sites suivis annuellement par la Drire ont globalement diminué de 84 %.
 L’acide chlorhydrique L’acide chlorhydrique |
|
Les rejets d’acide chlorhydrique résultent principalement de la combustion du charbon et de l’incinération des ordures ménagères, notamment des plastiques, des caoutchoucs, des papiers et des cartons. Les rejets industriels régionaux d’acide chlorhydrique étaient estimés en 1999 par la Drire à 2 250 tonnes par an. Plus de 80 % de ces émissions résultaient de l’activité des usines d’incinération d’ordures ménagères et le reste de l’utilisation du charbon. Depuis la mise aux normes de ces usines ou de leur fermeture, les rejets d’acide chlorhydrique ont considérablement diminué.
 Les produits fluorés Les produits fluorés |
|
Les principales sources de pollution fluorée sont en Nord - Pas-de-Calais les industries des tuiles et des briques, des céramiques, du verre et surtout de l’aluminium. Depuis 1992, la plus importante source d’émissions fluorées dans la région est l’usine Aluminium Dunkerque. Pourtant, cette usine est l’une des plus performantes au monde en matière de maîtrise des émissions de fluor issues de l’électrolyse. Les équipements antipollution de l’usine correspondent aux meilleures techniques disponibles actuellement. On touche là les limites de la technologie. Quels que soient les investissements réalisés en matière de dépollution, certaines activités, comme la production d’aluminium, restent polluantes.
 Notes Notes
|
2 - Voir http://www.airdesbeffrois.org
3 - Moyenne : indice ATMO supérieur ou égal à 6 durant 19 jours par an.
4 - Inventaire d’émissions dans l’atmosphère dans le cadre des plans régionaux pour la qualité de l’air, Citepa, 1997.
5 - Ces données ne sont pas exhaustives et donc sous-estimées. Ne sont pris en compte que les établissements recensés par la Drire.
6 - Émissions du Nord - Pas-de-Calais : 72 300 tonnes en 1994 et 60 968 tonnes en 2000 (données Drire).
7 - Citepa, 2002. Émissions dans l’air en France. Paris, 17 p.
8 - Cet établissement a fermé en 2003.
9 - Inventaire d’émissions dans l’atmosphère dans le cadre des plans régionaux pour la qualité de l’air, Citepa, 1997.
10 - Idem.
11 - Idem.
12 - 40 µg/m3 est l’objectif de qualité fixé par le décret n° 2002-213.
13 - D’après le protocole de Kyoto, sont considérés comme gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les perfluorocarbures (PFC), les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrofluorocarbures (HFC), les hexafluorures de soufre (SF6).
14 - Oxydes d’azote, monoxyde d’azote (NO), monoxyde de carbone (CO), ainsi que les composés organiques volatils (COV).
15 - S’étaient associés au projet Atmo-Picardie, AirNormand, Arema, Aremartois, Opal’Air, Airparif et Aremasse.
16 - Cycle de formation/destruction de l’ozone : l’ozone s’associe au NO pour former de nouveau du NO2.
17 - En périphérie, en raison de plus faible taux d’oxydes d’azote, l’ozone formé n’est pas détruit au fur et à mesure de sa formation.
18 - Seuil de vigilance : moyenne horaire >= 130 µg/m3 ; seuil d’information : moyenne horaire >= 180 µg/m3 ; seuil d’alerte maximum : moyenne horaire >= 360 µg/m3 (en cours de modification à 240 µg/m3).
19 - En 2001, le niveau d’information a été atteint quatre ou cinq fois dans les grandes villes de la région durant des journées chaudes et ensoleillées (exemple : quatre fois à Lille).
20 - Données 2000.
21 - Le rapport de la Drire Nord - Pas-de-Calais, 2002. L’industrie au regard de l’environnement.Douai, 265 p. évalue les rejets en 2001 à 13 grammes our Sollac et à 8,7 grammes pour l’UIOM de Maubeuge.
|
|
|