|
 La production de substances minérales La production de substances minérales |
 Trois pôles de production de substances minérales Trois pôles de production de substances minérales |
|
En 2002, la région a fourni près de 6 % de la production nationale de substances minérales, soit 24,1 millions de tonnes. Cela représente environ six tonnes par habitant contre une moyenne nationale estimée à environ sept tonnes par habitant  12. La production régionale a été réalisée sur 88 sites : 71 carrières à ciel ouvert et 17 terrils en exploitation. Les grands pôles de production de la région sont les bassins carriers du Boulonnais et de l’Avesnois pour les calcaires durs et le bassin minier pour les schistes issus des terrils. Le département du Pas-de-Calais fournit quasiment les trois quarts de la production régionale (72 %). 12. La production régionale a été réalisée sur 88 sites : 71 carrières à ciel ouvert et 17 terrils en exploitation. Les grands pôles de production de la région sont les bassins carriers du Boulonnais et de l’Avesnois pour les calcaires durs et le bassin minier pour les schistes issus des terrils. Le département du Pas-de-Calais fournit quasiment les trois quarts de la production régionale (72 %).
Depuis 1999, toutes les exploitations de carrières et de terrils (quelle que soit leur date de mise en activité) doivent justifier de garanties financières leur permettant d’assurer la remise en état du site après exploitation. Ces dispositions donnent des moyens accrus aux pouvoirs publics pour assurer la protection de l’environnement et une insertion satisfaisante dans le paysage. Ainsi, en 2002, vingt exploitations ont été remises en état après avoir cessé leurs activités.
| |
|
 La répartition de production de substances minérales La répartition de production de substances minérales
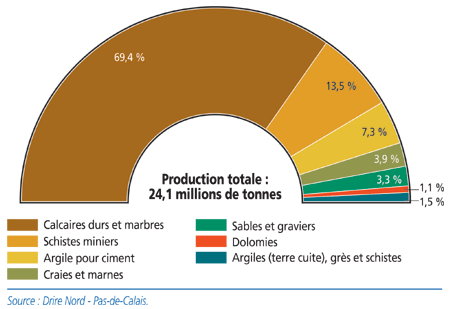
|
| |
|
 L’utilisation des substances minérales produites en 2002 L’utilisation des substances minérales produites en 2002
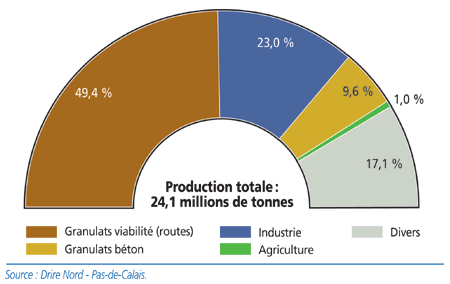
|
 L’après-mine L’après-mine |
Allongé, d’ouest en est, sur 100 km au centre de la région, le bassin minier s’étend sur près de 2 000 km². Le bassin houiller concerne 251 communes. Il a été exploité pendant 270 ans et 2,3 milliards de tonnes de charbon ont été extraites. L’extraction du charbon s’est achevée en 1990 mais les conséquences de l’activité minière ne se sont pas arrêtées le jour de la fin de l’exploitation. Cette activité a laissé des traces indélébiles dans le paysage (terrils, friches, zones humides liées aux eaux d’exhaure) et est à l’origine de certains risques (affaissement minier, grisou, etc.).
 Le renouveau des terrils Le renouveau des terrils |
|
Les terrils façonnent les paysages des régions minières et font partie de leur patrimoine. La région a compté jusqu’à 329 terrils [voir le chapitre Dynamique urbaine], soit environ 515 millions de tonnes de schistes houillers et de cendres. Certains ont brûlé en totalité ou partiellement  13, notamment les plus anciens, d’autres ont été exploités ou ont laissé place à des aménagements urbains. Il en reste actuellement environ cent cinquante qui appartiennent en grande majorité à l’Établissement public foncier (EPF). Mais, l’EPF n’ayant pas vocation à être propriétaire, ces terrils sont désormais à vendre. Ils pourront être rasés pour réaliser des aménagements urbains (zones d’activités, stades, parkings, etc.) et parfois même des parcs d’attraction 13, notamment les plus anciens, d’autres ont été exploités ou ont laissé place à des aménagements urbains. Il en reste actuellement environ cent cinquante qui appartiennent en grande majorité à l’Établissement public foncier (EPF). Mais, l’EPF n’ayant pas vocation à être propriétaire, ces terrils sont désormais à vendre. Ils pourront être rasés pour réaliser des aménagements urbains (zones d’activités, stades, parkings, etc.) et parfois même des parcs d’attraction  14. Certains deviendront des espaces naturels qui participeront à l’armature de la trame verte. Les terrils maintenus doivent alors être mis en sécurité : respect de certaines normes pour l’inclinaison des flancs, mise en œuvre des mesures de protection contre l’érosion (remodelage des pentes, gestion des eaux d’écoulement, végétalisation). Les terrils ne sont pas les seules marques dans le paysage du passé minier de la région. Il reste également des installations de surface liées à l’exploitation minière (dépendances, bâtiments, terrains, matériels d’exploitation) mais aussi à d’autres activités industrielles directement liées à l’exploitation de la houille (cokeries, etc.). 14. Certains deviendront des espaces naturels qui participeront à l’armature de la trame verte. Les terrils maintenus doivent alors être mis en sécurité : respect de certaines normes pour l’inclinaison des flancs, mise en œuvre des mesures de protection contre l’érosion (remodelage des pentes, gestion des eaux d’écoulement, végétalisation). Les terrils ne sont pas les seules marques dans le paysage du passé minier de la région. Il reste également des installations de surface liées à l’exploitation minière (dépendances, bâtiments, terrains, matériels d’exploitation) mais aussi à d’autres activités industrielles directement liées à l’exploitation de la houille (cokeries, etc.).
 Les désordres du sous-sol Les désordres du sous-sol |
|
L’activité minière est à l’origine d’une désorganisation du sous-sol liée aux cavités formées lors de l’extraction. Des cuvettes se sont créées par endroits. Ces affaissements, qui peuvent atteindre plus de dix mètres, ont parfois changé le sens d’écoulement des cours d’eau et généré l’accumulation d’eaux de surface. Pour éviter l’inondation de ces zones, des stations de pompage ont été mises en place afin de relever les eaux et de les rejeter dans le réseau hydrographique. Quand la nappe est proche de la surface, il peut être nécessaire de rabattre l’eau de la nappe afin d’éviter les inondations. À la fin de l’exploitation, 6 000 hectares de zones inondables [voir le chapitre Risques] avaient ainsi été créés (les concessions minières couvraient 136 464 hectares) : au centre du bassin dans le Douaisis et à l’est dans le Valenciennois. Sur les 180 stations de relevage, qui avaient été créées dans la région, il en reste actuellement environ une cinquantaine, certaines ayant pu être arrêtées à la suite d’aménagements.
Les affaissements de terrains sont une autre conséquence de l’exploitation minière. Quand les vides sont comblés par l’effondrement des galeries (encore appelé foudroyage), les mouvements se produisent assez rapidement (environ cinq ans  15 après l’exploitation) mais peuvent être suivis de mouvements résiduels de faible ampleur. L’ennoyage des anciennes galeries est très lent, il est impossible aujourd’hui de dire quand le niveau définitif sera atteint [voir le chapitre Eau]. Pour suivre ce phénomène, un dispositif de surveillance (piézomètres) devra être maintenu pendant une très longue période. Par ailleurs, tant que les travaux ne sont pas complètement ennoyés, le grisou continue à se dégager et le gaz est repoussé au fur et à mesure de la montée des eaux. La présence de grisou nécessite une surveillance permanente, dont le terme n’est pas prévisible. Pour permettre la migration contrôlée de ce gaz et éviter les fuites, des sondages de décompression ont été mis en place dans certains puits. 15 après l’exploitation) mais peuvent être suivis de mouvements résiduels de faible ampleur. L’ennoyage des anciennes galeries est très lent, il est impossible aujourd’hui de dire quand le niveau définitif sera atteint [voir le chapitre Eau]. Pour suivre ce phénomène, un dispositif de surveillance (piézomètres) devra être maintenu pendant une très longue période. Par ailleurs, tant que les travaux ne sont pas complètement ennoyés, le grisou continue à se dégager et le gaz est repoussé au fur et à mesure de la montée des eaux. La présence de grisou nécessite une surveillance permanente, dont le terme n’est pas prévisible. Pour permettre la migration contrôlée de ce gaz et éviter les fuites, des sondages de décompression ont été mis en place dans certains puits.
 Les friches industrielles et les sols pollués Les friches industrielles et les sols pollués |
Après avoir été pendant deux siècles l’une des régions les plus industrielles de France, le Nord - Pas-de-Calais est resté marqué par son passé. L’abandon de certaines activités ou leur déplacement s’est traduit par la présence de friches et de sols pollués. En 1993, la région comptait, au vu des résultats d’inventaires produits par les régions françaises, la moitié des friches françaises (soit 10 000 hectares de friches) et, en 2002, 14 % des sites pollués français connus. Avec 483 sites de sols pollués, le Nord - Pas-de- Calais se plaçait au premier rang des régions françaises (ce chiffre est fonction des données rassemblées). La présence de friches et de sols pollués peut se traduire par des pollutions ponctuelles de nappes ou le gel d’importantes surfaces foncières, qu’il n’est possible de réutiliser qu’après de longs et coûteux travaux de dépollution ou de réhabilitation. Pour toutes ces raisons, la gestion du foncier est un problème majeur en Nord - Pas-de-Calais. Face à l’ampleur du problème, ont été créés l’EPF du Nord - Pas-de-Calais (dont le conseil d’administration est présidé par le conseil régional) et, ultérieurement, le pôle de compétence « Sites et sédiments pollués ». Ce pôle développe l’information et la connaissance dans le domaine des sols et sédiments pollués afin de proposer des solutions adaptées et innovantes. Un centre de recherche spécialisé, le Centre national de recherche sur les sites et sols pollués (CNRSSP), basé à Douai, a également été mis en place. Par ailleurs, quand un site est reconnu officiellement par arrêté préfectoral comme site orphelin, l’Ademe peut mettre en œuvre les opérations nécessaires à la sauvegarde du public. Ainsi, dans la mesure des moyens alloués, l’Ademe peut assurer la protection de la nappe phréatique et l’interdiction de l’accès au site.
 Ne pas perdre la mémoire Ne pas perdre la mémoire |
|
L’une des principales difficultés, en matière d’anciens sites industriels, réside dans la perte de mémoire. Compte tenu de leur localisation, le plus souvent au cœur du tissu urbain, certains de ces sites ont changé d’usage ou sont appelés à une mutation foncière. De nombreux propriétaires et détenteurs actuels de sites pollués n’ont plus de lien direct avec les activités à l’origine des pollutions dont ils héritent et que parfois ils ignorent.
Pour connaître la localisation des activités passées, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a réalisé l’inventaire historique régional  16. Cet inventaire, qui couvre la période d’environ 1800 à 1970, apporte les informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier, de la protection de l’environnement et de la santé. C’est un outil essentiel pour les collectivités locales, qui peuvent désormais intégrer cette connaissance à leurs documents de planification urbaine et à leurs projets d’aménagement et envisager les actions prioritaires à entreprendre. Au 1er janvier 2003, 14 223 anciens sites industriels représentant 21 061 activités (un site pouvant abriter plusieurs activités) ont été recensés dans la région. Même si le lien entre activités et pollution n’est pas automatique, leur connaissance et leur localisation permettent de préciser, pour chaque site, les produits utilisés pouvant être à l’origine d’une éventuelle pollution. La répartition spatiale des activités anciennes correspond aux bassins d’emplois traditionnels : textile dans la métropole lilloise et le Calaisis, sidérurgie et métallurgie dans la métropole lilloise et le Valenciennois, terrils dans le bassin minier, etc. Compte tenu des activités 16. Cet inventaire, qui couvre la période d’environ 1800 à 1970, apporte les informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier, de la protection de l’environnement et de la santé. C’est un outil essentiel pour les collectivités locales, qui peuvent désormais intégrer cette connaissance à leurs documents de planification urbaine et à leurs projets d’aménagement et envisager les actions prioritaires à entreprendre. Au 1er janvier 2003, 14 223 anciens sites industriels représentant 21 061 activités (un site pouvant abriter plusieurs activités) ont été recensés dans la région. Même si le lien entre activités et pollution n’est pas automatique, leur connaissance et leur localisation permettent de préciser, pour chaque site, les produits utilisés pouvant être à l’origine d’une éventuelle pollution. La répartition spatiale des activités anciennes correspond aux bassins d’emplois traditionnels : textile dans la métropole lilloise et le Calaisis, sidérurgie et métallurgie dans la métropole lilloise et le Valenciennois, terrils dans le bassin minier, etc. Compte tenu des activités  17 recensées, 23 % des sites sont susceptibles d’avoir utilisé des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et 20 % d’être pollués par le chrome, l’arsenic, le bore, le zinc, le nickel ou le plomb. 17 recensées, 23 % des sites sont susceptibles d’avoir utilisé des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et 20 % d’être pollués par le chrome, l’arsenic, le bore, le zinc, le nickel ou le plomb.
 Les friches, un enjeu foncier et urbain Les friches, un enjeu foncier et urbain |
|
Depuis sa création en 1990, l’EPF du Nord - Pasde- Calais a traité, par démolition et revégétalisation, 4 500 hectares de grandes friches périurbaines et, surtout, des friches minières. Ces travaux, qui se sont élevé à 120 millions d’euros (coût hors dépollution), ont été financés par le contrat de plan État-Région (CPER) et les fonds européens (Feder). Aujourd’hui, le stock de friches restant à traiter a changé de nature : les sites sont de plus petite taille, mais fréquemment pollués et imbriqués dans des tissus urbains mixtes mélangeant installations industrielles, logements vétustes et équipements obsolètes. Afin de s’adapter à cette situation, les politiques publiques ont évolué en soutenant le « renouvellement urbain » et la reconstruction de la ville sur elle-même. C’est-à-dire en privilégiant une stratégie de requalification visant à recycler le foncier des espaces urbains dégradés, ce qui suppose la restructuration des espaces urbains centraux et la lutte contre la consommation anarchique d’espaces agricoles en périphérie des villes. Ces interventions concernent tout particulièrement les quartiers en difficulté dans les agglomérations de « vieille » industrie en crise ou en reconversion. Elles se font le plus souvent dans le cadre de la géographie prioritaire : contrats de ville, grands projets de ville, etc. 43 % des anciens sites industriels des agglomérations sont ainsi situés sur les communes prioritaires de la politique de la ville.
 Des coûts importants Des coûts importants |
|
À la différence des opérations d’urbanisation se réalisant sur des sites agricoles périphériques aux agglomérations, les opérations sur d’anciens sites industriels (y compris quand ceux-ci ne sont pas pollués) requièrent des travaux qui produisent un foncier à un coût au-dessus du prix du marché. C’est pourquoi une intervention publique est généralement nécessaire. Quand les sols sont pollués, les coûts de dépollution  18 peuvent être extrêmement élevés au regard des valeurs foncières susceptibles d’être créées. Ils sont théoriquement à la charge du pollueur mais dans le cas d’activités anciennes ou d’entreprises non solvables, les pouvoirs publics se voient dans l’obligation de financer les travaux. En complément des fonds du CPER, du conseil régional et des programmes européens (Feder), l’EPF est doté de ressources propres pour l’acquisition et le portage foncier des sites pour le compte des collectivités territoriales. Les crédits de la politique de la ville étant mobilisés pour le réaménagement des terrains, le financement de la dépollution et du différentiel de charge foncière reste problématique. 18 peuvent être extrêmement élevés au regard des valeurs foncières susceptibles d’être créées. Ils sont théoriquement à la charge du pollueur mais dans le cas d’activités anciennes ou d’entreprises non solvables, les pouvoirs publics se voient dans l’obligation de financer les travaux. En complément des fonds du CPER, du conseil régional et des programmes européens (Feder), l’EPF est doté de ressources propres pour l’acquisition et le portage foncier des sites pour le compte des collectivités territoriales. Les crédits de la politique de la ville étant mobilisés pour le réaménagement des terrains, le financement de la dépollution et du différentiel de charge foncière reste problématique.
 La consommation d’espace continue La consommation d’espace continue |
|
D’après l’enquête nationale « Exploitation de l’information statistique sur les transactions dans l’ancien et le neuf » (Existan)  19, la région a connu une croissance spectaculaire de son marché immobilier entre 1997 et 2000 : + 26 % pour les transactions de logements neufs. Parallèlement, les prix n’ont cessé d’augmenter (+ 43,5 % en quatre ans) en raison d’une forte demande et d’une pénurie relative de l’offre. Les bassins de Lille et de Roubaix-Tourcoing, après celui de la côte d’Opale, représentent les marchés immobiliers les plus dynamiques avec des taux de mutation 19, la région a connu une croissance spectaculaire de son marché immobilier entre 1997 et 2000 : + 26 % pour les transactions de logements neufs. Parallèlement, les prix n’ont cessé d’augmenter (+ 43,5 % en quatre ans) en raison d’une forte demande et d’une pénurie relative de l’offre. Les bassins de Lille et de Roubaix-Tourcoing, après celui de la côte d’Opale, représentent les marchés immobiliers les plus dynamiques avec des taux de mutation  20 respectivement de 4,6 et 4,9 %. L’ex-bassin minier se caractérise, quant à lui, par un faible dynamisme, notamment à Béthune et à Lens. Entre 1993 et 2000, les ventes de terrains non bâtis, généralement consacrés à la construction de maisons individuelles, ont progressé de 87 %. Dans les zones de Roubaix-Tourcoing, Saint-Pol-sur-Ternoise et Hesdin, la demande de terrains non bâtis est faible. À l’opposé, les bassins d’Aire-sur-la-Lys, du Quesnoy, de Saint-Omer et de Boulogne-sur-Mer sont particulièrement touchés par la consommation d’espace pour la construction d’habitations individuelles. 20 respectivement de 4,6 et 4,9 %. L’ex-bassin minier se caractérise, quant à lui, par un faible dynamisme, notamment à Béthune et à Lens. Entre 1993 et 2000, les ventes de terrains non bâtis, généralement consacrés à la construction de maisons individuelles, ont progressé de 87 %. Dans les zones de Roubaix-Tourcoing, Saint-Pol-sur-Ternoise et Hesdin, la demande de terrains non bâtis est faible. À l’opposé, les bassins d’Aire-sur-la-Lys, du Quesnoy, de Saint-Omer et de Boulogne-sur-Mer sont particulièrement touchés par la consommation d’espace pour la construction d’habitations individuelles.
L’habitat n’est pas le seul responsable de cette consommation d’espace, la création d’infrastructures y participe également. Le Nord - Pas-de-Calais a une très forte densité routière (901 m/km2 contre 674 m/km2 pour la France) et ferroviaire (95 m/km2 contre 50 m/ km2 pour la France). Cette tendance devrait d’ailleurs se poursuivre quelles que soient les solutions modales qui seront retenues pour le contournement du corridor Nord et de la liaison fluviale Seine-Nord. Les infrastructures routières jouent également un rôle dans les mutations foncières qui s’accélèrent le long des grands axes routiers. Ainsi, l’A25 explique le grand nombre de transactions foncières à l’intérieur des bassins du littoral, au sud et à l’ouest du bassin lillois ou encore dans la Flandre intérieure. Enfin, les zones d’activités occupaient, en 2002, 1,8 % du territoire  21, soit près de 23 000 hectares. 21, soit près de 23 000 hectares.
 La dévalorisation du foncier dans les zones en crise La dévalorisation du foncier dans les zones en crise |
|
La présence de sites dégradés (sols pollués, friches industrielles, quartiers en difficulté) mais aussi certaines pratiques des acteurs locaux ont contribué à la dévalorisation du foncier. Face à la crise, la tentation était grande de donner des terres pour une valeur symbolique afin de favoriser l’implantation d’entreprises et donc la création d’emplois. Pendant des années, les aménagements en faveur de l’accueil des entreprises (notamment de zones d’activités), largement financés (jusqu’à 75 %) par les fonds européens (programmes objectif 1 et objectif 2) et les fonds nationaux, se sont multipliés. Ces pratiques, à une période où la maîtrise de l’espace n’était pas une priorité, ont contribué à sa dépréciation. Aujourd’hui, le marché étant plus actif et les acteurs locaux ayant pris conscience de cette situation, l’EPF agit pour inverser la tendance. Il conseille les collectivités pour qu’elles développent des outils prenant mieux en compte la question foncière : référentiel foncier débouchant sur des programmes d’acquisition dans le cadre d’un projet de territoire, réserves foncières pour les projets industriels de grandes tailles, etc.
 Notes Notes
|
12 - Selon l’Union nationale des producteurs de granulats, la moyenne française était de 7 tonnes par habitant en 1990, 6,7 en 1999 et 7,1 en 2000.
13 - Certains se consument encore.
14 - Trois projets de parcs d’attraction sont à l’étude à Grenay, Hénin-Beaumont et Fouquières. Il existe déjà un précédent avec le terril de Noeux-les-Mines qui est équipé d’une piste de ski artificielle. Celui d’Auberchicourt offre également des équipements sportifs et de loisirs. Celui de Rieulay est en cours d’équipement.
15 - Petit D., 1998. La maîtrise des séquelles techniques à long terme des exploitations minières. Paris, 51 p.
16 - La base Basias des anciens sites industriels et des activités de service est consultable sur le site : http://basias.brgm.fr. Cet inventaire a été réalisé en partenariat avec l’EPF, le pôle de compétence « Sites et sédiments pollués », l’agence de l’Eau Artois-Picardie, l’Ademe, le conseil régional, la communauté urbaine Lille Métropole, la communauté urbaine d’Arras et les services de l’État concernés, etc.
17 - Dessertes de carburants (21 %), ateliers mécaniques (8 %), dépôts de liquides inflammables (14 %), travail des métaux et de la métallurgie (20 %) et textile (4 %) sont les activités les plus fréquentes.
18 - Mais la dépollution n’est pas toujours possible.
19 - Cette enquête est réalisée par sondage sur les mutations à titre onéreux à partir des actes de mutation relevés dans les services des directions générales des Impôts.
20 - Taux de mutation = nombre de logements vendus / nombre total de logements.
21 - Source : Observatoire régional de l’habitat et de l’aménagement (2002).
|
|
|