|
 Les enjeux environnementaux du transport urbain Les enjeux environnementaux du transport urbain |
 Contenir la périurbanisation Contenir la périurbanisation |
|
Même si la forte densité de population contribue à réduire les distances de déplacement, la région n’échappe cependant pas au phénomène de périurbanisation. L’étalement de l’aire urbaine de la métropole lilloise entraîne une augmentation des distances et donc des émissions de CO2 dues aux déplacements quotidiens.
La consommation d’énergie (exprimée en grammes équivalents pétrole) est très différenciée suivant le lieu de résidence, comme l’illustrent les estimations de l’Ademe Nord - Pas-de-Calais, du conseil régional Nord - Pas-de- Calais et de Lille Métropole communauté urbaine (2002). L’exemple lillois montre en effet un phénomène bien connu : une stabilisation de la consommation énergétique liée aux transports quotidiens dans les hypercentres et une surconsommation énergétique qui dépasse largement les limites de la communauté urbaine. Il existe un phénomène moins connu : les habitants du centre ont tendance à se déplacer davantage dans le cadre des trajets occasionnels de longue distance. Le bilan énergétique de la périurbanisation mérite donc d’être nuancé, mais son impact sur les nuisances locales et la qualité de vie dans les villes restent néanmoins indiscutables.
 Mieux organiser les transports collectifs Mieux organiser les transports collectifs |
|
Les problématiques ne sont, certes, pas les mêmes suivant les villes, mais les aires urbaines du Nord - Pas-de- Calais ont en commun une faible centralité. La multipolarité de l’agglomération lilloise transparaît nettement à travers les déplacements qui se réalisent autour des différents pôles (Lille, Roubaix, Tourcoing, etc.). Les déplacements diffus induits par cette urbanisation compliquent l’organisation des transports publics. Par ailleurs, ceux-ci sont organisés pour satisfaire la demande de déplacements domicile-travail mais ils répondent moins bien aux besoins de plus en plus divers des autres déplacements (courses, loisirs et écoles).
Malgré la densité urbaine de la population, les indicateurs de performance (compétitivité et fréquentation) du transport collectif dans l’agglomération lilloise ne sont pas favorables. Le rapport de la durée moyenne d’un déplacement en transport collectif urbain à la durée moyenne d’un déplacement en automobile (2,4 à Lille  30 alors qu’il est généralement autour de 2 dans les grandes villes 30 alors qu’il est généralement autour de 2 dans les grandes villes  31) s’est détérioré de manière sensible entre 1987 et 1998. Les parts de marché du transport collectif régional des déplacements quotidiens des citadins sont particulièrement faibles et ne cessent de baisser. D’après les dernières enquêtes Ménages déplacements, seulement 4 % à Douai, 6 % à Dunkerque et 5 % à Valenciennes et Lille de l’ensemble de ces déplacements ont lieu en transport en commun. 31) s’est détérioré de manière sensible entre 1987 et 1998. Les parts de marché du transport collectif régional des déplacements quotidiens des citadins sont particulièrement faibles et ne cessent de baisser. D’après les dernières enquêtes Ménages déplacements, seulement 4 % à Douai, 6 % à Dunkerque et 5 % à Valenciennes et Lille de l’ensemble de ces déplacements ont lieu en transport en commun.
Comme la métropole lilloise a un potentiel ferroviaire important (métro, tram et TER), le plan de déplacement urbain (PDU) de Lille  32 met davantage l’accent sur une réorganisation de l’offre existante que sur une augmentation de l’offre de transport en commun. Une meilleure utilisation du TER dans le périmètre urbain et interurbain, une tarification et une information multimodale et non sectorisée semblent offrir au moins autant de marges de manœuvre que les autres projets comme le tram partant vers Mons, le tram-train 32 met davantage l’accent sur une réorganisation de l’offre existante que sur une augmentation de l’offre de transport en commun. Une meilleure utilisation du TER dans le périmètre urbain et interurbain, une tarification et une information multimodale et non sectorisée semblent offrir au moins autant de marges de manœuvre que les autres projets comme le tram partant vers Mons, le tram-train  33 (comme en Allemagne) ou le développement du bus au gaz. 33 (comme en Allemagne) ou le développement du bus au gaz.
| |
|
 La consommation d’énergie en 1987 et 1998 La consommation d’énergie en 1987 et 1998
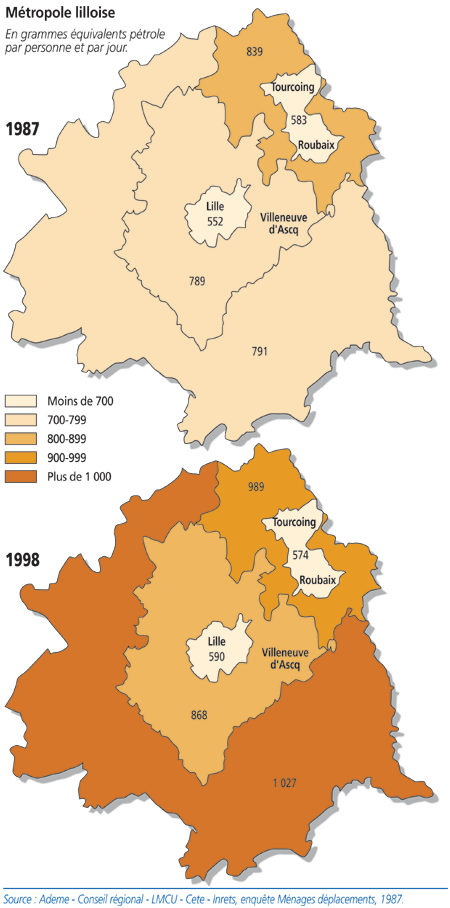
|
 Limiter l’usage de l’automobile Limiter l’usage de l’automobile |
|
Dans l’agglomération lilloise, l’« éducation » à la voiture commence tôt : 46 % des écoliers du primaire vont à l’école en voiture, déposés par leurs parents  34. La crainte de l’insécurité routière due au nombre important de voitures est souvent évoquée pour justifier ces déplacements. Le PDU ne mentionne pas spécifiquement dans ses objectifs la nécessité de favoriser la marche et le vélo lors de ces déplacements scolaires. 34. La crainte de l’insécurité routière due au nombre important de voitures est souvent évoquée pour justifier ces déplacements. Le PDU ne mentionne pas spécifiquement dans ses objectifs la nécessité de favoriser la marche et le vélo lors de ces déplacements scolaires.
Le développement des modes alternatifs implique une réflexion cohérente ; un transfert vers le rail des migrants pendulaires qui empruntent un axe routier (par exemple l’A25) implique d’améliorer les dessertes du TER mais peut-il être efficace si, dans le même temps, l’élargissement de la route est décidé ? Compte tenu des tendances actuelles, il semble qu’une politique favorable aux transports en commun et aux modes doux ne peut pas se réaliser sans une politique qui limite la circulation automobile et l’espace occupé par la voiture (en stationnement ou en circulation). Le PDU de Lille souligne la nécessité de changer le partage de la voirie en faveur des modes alternatifs en créant des couloirs propres aux autobus et des aménagements pour les vélos. À titre d’exemple, l’aménagement en 1996 de la rue de Paris  35 en une rue « mixte » piétonvoiture a amélioré la transition entre la voirie classique et le secteur piétonnier et a facilité la circulation douce sans porter préjudice aux activités commerciales. 35 en une rue « mixte » piétonvoiture a amélioré la transition entre la voirie classique et le secteur piétonnier et a facilité la circulation douce sans porter préjudice aux activités commerciales.
 Restructurer la ville Restructurer la ville |
|
La limitation de la circulation automobile est plus aisée à mettre en œuvre dans le cadre des déplacements centraux et des déplacements radiaux (de la périphérie vers le centre). Quant à l’explosion des déplacements de banlieue à banlieue, encore plus marquée dans une aire multipolaire comme Lille, elle est plus difficile à maîtriser et à orienter vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), promulguée le 13 décembre 2000, incite la démarche des PDU et la mise en cohérence de l’évolution de la ville avec celle des réseaux de transport. La politique du logement et le choix du lieu des activités seront, à plus long terme, des éléments décisifs pour redessiner les métropoles du Nord - Pas-de-Calais et y concevoir des systèmes de transports durables.
À Dunkerque, l’agglomération urbaine est parvenue à freiner la périurbanisation lointaine et les actifs travaillent pour plus de 60 % dans l’agglomération restreinte (contre moins de 25 % à Lille). Les distances domicile-travail ont ainsi moins augmenté qu’ailleurs et la restructuration urbaine, qui a permis de créer un pôle de loisirs associant surfaces de vente et cinémas à une encablure du centre, pourrait faciliter l’usage des transports collectifs dans les déplacements de loisirs.
À Lille, le renouvellement urbain des quartiers en mutation, où de nombreux sites industriels cessent leur activité, laisse des marges de manœuvre. Cependant, le nombre croissant de déplacements en provenance du bassin minier et des mouvements transfrontaliers vers la Belgique implique la nécessité de raisonner à une échelle plus large que celle de la communauté urbaine. Le développement d’une offre ferroviaire d’un haut niveau de service et des possibilités de chaîne de transport route- TER réellement compétitive est à ce titre un enjeu fort de la politique régionale des transports.
 Notes Notes
|
30 - Source : Certu, 2002. La mobilité urbaine en France : les années 90. Lyon, pages 50 et 51. (coll. Références, n° 26).
31 - 1,8 à Lyon en 1995, 2 à Grenoble en 1992, 2 à Strasbourg en 1997, 1,8 à Marseille en 1997, etc.
32 - Le PDU de Lille a été adopté en juin 2000, révisé en 2003, et vient d’être annulé par le tribunal administratif.
33 - Un tram-train est un tramway au rayon d’action élargi, capable de rouler sur les voies ferrées SNCF pour offrir des performances dépassant les limites du service que propose un train et se rapprochant d’un service porte-à-porte.
34 - Source : Certu, 2002.
35 - Près de la gare de Lille-Flandres.
|
|
|