|
 Les impacts du transport régional Les impacts du transport régional |
 La route : la première mais pas la seule responsable La route : la première mais pas la seule responsable |
|
Il n’est pas surprenant qu’en Nord - Pas-de-Calais, comme dans les autres régions françaises, la route soit responsable d’une grande part des impacts des transports : les études d’évaluation monétaire montrent qu’environ 90 % des coûts environnementaux des transports sont dus à la route et lorsqu’un voyageur se déplace en France en automobile, il engendre, en moyenne, entre 2,3 et 4,4  19 fois plus d’impacts environnementaux (pollution de l’air, bruit, effet de serre et accidents) qu’en train. 19 fois plus d’impacts environnementaux (pollution de l’air, bruit, effet de serre et accidents) qu’en train.
Le regard porté par la suite sur les impacts des transports routiers permet de dégager des singularités régionales et de hiérarchiser les enjeux environnementaux du transport. Néanmoins, on ne peut pas écarter du bilan environnemental les autres modes.
La responsabilité du transport ferroviaire régional est loin d’être négligeable en matière de nuisances sonores. Le cumul du linéaire des tronçons des différents types d’infrastructures (autoroutes, routes nationales, routes départementales, voies ferrées) montre en effet que le ferroviaire représente dans la région 60 % des 776 kilomètres de linéaires classés en catégorie 1  20 par leur niveau sonore. La forte activité du fret ferroviaire participe au niveau élevé des émissions sonores en période nocturne, Dunkerque constituant la première gare de marchandises de France 20 par leur niveau sonore. La forte activité du fret ferroviaire participe au niveau élevé des émissions sonores en période nocturne, Dunkerque constituant la première gare de marchandises de France  21. 21.
L’intensité du transport maritime d’hydrocarbures et d’autres substances nocives (minerais, soufre, produits chimiques, glycol) au large du littoral et dans les ports du Nord - Pas-de-Calais expose la région aux risques de pollutions accidentelles. Les opérations de routine comme le rejet de résidus de fioul et d’huiles de l’ensemble des navires et celui des eaux de déballastage ou de lavage des cuves des chimiquiers et des pétroliers expliquent la pollution de la mer du Nord.
Les riverains de l’aéroport Lille-Lesquin sont exposés localement au bruit et à la pollution de l’air générés par les décollages et les atterrissages des avions. Le transport aérien produit des impacts qui obligent à élargir le cadre de référence au long terme et au global. Le projet du deuxième aéroport belge, Chièvres, à mi-chemin de Bruxelles et de Lille, peut, en déplaçant une partie des nuisances vers une zone moins peuplée, réjouir les riverains des aéroports de ces deux métropoles. Néanmoins, les perspectives d’une telle augmentation de l’offre aéroportuaire appellent des considérations sur les conséquences d’une reprise éventuelle de la croissance du transport aérien sur l’atmosphère et le climat planétaire.
 Les coûts environnementaux de la circulation routière Les coûts environnementaux de la circulation routière |
|
Il n’est pas aisé d’apprécier les impacts environnementaux du transport routier et de les mettre en perspec tive par rapport à la moyenne nationale.
L’ensemble de ces coûts représente, en 1994, 1,3 % du PIB régional, ce qui correspond à l’ordre de grandeur de la moyenne nationale (hors Île-de-France). L’importance des nuisances locales (pollution de l’air et bruit) est compensée par une contribution relativement faible au changement climatique. La densité de population de la région explique, pour une grande part, les performances environnementales des transports. Elle est un atout pour réduire les distances de déplacements  22 et donc les émissions de gaz à effet de serre. Elle est, en revanche, par l’importance de la population urbaine exposée aux émissions du trafic routier, une contrainte forte en matière d’impact sanitaire. Cette ambivalence rappelle les caractéristiques de l’Île-de-France. 22 et donc les émissions de gaz à effet de serre. Elle est, en revanche, par l’importance de la population urbaine exposée aux émissions du trafic routier, une contrainte forte en matière d’impact sanitaire. Cette ambivalence rappelle les caractéristiques de l’Île-de-France.
Les habitants de la région subissent particulièrement l’effet de la pollution de l’air du transport routier. Si l’on se réfère aux hypothèses retenues par l’évaluation monétaire officielle  23 et l’étude « tripartite » de l’OMS 23 et l’étude « tripartite » de l’OMS  24, les effets sanitaires à long terme de la pollution de l’air due à la circulation routière correspondraient à plus de 9 000 années de vie perdues dans la région au cours de l’année 1996. Ces victimes seraient concentrées dans les aires urbaines denses et plus particulièrement dans l’agglomération lilloise 24, les effets sanitaires à long terme de la pollution de l’air due à la circulation routière correspondraient à plus de 9 000 années de vie perdues dans la région au cours de l’année 1996. Ces victimes seraient concentrées dans les aires urbaines denses et plus particulièrement dans l’agglomération lilloise  25. 25.
Les poids lourds étaient responsables, en 1994, d’une part particulièrement importante des coûts environnementaux du transport routier régional  26 : 34,7 % contre 31,2 % en moyenne nationale. 26 : 34,7 % contre 31,2 % en moyenne nationale.
Les voitures particulières sont responsables de plus de la moitié de l’impact sanitaire de la pollution de l’air  27. Néanmoins, la part importante du transport de marchandises (poids lourds et véhicules utilitaires légers) est la conséquence de la forte circulation des véhicules utilitaires légers et des poids lourds dans les villes du Nord - Pas-de-Calais. 27. Néanmoins, la part importante du transport de marchandises (poids lourds et véhicules utilitaires légers) est la conséquence de la forte circulation des véhicules utilitaires légers et des poids lourds dans les villes du Nord - Pas-de-Calais.
| |
|
 Les coûts environnementaux du transport routier en Nord - Pas de Calais en 1994 Les coûts environnementaux du transport routier en Nord - Pas de Calais en 1994
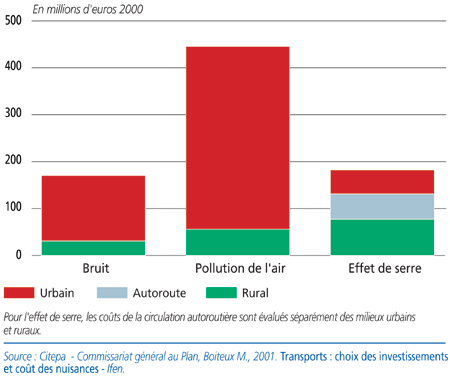
|
| |
|
 La contribution des différents types de véhicules aux coûts de la pollution de l’air en 1994 La contribution des différents types de véhicules aux coûts de la pollution de l’air en 1994
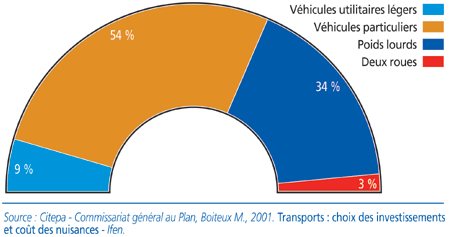
|
 Des impacts à ne pas oublier Des impacts à ne pas oublier |
|
Bien que l’insécurité routière ne relève pas directement de la sphère de l’environnement, les impacts de la circulation automobile ne peuvent pas être abordés sans évoquer les victimes de la route.
Moins apparents, les impacts liés aux processus amont et aval des cycles de vie des carburants, des infrastructures et des véhicules, comme l’émission de CO2 lors de la production ou le recyclage des automobiles, sont souvent ignorés mais sont loin d’être négligeables  28. 28.
Le réseau routier est caractérisé par un haut niveau de congestion  29. En 1994, l’émission régionale de CO2 au kilomètre de route était supérieure de 31 % à la moyenne nationale sur les autoroutes et de 82 % sur l’ensemble du réseau. 29. En 1994, l’émission régionale de CO2 au kilomètre de route était supérieure de 31 % à la moyenne nationale sur les autoroutes et de 82 % sur l’ensemble du réseau.
L’intensité du trafic a induit un besoin important en infrastructures routières, c’est pourquoi le réseau du Nord - Pas-de-Calais est l’un des plus maillé de France. En 2000, on comptait 47,8 kilomètres d’autoroutes par kilomètre carré, soit 172 % de plus que la densité moyenne nationale. Quant aux réseaux routiers national et départemental et au réseau ferré, ils sont également plus denses que sur l’ensemble de la métropole, respectivement de 34 % et de 88 %.
La construction de ces infrastructures a eu un impact fort sur le paysage mais également sur l’artificialisation des sols et l’écoulement des eaux. Par ailleurs, la circulation mais aussi les activités de service liées au transport comme les stations-service ou les garages génèrent une importante pollution des sols [voir le chapitre Sol et sous-sol].
| |
|
 La densité des réseaux routier et ferré en 2001 La densité des réseaux routier et ferré en 2001
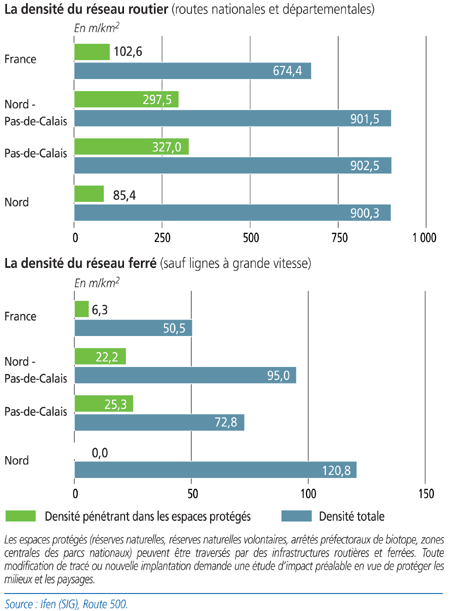
|
 Notes Notes
|
19 - 2,3 est un chiffre issu des valeurs tutélaires du dernier rapport Boiteux et 4,4 du rapport IWW/INFRAS pour la Commission européenne (voir Commissariat général du Plan, Boiteux M., 2001. Transports : choix des investissements et coût des nuisances. Paris, La Documentation Française, 325 p. et INFRAS-Zurich et IWW-Karlsruhe, 2000. External costs of transport : accident, environmental and congestion costs of transports in western Europe. UIC, 300 p.).
20 - Le calcul a été réalisé par les directions départementales de l’Équipement en mars 2003. Les infrastructures sont classées en cinq catégories. La catégorie 1 correspond à des niveaux sonores supérieurs aux points de référence : 83 db (A) en diurne et 78 db (A) en nocturne.
21 - Avec un tonnage de 13,7 millions de tonnes en 1998.
22 - En 1994, la circulation automobile dans la région n’était que de 4 902 kilomètres par habitant contre une moyenne nationale de 6 191 kilomètres.
23 - L’évaluation repose sur des valeurs tutélaires nationales et néglige des facteurs régionaux tels que la topographie, le climat ou l’âge moyen du parc.
24 - Cette étude attribue 17 629 décès (avec une hypothèse de perte d’espérance de vie moyenne de dix ans) à la circulation routière en France pour l’année 1996 et les coûts pour la région Nord - Pas-de-Calais représentent 5,2 % du total national (après correction de la densité). Voir Sommer H., 1999. Health costs due to road traffic-related air pollution : an impact assesment of project Austria, France, Switzerland - Economic Evaluation. Berne, 8 p.
25 - La densité moyenne correspondant à la définition de « l’urbain dense » dans le cadre des évaluations monétaires est de 489 habitants au kilomètre carré alors que l’aire urbaine de Lille est caractérisée, en 1999, par une densité de 1 281 habitants au kilomètre carré.
26 - Les poids lourds contribuent en Nord - Pas-de-Calais pour 34 % aux coûts de la pollution de l’air, 46 % aux coûts du bruit et 26 % (dont la moitié sur l’autoroute) aux coûts de l’effet de serre dus à la circulation routière.
27 - Les voitures particulières contribuent en Nord - Pas-de-Calais pour 54 % aux coûts de la pollution de l’air, 44 % aux coûts du bruit et 59 % (dont la moitié en milieu urbain) aux coûts de l’effet de serre dus à la circulation routière.
28 - Selon l’étude IWW/INFRAS, 32 % du changement climatique et 20 % de la pollution de l’air de l’automobile provenaient, en 1995, des processus amont et aval des cycles de vie des carburants, des infrastructures et des véhicules et ces parts devraient augmenter avec le progrès technologique sur les véhicules.
29 - La congestion aggrave la pollution de l’air (certains gaz uniquement, les oxydes d’azote étant fonction de la vitesse) mais réduit la vitesse et le nombre de décès dus aux accidents.
|
|
|