|
 Les enjeux environnementaux du transport de marchandises Les enjeux environnementaux du transport de marchandises |
 Rationaliser le transport de marchandises en ville Rationaliser le transport de marchandises en ville |
|
L’importance dans la région des coûts externes générés en milieu urbain par le transport routier de marchandises souligne le besoin d’étudier les circuits d’approvisionnement de marchandises et d’évacuation des déchets dans les villes. Lille a intégré cette préoccupation dans la préparation de son PDU et a inclus une zone logistique intermodale (fer, route et fluvial) à proximité du centre. Le choix de cet espace, prévu pour servir de pôle d’éclatement (ou de regroupement) des marchandises au terme de leur transport principal à proximité du centre, soulève des enjeux fonciers. Quant à la distribution capillaire qui devrait s’opérer avec de plus petits véhicules peu polluants  36, elle concerne souvent de petits lots à livrer (ou à collecter) et nécessite l’établissement d’un cahier des charges pour des tournées rentables et la mise en place de circuits efficaces qui empruntent des voies adaptées. 36, elle concerne souvent de petits lots à livrer (ou à collecter) et nécessite l’établissement d’un cahier des charges pour des tournées rentables et la mise en place de circuits efficaces qui empruntent des voies adaptées.
En ce qui concerne les déchets, le conseil régional Nord - Pas-de-Calais et la délégation Nord - Pas-de-Calais de l’Ademe ont lancé de concert un véritable schéma d’incitation des modes alternatifs à la route. Les deux plans d’élimination des ordures ménagères du Nord et du Pas-de-Calais prévoient la nécessité de raccorder toute nouvelle installation de traitement de déchets ménagers aux modes fluvial et ferroviaire. Cette planification se traduit aujourd’hui concrètement par le transport d’une partie du verre, des déchets verts, de la ferraille et des ordures ménagères brutes par voie d’eau.
L’impact environnemental des poids lourds dans les villes ne s’explique pas seulement par l’approvisionnement des villes. La gare ferroviaire de marchandises Saint-Sauveur, située au centre de Lille, ainsi que les livraisons des entreprises de vente par correspondance induisent en milieu urbain des convois de produits dangereux mais aussi un transit important de marchandises diverses.
 Redéployer les plates-formes logistiques Redéployer les plates-formes logistiques |
|
Le Nord - Pas-de-Calais est la deuxième région logistique  37 de France après l’Île-de-France. Ainsi, outre Saint-Sauveur, la région compte de nombreuses plates-formes logistiques : port de Lille, Dunkerque (port de Dunkerque-Eurofret), Calais (Eurotunnel), Arras (Artoispole), Boulogne-sur-Mer, Valenciennes, Roubaix, Lesquin, Roncq, etc., mais celles-ci approchent également de la saturation. La région Nord - Pas-de-Calais a, d’une part, renforcé les plates-formes logistiques fonctionnant bien (à titre d’exemple, le port de Lille va augmenter sa capacité de traitement de conteneurs afin de favoriser le rail et la voie d’eau) et, d’autre part, a programmé la construction de nouvelles plates-formes : les chantiers du combiné rail-route de Lomme et surtout de la plate-forme de Dourges (Delta 3) devraient débloquer la situation. 37 de France après l’Île-de-France. Ainsi, outre Saint-Sauveur, la région compte de nombreuses plates-formes logistiques : port de Lille, Dunkerque (port de Dunkerque-Eurofret), Calais (Eurotunnel), Arras (Artoispole), Boulogne-sur-Mer, Valenciennes, Roubaix, Lesquin, Roncq, etc., mais celles-ci approchent également de la saturation. La région Nord - Pas-de-Calais a, d’une part, renforcé les plates-formes logistiques fonctionnant bien (à titre d’exemple, le port de Lille va augmenter sa capacité de traitement de conteneurs afin de favoriser le rail et la voie d’eau) et, d’autre part, a programmé la construction de nouvelles plates-formes : les chantiers du combiné rail-route de Lomme et surtout de la plate-forme de Dourges (Delta 3) devraient débloquer la situation.
Delta 3 associe trois modes de transport (route-fereau) et privilégie les équipements de transfert sans rupture de charge (la marchandise ne change pas de contenant). La plate-forme devrait jouer un rôle essentiel dans l’organisation du système de transport : elle devrait travailler en réseau avec les autres plates-formes régionales et offrir une capacité plus importante de transport combiné en relation en particulier avec la Grande-Bretagne (projet Eurotunnel) et le Benelux.
L’efficacité environnementale d’une telle plate-forme dépend du sort d’autres projets. Le développement d’un transfert modal route-eau est tributaire de la réalisation du canal Seine-Nord et le transfert modal route-fer est aujourd’hui limité par la priorité accordée en termes de sillons au transport de voyageurs. Sans action sur les goulets d’étranglement des modes alternatifs, Delta 3 pourrait déplacer les trafics à une périphérie plus lointaine de l’agglomération lilloise par rapport à Saint-Sauveur, fluidifier la circulation et favoriser surtout le transport de marchandises par la route. En provoquant des transferts et des créations d’activités, la plate-forme risque également de créer un trafic routier difficile à quantifier et à localiser à ce jour.
 Choisir les investissements d’infrastructure Choisir les investissements d’infrastructure |
|
Le contrat de plan État-Région 2000-2006 annonce, en matière de transport de marchandises, l’objectif de favoriser l’intermodalité et de donner une priorité à la diversification des modes de transport : « système portuaire, réseau fluvial à grand gabarit, réseau ferroviaire doivent être utilisés à leur pleine capacité ». La structure des financements laisse néanmoins une part belle à la route : 52 % d’un milliard d’euros destinés aux transports.
L’arbitrage entre les grands projets d’infrastructures s’établit au niveau national et oriente à long terme la répartition modale du transport de marchandises. L’accroissement du transit international est l’argument avancé pour justifier l’augmentation des capacités des infrastructures. Les études sur la liaison autoroutière entre Amiens, Lille et la Belgique et la liaison fluviale Seine - Nord, décidées au Comité interministériel d’Aménagement et de Développement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003, s’inscrivent dans cette perspective. La liaison fluviale Seine - Nord allégera la circulation autoroutière de nombreux poids lourds et offrira une alternative au choix du « tout routier ». Le trafic fluvial actuel sur cet axe à petit gabarit est de 3,3 millions de tonnes. Le potentiel du projet Seine - Nord autorisant le transit de convois de 4 400 tonnes est estimé à 13 millions de tonnes dès 2015. Le canal Seine - Nord, qui prolongera le canal Dunkerque-Escaut, sera à la fois un élément majeur de la politique de développement du port de Dunkerque et de la plate-forme de Dourges et d’ouverture vers l’Europe fluviale du Nord.
Bien que le canal Seine - Nord, notamment la liaison interbassin, nécessite de l’énergie pour monter l’eau et les péniches (le canal Seine - Nord a la particularité de couler contre la gravité), le projet offre des avantages environnementaux incontestables : le transport fluvial est sobre  38, il produit peu de nuisances sonores et limite les risques lors du transport de matières dangereuses. Ce projet a finalement été adopté malgré les controverses soulevées, notamment en raison de son coût. 38, il produit peu de nuisances sonores et limite les risques lors du transport de matières dangereuses. Ce projet a finalement été adopté malgré les controverses soulevées, notamment en raison de son coût.
| |
|
 Les objectifs opérationnels dans le cadre du contrat de plan Etat-région 2000-2006 Les objectifs opérationnels dans le cadre du contrat de plan Etat-région 2000-2006
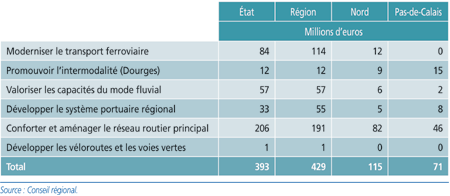
|
 Intégrer davantage l’environnement dans les objectifs portuaires Intégrer davantage l’environnement dans les objectifs portuaires |
|
Les politiques portuaires ont une responsabilité importante vis-à-vis des impacts des transports sur l’environnement.
Les ports participent activement à la prévention des pollutions maritimes qu’elles soient accidentelles (par le contrôle portuaire de l’état des navires) ou opérationnelles (par les installations de collecte des résidus). Le port de Dunkerque, par sa vocation pétrolière, est particulièrement concerné d’autant que plus d’un million de tonnes de fioul lourd (dont le transport s’avère particulièrement risqué) y a transité au cours de l’année 2001. Le rapport déposé au Sénat en juin 2000  39 souligne qu’à Dunkerque, les capacités de réception des eaux de ballast étaient insuffisantes compte tenu de l’évolution des tailles des cargaisons et mentionne, aussi bien à Calais qu’à Dunkerque, l’absence d’installations destinées à recevoir les résidus d’hydrocarbures et les boues issues des carburants. 39 souligne qu’à Dunkerque, les capacités de réception des eaux de ballast étaient insuffisantes compte tenu de l’évolution des tailles des cargaisons et mentionne, aussi bien à Calais qu’à Dunkerque, l’absence d’installations destinées à recevoir les résidus d’hydrocarbures et les boues issues des carburants.
La voie maritime peut offrir une alternative crédible  40 (jusqu’à cinquante fois plus économe en énergie) au transit routier. C’est un trafic européen qu’il faut en général favoriser, par l’intermédiaire du développement du cabotage maritime. 40 (jusqu’à cinquante fois plus économe en énergie) au transit routier. C’est un trafic européen qu’il faut en général favoriser, par l’intermédiaire du développement du cabotage maritime.
Les opérations portuaires de Calais bénéficient d’une rocade urbaine qui arrive directement sur les terminaux ferries. Si elle est encombrée, les camions sont dirigés en amont sur un énorme parking qui sert également d’aire de repos. Cette fluidité du transit portuaire explique la croissance du fret de biens manufacturés qui transitent en majorité par la route. Calais pourrait être le point de départ d’une ligne régulière de cabotage mais le trafic routier à proximité du littoral et l’encombrement critique du détroit maritime restreignent les marges de manœuvre.
La politique portuaire oriente la répartition modale du transport terrestre. Dunkerque, port de réception du grand vrac, assure l’expédition par train entier ou péniche. Ainsi 3,6 millions de tonnes de minerai de fer destiné aux hauts-fourneaux lorrains transitent par Dunkerque (80 % du marché). Le choix d’aménager son secteur à conteneur n’est pas neutre, il a permis au port autonome de mieux connecter Dunkerque au réseau ferroviaire North European Network (NEN). Le plan ambitieux qui annonce un transit de 60 millions de tonnes à l’horizon 2010 repose sur un développement de la voie fluviale, mais pourra-t-on empêcher que la route n’absorbe une partie de la croissance d’activité ?
 Notes Notes
|
36 - EDF et GDF se sont impliqués dans des recherches et des expérimentations pour développer des véhicules propres dédiés au transport de marchandises en ville.
37 - L’activité logistique employait, en 2000, 55 000 personnes en Nord - Pas-de-Calais.
38 - Selon Voies Navigables de France, un kilo équivalent pétrole consommé permet de transporter une tonne sur 50 km par camion sur autoroute, 130 km par train complet, 175 km par bateau de type grand Rhénan (2 000 à 3 000 tonnes) et 275 km par bateauconvoi de 4 400 tonnes.
39 - Source : Richemont, 2000.
40 - L’investissement dans l’acquisition ou l’affrètement d’un navire reste moins coûteux que la construction d’une infrastructure routière et les moyens sont rapidement disponibles.
|
|
|