|
 Les eaux superficielles Les eaux superficielles |
 L’hydrographie L’hydrographie |
|
 La faiblesse des pentes et des débits La faiblesse des pentes et des débits
La principale caractéristique hydrographique du Nord - Pas-de-Calais est l’absence de grands fleuves et de reliefs importants. Les cours d’eau, constitués de rivières et de petits fleuves côtiers, se caractérisent par la faiblesse de leur débit  37. et de leur pente, ce qui ne favorise pas la dilution de la pollution. Ces facteurs, associés à une forte densité de population et d’industries, ont une influence sur la qualité de l’eau des rivières qui est médiocre, voire mauvaise. 37. et de leur pente, ce qui ne favorise pas la dilution de la pollution. Ces facteurs, associés à une forte densité de population et d’industries, ont une influence sur la qualité de l’eau des rivières qui est médiocre, voire mauvaise.
La région a une forte tradition d’aménagements hydrauliques : lutte contre les intrusions salées, assainissement des zones humides, évacuation des eaux de ruissellement, canaux, moulins... Avec 650 km de cours d’eau et canaux, elle a un réseau de voies navigables sans équivalent en France. Les faibles pentes ont incité l’homme à canaliser les cours d’eau et à tisser un réseau maillé de canaux entre les différents bassins. Seules l’Authie, la Canche, la Liane, la Slack et le Wimereux sont hydrauliquement indépendantes. Des canaux de liaison permettent à l’eau de s’écouler de bassin à bassin, et par-fois même, grâce à des stations de pompages, d’inverser le cours de l’eau.
| |
|
 La qualité et la gestion des eaux superficielles (état 2002) La qualité et la gestion des eaux superficielles (état 2002)
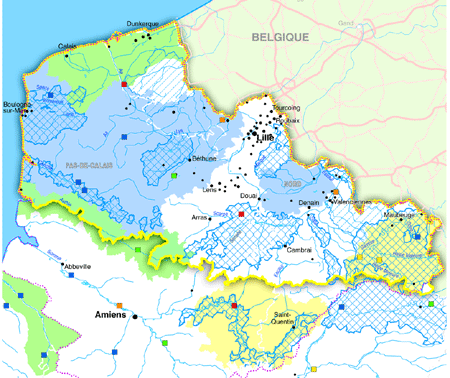
|
|
|
 Les nappes alimentent les rivières Les nappes alimentent les rivières
La superposition de bassins versants hydrographiques et hydrogéologiques témoigne d’une communication étroite entre l’ensemble des cours d’eau de l’Artois et la nappe de la craie. Les eaux souterraines participent à 80 % au débit de l’Authie et de la Canche, à 70 % à celui de la Lys et de l’Aa.
Cependant, selon les saisons, les échanges entre la rivière et la nappe changent. En période d’étiage, le débit de la rivière est soutenu par le drainage de la nappe en quantité d’autant plus grande que le niveau de la rivière est bas. Mais, lors des séquences pluvieuses, la tendance s’inverse et les hautes eaux de la rivière rechargent alors les nappes. C’est donc un système qui fonctionne dans les deux sens et peut entraîner deux types de pollution : la pollution allant de la rivière vers la nappe ou, à l’inverse, de la nappe vers la rivière.
Une nappe ayant des teneurs en nitrates élevées pourra donc participer à certaines périodes de l’année à la pollution des eaux de surface au même titre que l’industrie, l’agriculture ou les agglomérations. C’est notamment le cas de la Canche et de l’Authie, dont les teneurs en nitrates dépassent de manière chronique les 25 mg/l en raison de la pollution des eaux souterraines.
 La qualité de l’eau La qualité de l’eau |
|
 L’amélioration de la qualité physico-chimique des cours d’eau L’amélioration de la qualité physico-chimique des cours d’eau
Faibles débits, forte pression démographique, pollution industrielle (le plus souvent ancienne), pollution agricole diffuse et érosion des sols sont les principales causes de la mauvaise qualité des eaux de surface. Pourtant, celle-ci s’est nettement améliorée depuis une trentaine d’années. En 1969, elle était tellement mauvaise que la grille d’appréciation, qui comprend aujourd’hui quatre classes  38., aurait pu être prolongée par une classe de " qualité extrêmement mauvaise ". 38., aurait pu être prolongée par une classe de " qualité extrêmement mauvaise ".
Grâce aux efforts de lutte contre la pollution engagés par tous, certains cours d’eau jusqu’alors " inclassables ", souvent à l’aval des grandes agglomérations, sont aujourd’hui en classe moyenne. Le nombre de cours d’eau de mauvaise et de médiocre qualité a considérablement diminué. Alors qu’en 1977, 29 % des cours d’eau du bassin Artois-Picardie étaient de mauvaise qualité (en pourcentage de linéaire) et 32 % de qualité médiocre, ils sont aujourd’hui respectivement de 4 % et 30 %. Par contre, l’état de ceux qui étaient de bonne qualité ces dernières années a tendance à se dégrader à cause des teneurs en nitrates et des matières en suspension.
Les secteurs de mauvaise qualité sont très localisés et les causes de dégradation sont traitées les unes après les autres. Au nord des collines de l’Artois où la densité humaine et industrielle est plus forte, la qualité reste en général médiocre ou mauvaise, c’est notamment le cas de la Lys, l’Yser, la Deûle, la Scarpe ou l’Escaut.
| |
|
 L’évolution de la qualité des cours d’eau L’évolution de la qualité des cours d’eau
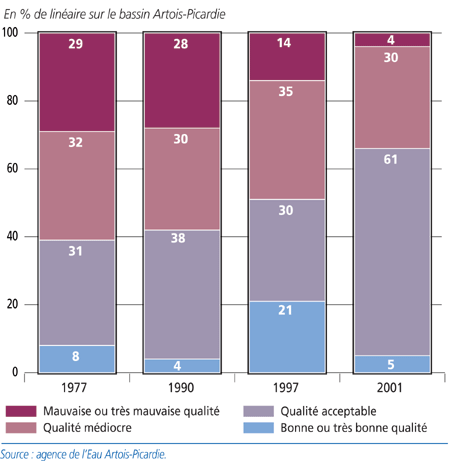
|
 Les SAGE, une démarche plébiscitée Les SAGE, une démarche plébiscitée
Le bassin Artois-Picardie s’est efforcé de favoriser la définition et la mise en œuvre de schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour mieux protéger les milieux aquatiques de son territoire. Après un démarrage difficile  39., les SAGE sont devenus aujourd’hui le maillon stratégique de la politique de l’eau sur le bassin. Plus d’une dizaine d’années après la promulgation de la loi sur l’eau (3 janvier 1992), onze SAGE sont en cours : deux en phase d’approbation (le Boulonnais et l’Audomarois), deux en phase de rédaction (la Lys et la Canche) et sept en phase d’élaboration (la Scarpe, le delta de l’Aa et l’Authie, la Sensée, la Bresle, la Haute-Somme, la Sambre). Conformément à leurs objectifs, ils ont été initiés le plus souvent dans des contextes difficiles : pollution, qualité à reconquérir, inondations, zones humides à protéger, érosion des sols, conflits d’usage, etc. Les retombées de cette démarche sont telles que d’autres territoires souhaitent en bénéficier (l’Yser, l’Escaut ou encore le bassin Deûle-Marque). Élaborer un SAGE apparaît en effet pour les acteurs locaux comme le moyen de résoudre les conflits d’usages liés à l’eau. Le bassin Artois-Picardie fait d’ailleurs preuve d’un grand dynamisme dans leur mise œuvre 39., les SAGE sont devenus aujourd’hui le maillon stratégique de la politique de l’eau sur le bassin. Plus d’une dizaine d’années après la promulgation de la loi sur l’eau (3 janvier 1992), onze SAGE sont en cours : deux en phase d’approbation (le Boulonnais et l’Audomarois), deux en phase de rédaction (la Lys et la Canche) et sept en phase d’élaboration (la Scarpe, le delta de l’Aa et l’Authie, la Sensée, la Bresle, la Haute-Somme, la Sambre). Conformément à leurs objectifs, ils ont été initiés le plus souvent dans des contextes difficiles : pollution, qualité à reconquérir, inondations, zones humides à protéger, érosion des sols, conflits d’usage, etc. Les retombées de cette démarche sont telles que d’autres territoires souhaitent en bénéficier (l’Yser, l’Escaut ou encore le bassin Deûle-Marque). Élaborer un SAGE apparaît en effet pour les acteurs locaux comme le moyen de résoudre les conflits d’usages liés à l’eau. Le bassin Artois-Picardie fait d’ailleurs preuve d’un grand dynamisme dans leur mise œuvre  40. Avec la transposition de la directive-cadre sur l’eau en droit français et la nécessité de mieux informer les acteurs locaux, les SAGE semblent avoir un avenir prometteur dans le bassin. 40. Avec la transposition de la directive-cadre sur l’eau en droit français et la nécessité de mieux informer les acteurs locaux, les SAGE semblent avoir un avenir prometteur dans le bassin.
| |
|
 La qualité des cours d’eau en 2001 La qualité des cours d’eau en 2001
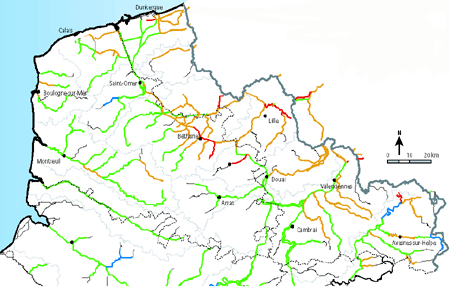
|
|
|
 Les ressources piscicoles Les ressources piscicoles |
|
 Les ressources piscicoles : plusieurs entités Les ressources piscicoles : plusieurs entités
La région comprend trois entités bien distinctes. Les fleuves côtiers (première catégorie piscicole), notamment l’Authie, la Canche et leurs affluents, recèlent une population de poissons grands migrateurs (anguilles, lamproies, salmonidés : saumons, truites de mer). Le réseau hydrographique de l’Avesnois (première catégorie piscicole), qui héberge plus de quinze espèces, offre un potentiel piscicole important, en particulier pour les espèces cyprinicoles. De nombreuses rivières (deuxième catégorie piscicole) abritent une population de carnassiers et de poissons blancs. Enfin, les canaux et les wateringues, qui sont des milieux banalisés en raison des activités humaines, sont peu propices au développement de populations piscicoles intéressantes, hormis les anguilles. Parmi les fleuves côtiers de première catégorie, avec quatre espèces remarquables et des habitats  41. d’une grande richesse, l’Authie occupe une place importante France en raison de leur diversité ichtyologique. Bien dans le réseau fluviatile et piscicole du Nord-Ouest de la 41. d’une grande richesse, l’Authie occupe une place importante France en raison de leur diversité ichtyologique. Bien dans le réseau fluviatile et piscicole du Nord-Ouest de la  42. que l’Authie n’occupe au niveau national qu’un rang faible pour les effectifs " captures " de saumon atlantique, l’Authie, avec la Bresle, sont les seules rivières, de la Seine au Danemark, à être encore fréquentées par ce poisson. Sa conservation étant fondamentale sur le plan biogéographique européen, ce site fait partie du réseau Natura 2000 qui a pour objet de préserver la biodiversité en Europe 42. que l’Authie n’occupe au niveau national qu’un rang faible pour les effectifs " captures " de saumon atlantique, l’Authie, avec la Bresle, sont les seules rivières, de la Seine au Danemark, à être encore fréquentées par ce poisson. Sa conservation étant fondamentale sur le plan biogéographique européen, ce site fait partie du réseau Natura 2000 qui a pour objet de préserver la biodiversité en Europe  43. 43.
 Les difficultés de circulation et de reproduction des poissons Les difficultés de circulation et de reproduction des poissons
La qualité de l’eau s’est fortement améliorée depuis une vingtaine d’années. Les cas de pollutions extrêmes sont rares et la qualité de l’eau ne pose plus de problèmes majeurs pour le développement piscicole. En revanche, la disparition de certaines zones humides et l’anthropisation des berges et du fond entravent l’accomplissement du cycle de vie ou la reproduction de certaines espèces en raison de la destruction des frayères. Le Nord - Pas-de-Calais se caractérise par une forte tradition d’aménagement hydraulique qui a largement contribué à artificialiser les cours d’eau. Que ce soit pour les moulins, pour le drainage des terres humides (avec entre autres les wateringues) ou pour le transport fluvial des marchandises, il s’agit d’aménagements souvent très anciens qui, un peu partout dans la région, gênent la libre circulation des anguilles et celles des autres grands migrateurs dans les fleuves côtiers. Ces obstacles empêchent les grands migrateurs de remonter jusqu’aux frayères mais participent aussi à l’homogénéisation et à la banalisation des habitats. Leur forte densité altère aussi la qualité physico-chimique des eaux de surface en limitant la capacité d’autoépuration des cours d’eau. 33 bar-rages de la Canche ont été ouverts sur 65, et seulement 13 sur 22 pour l’Authie. Permettre la libre circulation des poissons migrateurs est une obligation. Des procédures sont en cours pour résorber les barrages petit à petit  44. mais c’est un travail long qui prend du retard par rapport aux objectifs fixés par différents arrêtés préfectoraux. Afin d’inciter les propriétaires à réaliser rapidement les modifications nécessaires, l’État et les collectivités territoriales subventionnent les travaux. Les schémas départementaux de vocation piscicole donnent les axes d’actions déclinés de façon opérationnelles dans les plans départementaux de protection des milieux aquatiques et de gestion piscicole (en cours d’élaboration). 44. mais c’est un travail long qui prend du retard par rapport aux objectifs fixés par différents arrêtés préfectoraux. Afin d’inciter les propriétaires à réaliser rapidement les modifications nécessaires, l’État et les collectivités territoriales subventionnent les travaux. Les schémas départementaux de vocation piscicole donnent les axes d’actions déclinés de façon opérationnelles dans les plans départementaux de protection des milieux aquatiques et de gestion piscicole (en cours d’élaboration).
 Les causes de pollution Les causes de pollution |
|
 Des rejets industriels en baisse Des rejets industriels en baisse
L’industrie a commencé à diminuer ses rejets dans les eaux de surface à partir des années soixante-dix, mais c’est surtout dans les années quatre-vingt-dix que des efforts considérables, conduisant à une forte baisse des rejets polluants, ont été réalisés par les industriels. Sur les 1 300 établissements du bassin Artois-Picardie payant la redevance industrielle, 250 sont équipés d’une station d’épuration. Les autres, soit 80 % des établissements, utilisent les stations urbaines, directement ou après pré-traitement des effluents.
D’après la Drire Nord - Pas-de-Calais, les industries agroalimentaires  45. et la chimie-pétrole 45. et la chimie-pétrole  46. sont les secteurs qui émettent le plus de pollution azotée, de matières en suspension et de matières organiques. Les industries agroalimentaires rejettent le plus souvent une charge polluante organique facilement biodégradable alors que celle de la chimie-pétrole l’est difficilement. 46. sont les secteurs qui émettent le plus de pollution azotée, de matières en suspension et de matières organiques. Les industries agroalimentaires rejettent le plus souvent une charge polluante organique facilement biodégradable alors que celle de la chimie-pétrole l’est difficilement.
Dans une région où les cours d’eau sont très sensibles aux pollutions, en particulier aux pollutions organiques qui appauvrissent le milieu en oxygène, la diminution des rejets de matières organiques observée depuis une dizaine d’années participe fortement à l’amélioration des rivières. Après l’industrie du papier-carton, qui avait réalisé d’importants efforts en matière de dépollution il y a déjà quelques années, c’est actuellement l’industrie agroalimentaire qui, grâce aux épandages, diminue le plus fortement ses rejets de matières organiques.
| |
|
 L’évolution de la demande chimique en oxygène L’évolution de la demande chimique en oxygène
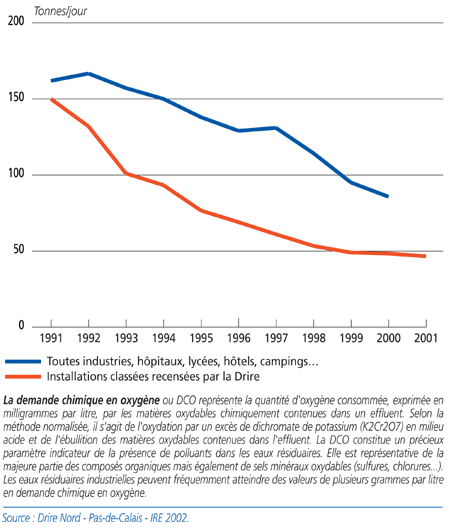
|
 Des métaux toxiques toujours présents Des métaux toxiques toujours présents
La région a connu une pollution historique de sédiments, surtout par les métaux, en raison des rejets toxiques qui se sont déposés au fil du temps dans les vases et les boues organiques minérales. Ces boues doivent être retirées des cours d’eau ![47 - Agence de l'Eau Artois-Picardie, 2002. Historique national des opérations de curage et perspectives. Lille, 190 p. (coll. Études inter-agences, 89). [Voir le chapitre Déchets].](diren/themes/images/offre.gif) 47. puis stockées. De 1990 à 2002, le volume de sédiments curés dans la région était de plus de 2 millions de m3. Des polluants étaient présents dans 45 % de ces sédiments. Pour les voies navigables, le volume curé par kilomètres de voies navigables est d’environ 3 100 m3/km, soit au total plus de 1,6 million de m3 pour les 547 kilomètres de voies navigables de la région. On estime à 3,2 millions de m3 le volume des sédiments à curer dans les dix prochaines années, ce qui représente une hausse de 56 % par rapport à la période 1990-2000. 47. puis stockées. De 1990 à 2002, le volume de sédiments curés dans la région était de plus de 2 millions de m3. Des polluants étaient présents dans 45 % de ces sédiments. Pour les voies navigables, le volume curé par kilomètres de voies navigables est d’environ 3 100 m3/km, soit au total plus de 1,6 million de m3 pour les 547 kilomètres de voies navigables de la région. On estime à 3,2 millions de m3 le volume des sédiments à curer dans les dix prochaines années, ce qui représente une hausse de 56 % par rapport à la période 1990-2000.
Les progrès réalisés, ces dernières années, dans la maîtrise de la pollution industrielle (matières organiques et matières en suspension) ne doivent pas cacher les difficultés que connaît encore la région en matière de rejets toxiques, notamment de métaux toxiques et de matières inhibitrices. Les rejets de métaux toxiques (mesurés à l’aide d’un paramètre appelé métox  48.) restent importants. Ils résultent essentiellement des activités de la sidérurgie-métallurgie et du traitement de sur-face. Quelques grands établissements sont à l’origine des principaux rejets toxiques dans la région. Ainsi, en 2001, Tioxide Europe à Calais était à l’origine des plus gros rejets de titane, de chrome, de fer, de manganèse et de nickel ; Metaleurop à Noyelle-Godault était le plus gros émetteur de cadmium et de plomb, Comilog à Boulogne-sur-Mer de cuivre et de cyanure, Umicore à Auby de zinc, Sollac à Grande-Synthe de fluorure. 48.) restent importants. Ils résultent essentiellement des activités de la sidérurgie-métallurgie et du traitement de sur-face. Quelques grands établissements sont à l’origine des principaux rejets toxiques dans la région. Ainsi, en 2001, Tioxide Europe à Calais était à l’origine des plus gros rejets de titane, de chrome, de fer, de manganèse et de nickel ; Metaleurop à Noyelle-Godault était le plus gros émetteur de cadmium et de plomb, Comilog à Boulogne-sur-Mer de cuivre et de cyanure, Umicore à Auby de zinc, Sollac à Grande-Synthe de fluorure.
Aujourd’hui, la lutte contre la pollution industrielle change de nature. Elle est centrée sur la recherche de produits pouvant avoir une toxicité différée  49. Il s’agit de substances, souvent mal connues, dont les effets sur les milieux aquatiques peuvent se faire sentir même à des doses infinitésimales. Ces rejets font l’objet actuellement d’un programme de recherche national, décliné régionalement. 49. Il s’agit de substances, souvent mal connues, dont les effets sur les milieux aquatiques peuvent se faire sentir même à des doses infinitésimales. Ces rejets font l’objet actuellement d’un programme de recherche national, décliné régionalement.
| |
|
 Les émissions industrielles dans l’eau en 2000 Les émissions industrielles dans l’eau en 2000
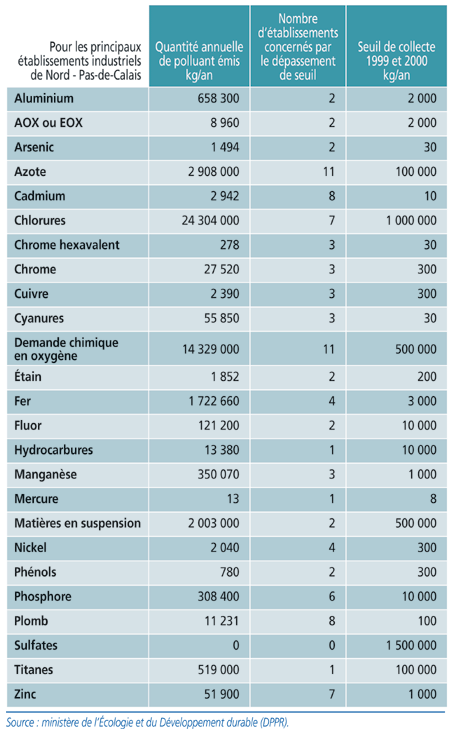
|
 Des stations encore non conformes Des stations encore non conformes
La principale difficulté de la région en matière d’épuration réside dans sa structure urbaine constituée d’une multitude d’agglomérations de dimension moyenne, conduisant à la construction d’un grand nombre de stations d’épuration d’une capacité de 20 000 à 50 000 équivalent-habitant (EH). Or, par habitant, le traitement des effluents coûte plus cher pour une station moyenne que pour une station de grande capacité.
Pourtant, avec une capacité installée de 6,3 mil-lions EH, d’importants progrès ont été réalisés depuis les années soixante-dix. En janvier 2002, l’agence de l’Eau Artois-Picardie a recensé 401 stations d’épuration (dont 289 en Nord - Pas-de-Calais) contre 330 en 1993 et 30 en 1969. Excepté le cas de Neuville-en-Ferrain  50. dont la station est en cours de réalisation, toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants sont désormais équipées. Petit à petit, les points noirs sont résorbés 50. dont la station est en cours de réalisation, toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants sont désormais équipées. Petit à petit, les points noirs sont résorbés  51. ou devraient l’être prochainement 51. ou devraient l’être prochainement  52. comme à Hazebrouck, Aire-sur-la-Lys, Boulogne-sur-Mer et Cambrai. Cependant, dix-neuf stations ne sont pas encore conformes aux objectifs fixés par la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines et la majorité des stations ne traitent ni l’azote, ni le phosphore, qui jouent un rôle primordial dans l’eutrophisation. En effet, seules 35 stations de la région traitent l’azote et 19 le phosphore, soit respectivement 34 % et 7 % des stations. Le huitième programme de l’agence de l’Eau (2003-2006) tient compte des travaux de modernisation nécessaires dans la perspective du classement de toute la région en zone sensible à l’eutrophisation (dans le cadre de la directive européenne sur le traitement des eaux résiduaires urbaines). Il s’est notamment fixé pour priorité la modernisation et la mise aux normes des stations existantes. L’objectif est de moderniser au moins une capacité de 800 000 EH d’ici 2006, ce qui représente un montant de travaux de 144 millions d’euros, dont 96 millions d’euros apportés par l’agence de l’Eau Artois-Picardie. 52. comme à Hazebrouck, Aire-sur-la-Lys, Boulogne-sur-Mer et Cambrai. Cependant, dix-neuf stations ne sont pas encore conformes aux objectifs fixés par la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines et la majorité des stations ne traitent ni l’azote, ni le phosphore, qui jouent un rôle primordial dans l’eutrophisation. En effet, seules 35 stations de la région traitent l’azote et 19 le phosphore, soit respectivement 34 % et 7 % des stations. Le huitième programme de l’agence de l’Eau (2003-2006) tient compte des travaux de modernisation nécessaires dans la perspective du classement de toute la région en zone sensible à l’eutrophisation (dans le cadre de la directive européenne sur le traitement des eaux résiduaires urbaines). Il s’est notamment fixé pour priorité la modernisation et la mise aux normes des stations existantes. L’objectif est de moderniser au moins une capacité de 800 000 EH d’ici 2006, ce qui représente un montant de travaux de 144 millions d’euros, dont 96 millions d’euros apportés par l’agence de l’Eau Artois-Picardie.
| |
|
 L’assainissement collectif des stations d’épuration de plus de 10 000 habitants L’assainissement collectif des stations d’épuration de plus de 10 000 habitants
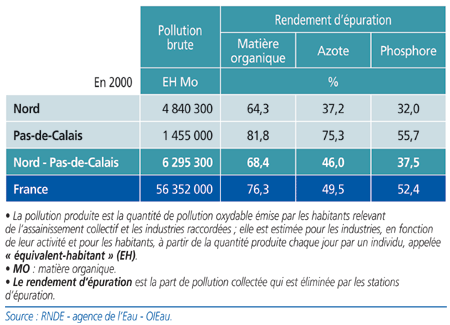
|
| |
|
 Le traitement des agglomération d’assainissement Le traitement des agglomération d’assainissement
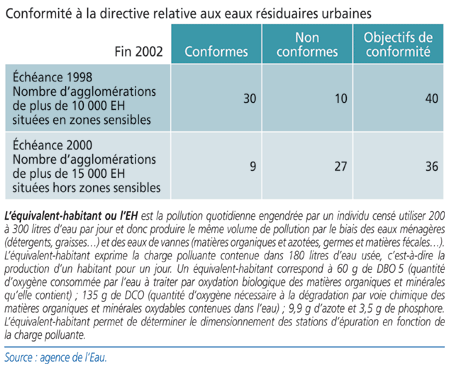
|
 Des réseaux anciens Des réseaux anciens |
|
En raison de son urbanisation ancienne, la région est essentiellement équipée de réseaux unitaires drainant dans les mêmes canalisations les eaux usées et les eaux pluviales. Par conséquent, par temps de pluie, les réseaux ne sont pas capables d’acheminer la totalité des débits vers les stations  53. et débordent vers le milieu naturel 53. et débordent vers le milieu naturel  54. 54.
La solution consiste à favoriser l’infiltration des eaux pluviales là où elles tombent (en limitant l’imperméabilisation des sols  55.) plutôt que de les collecter. Mais, en attendant la mise en œuvre de nouvelles techniques de construction, le stockage des excédents d’eau dans des bassins reste nécessaire. Or, le rythme de création de ces bassins de stockage est lent en raison du coût. La capa-cité des bassins de stockage n’était que de 218 000 m3 en 2001. Rares sont les collectivités capables de traiter la totalité des débits générés par une pluie d’occurrence mensuelle. On estime que les effluents d’environ 800 000 EH ne sont pas traités en période de pluie. 55.) plutôt que de les collecter. Mais, en attendant la mise en œuvre de nouvelles techniques de construction, le stockage des excédents d’eau dans des bassins reste nécessaire. Or, le rythme de création de ces bassins de stockage est lent en raison du coût. La capa-cité des bassins de stockage n’était que de 218 000 m3 en 2001. Rares sont les collectivités capables de traiter la totalité des débits générés par une pluie d’occurrence mensuelle. On estime que les effluents d’environ 800 000 EH ne sont pas traités en période de pluie.
Enfin, pour améliorer l’assainissement, il est nécessaire de raccorder à l’égout toutes les habitations et de réhabiliter les réseaux existants. Or, l’agence de l’Eau Artois-Picardie estime qu’un quart du réseau d’assainissement est à construire  56. Ce qui représente une facture potentielle de 200 millions d’euros et de 50 millions d’euros pour maintenir le réseau existant en bon état. L’agence de l’Eau prévoit durant son huitième programme (2003-2006) de favoriser le raccordement de 28 000 logements et d’améliorer la desserte de 80 000 logements. Elle entend investir 110 millions d’euros. 56. Ce qui représente une facture potentielle de 200 millions d’euros et de 50 millions d’euros pour maintenir le réseau existant en bon état. L’agence de l’Eau prévoit durant son huitième programme (2003-2006) de favoriser le raccordement de 28 000 logements et d’améliorer la desserte de 80 000 logements. Elle entend investir 110 millions d’euros.
 Notes Notes
|
37 - À lui seul, le Rhône a un débit quinze fois supérieur à l’ensemble des cours d’eau de la région. Quelques débits moyens à titre de comparaison : 34 m3/s pour la Somme, 15 m3/s pour l’Escaut, 12 m3/s pour la Lys, 1 700 m3/s pour le Rhône, 870 m3/s pour la Loire, 410 m3/s pour la Seine. 7 - À certains endroits, l’eau souterraine est inutilisable car trop polluée.
38 - 1 : bonne qualité, 2 : qualité acceptable, 3 : qualité médiocre, 4 : mauvaise qualité.
39 - Ce retard était dû en partie à la nécessité de s’appuyer sur les préconisations du SDAGE du bassin Artois-Picardie dont la rédaction était en cours.
40 - Sur les quinze ensembles susceptibles de faire l’objet d’un SAGE (identifiés par le SDAGE), seul le territoire de la Scarpe amont n’a eu aucune velléité d’installer un SAGE.
41 - Les habitats représentatifs des hydrosystèmes fluviatiles nord-atlantiques basiques comme les habitats aquatiques rhéophiles (Ranunculion fluitantis à Ranunculus fluitans) et lentisques (Callitrichetum obtusangulae...).
42 - Saumon atlantique, lamproie fluviatile (probable), lamproie de planer et chabot.
43 - L’arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans les cours d’eau au titre de l’article L.432-6 du Code de l’environnement (libre circulation des migrateurs) ne cite pas le saumon pour l’Authie alors qu’il est mentionné pour la Canche et la Ternoise. En revanche, l’arrêté du 26 novembre 1987 fixant la liste des cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon cite la Canche, l’Authie et la Bresle dans le bassin Artois-Picardie.
44 - La meilleure solution est, dans l’absolu, l’ouverture totale des barrages avec aménagements éventuels des seuils résiduels. La réalisation d’échelles à poissons permet de rétablir le franchissement quand l’ouverture totale est impossible.
45 - Les industries agroalimentaires sont réparties sur tout le territoire de la région.
46 - Localisée sur le littoral à Calais et Dunkerque.
47 - Agence de l’Eau Artois-Picardie, 2002. Historique national des opérations de curage et perspectives. Lille, 190 p. (coll. Études inter-agences, 89). [Voir le chapitre Déchets].
48 - Les deux paramètres utilisés pour mesurer la pollution par les matières toxiques sont l’AOX (composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif) et le métox qui con-cerne l’arsenic et sept métaux : mercure, cadmium, plomb, nickel, cuivre, chrome et zinc.
49 - L’annexe de la directive-cadre européenne sur l’eau identifie 33 produits.
50 - Station de 70 000 EH.
51 - Grâce, notamment, à la construction des stations de Grimonpont-Wattrelos (450 000 EH), de Neuville-en-Ferrain (70 000 EH) et de Mazingarbe (30 000 EH).
52 - La station de Hazebrouck, située en zone sensible pour l’eau potable, va être reconstruite, celle d’Aire-sur-la-Lys, également située en zone sensible pour l’eau potable, va être recalibrée et des travaux de modernisation vont être effectués sur celle de Boulogne en zone sensible pour la baignade. Quant à la station de Cambrai, le projet technique est terminé et les travaux devraient commencer prochainement.
53 - Il s’agit de stations dimensionnées pour temps sec qui ne sont pas prévues pour traiter les volumes d’eau apportés par la pluie.
54 - Par ailleurs, des réseaux défectueux, en raison de leur vétusté ou d’effondrements miniers, peuvent fuir dans la nappe ou au contraire se remplir d’eau claire et solliciter inutilement les stations d’épuration.
55 - Pour plus d’information sur les solutions alternatives, voir le site de l’Association douaisienne pour la promotion de techniques alternatives : http://adopta.free.fr
56 - D. Serra, 2002. " La qualité des rivières dans le Nord ", La voix du Nord, 7 août 2002. Intervention de M. Alain Strébelle, directeur de l’agence de l’Eau Artois-Picardie.
|
|
|