|
 Les réponses : maîtrise de l’utilisation du sol et information du public Les réponses : maîtrise de l’utilisation du sol et information du public |
Face aux risques naturels et industriels, les réponses de l’administration portent à la fois sur la prévention avec la maîtrise de l’utilisation du sol et sur l’information de la population.
 Information, prévention et protection contre les inondations Information, prévention et protection contre les inondations |
|
L’établissement d’atlas des zones inondables pour les cours d’eau prioritaires est en cours de réalisation (dixhuit vallées sont couvertes à ce jour). Ces atlas établissent l’étendue et l’importance des inondations. Ils permettent la sensibilisation de la population, des décideurs et des responsables socio-économiques, et l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondations. Les mesures que ces derniers définissent ont vocation à être intégrées dans les documents d’urbanisme, afin de contrôler l’urbanisation en zones inondables. Pour l’ensemble de la région, en 2002, seulement 46 communes avaient intégré dans leurs documents d’urbanisme les prescriptions des plans de prévention des risques.
Dans le cadre de la loi « risques » [voir encadré], un schéma directeur de prévision des crues organise au niveau de chaque bassin les missions de surveillance, prévision et transmission de l’alerte sur les crues, réparties entre les services de l’État et les collectivités territoriales. En ce qui concerne l’État, suite à la circulaire du 1er octobre 2002 portant sur la réorganisation des Services d’annonce de crues (SAC), ces derniers doivent évoluer vers des Services de prévision des crues (SPC), aux missions étendues. La Diren Nord - Pas-de-Calais a été désignée comme l’unique SPC du bassin Artois-Picardie avec intégration du fleuve Somme dans son périmètre d’intervention.
Enfin, trois bassins régionaux ont été retenus en 2003 dans le cadre du plan « Bachelot », qui vise à inciter les collectivités à mieux prévenir et se protéger contre le risque d’inondation : le Boulonnais et les bassins versants de la Lys et de l’Hogneau.
 Prévenir les risques industriels par la maîtrise de l’aménagement de l’espace Prévenir les risques industriels par la maîtrise de l’aménagement de l’espace |
|
Il s’agit en premier lieu de prévoir des règles d’aménagement limitatives pour les zones d’habitation, pour la voirie environnante et pour les autres installations industrielles de façon à éviter la propagation d’un sinistre important. Deux zones de limitation sont déterminées par les services de la Drire, en fonction des scénarios d’accidents décrits dans l’étude de danger. La zone Z1 représente l’aire dans laquelle l’accident aurait des conséquences mortelles pour au moins 1 % des personnes présentes. La zone Z2 (800 m) est la zone d’apparition d’effets irréversibles pour la santé. Les collectivités locales sont informées de l’existence de ces zones à risques dans le cas des installations existantes. Le maire est tenu de les prendre en compte dans le plan local d’urbanisme (PLU), mais le préfet peut se substituer à la commune et déclarer d’intérêt général la prise en compte des risques en définissant un projet d’intérêt général (PIG) qui ne remet pas en cause l’urbanisation existante et n’ouvre pas droit à l’indemnisation des propriétaires de terrains.
Dans la région, l’application de la loi du 22 juillet 1987, qui est à l’origine de la maîtrise de l’aménagement de l’espace, a concerné 37 installations industrielles depuis le début des années quatre-vingt-dix dont Metaleurop et Nitrochimie dans le Pas-de-Calais.
 Informer le public des risques industriels : des exemples réussis Informer le public des risques industriels : des exemples réussis |
|
L’efficacité des plans de secours repose largement sur l’information préventive des populations avoisinantes. Aussi est-il fait obligation aux industries à risques de distribuer à l’ensemble de la population pouvant être concernée des brochures décrivant notamment les risques des produits présents dans l’usine et la conduite à tenir en cas d’accident.L’efficacité des plans de secours repose largement sur l’information préventive des populations avoisinantes. Aussi est-il fait obligation aux industries à risques de distribuer à l’ensemble de la population pouvant être concernée des brochures décrivant notamment les risques des produits présents dans l’usine et la conduite à tenir en cas d’accident.
Parmi les mesures prises dans le Nord - Pas-de-Calais, on peut souligner la création de deux Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles (SPPPI). Ces structures partenariales permettent aux acteurs de l’environnement industriel (élus, associations, industriels, État, etc.) de débattre des problématiques liées aux risques et aux pollutions. Les deux SPPPI couvrent respectivement la zone littorale et l’Artois.
Le SPPPI côte d’Opale-Flandres a organisé, fin 2001, une quatrième campagne d’information sur les risques industriels pour l’ensemble des communes de la zone littorale concernées (165 000 foyers au total). La mise en place d’un site Internet  6., le perfectionnement du système d’alerte et d’information de la population en cas de pollution atmosphérique accidentelle sur Calais et des interventions dans les lycées et collèges de la région figurent parmi les autres actions menées par le SPPPI. 6., le perfectionnement du système d’alerte et d’information de la population en cas de pollution atmosphérique accidentelle sur Calais et des interventions dans les lycées et collèges de la région figurent parmi les autres actions menées par le SPPPI.
De son côté, le SPPPI de l’Artois organise depuis juin 2001 une campagne d’information sur les risques majeurs dans l’Artois qui s’est appuyée sur la réalisation d’enquêtes de perception sur les risques et la conception de différents produits de diffusion (films, cédéroms, etc.). Il a été mis à contribution dans le contexte de la pollution du site de Metaleurop en tant que vecteur d’information vers la population.
 Les sites et sols pollués : beaucoup reste encore à faire Les sites et sols pollués : beaucoup reste encore à faire |
|
Les sites pollués, c’est-à-dire les sites où le sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d’anciens dépôts de déchets ou par des infiltrations de substances polluantes, sont nombreux dans la région en raison de son histoire industrielle et minière. En 2002, la région comptait 483 sites pollués (dont les trois quarts dans le Nord), soit 14 % du nombre total national. Cette proportion est largement supérieure à son poids économique : le Nord - Pasde- Calais représentait, en 2000, 5,4 % du PIB français  7. 7.
L’inventaire Basol  8. répertorie les sites sur lesquels l’administration mène une action à titre curatif (sols effectivement pollués) ou préventif (sols pouvant être pollués par une activité en fonctionnement). Cet inventaire est en évolution constante - il est probable que des sites pollués en Nord - Pas-de-Calais ne soient pas encore répertoriés par les services de la Drire. Les sites sont introduits dans la base à partir du moment où l’inspection des installations classées dispose d’éléments techniques et administratifs. Il convient également de remarquer que font partie de cet inventaire aussi bien des sites pollués par des fuites de stations-service que des sites d’usines chimiques de grande importance ayant laissé durablement leur empreinte dans les sols. 8. répertorie les sites sur lesquels l’administration mène une action à titre curatif (sols effectivement pollués) ou préventif (sols pouvant être pollués par une activité en fonctionnement). Cet inventaire est en évolution constante - il est probable que des sites pollués en Nord - Pas-de-Calais ne soient pas encore répertoriés par les services de la Drire. Les sites sont introduits dans la base à partir du moment où l’inspection des installations classées dispose d’éléments techniques et administratifs. Il convient également de remarquer que font partie de cet inventaire aussi bien des sites pollués par des fuites de stations-service que des sites d’usines chimiques de grande importance ayant laissé durablement leur empreinte dans les sols.
D’après le recensement des sites par la Drire, en 2001, 83 présentaient un impact de pollution avéré (18 % du total)  9., et pour 64 sites, les conséquences portaient principalement sur les eaux souterraines. 9., et pour 64 sites, les conséquences portaient principalement sur les eaux souterraines.
Le recensement des anciens sites de décharges ou d’activités industrielles s’opère grâce à une base de données nationale, Basias  10., gérée par le BRGM. Ces sites ne présentent plus de risques avérés, mais si des constructions ou des travaux venaient à y être entrepris sans précaution particulière, des impacts défavorables pourraient survenir. Il est donc conseillé de faire préalablement un diagnostic des sols. À terme, cet inventaire devrait contenir entre 300 000 et 400 000 sites au niveau national. 10., gérée par le BRGM. Ces sites ne présentent plus de risques avérés, mais si des constructions ou des travaux venaient à y être entrepris sans précaution particulière, des impacts défavorables pourraient survenir. Il est donc conseillé de faire préalablement un diagnostic des sols. À terme, cet inventaire devrait contenir entre 300 000 et 400 000 sites au niveau national.
Dans le Nord - Pas-de-Calais, l’Établissement public foncier (EPF) assure la maîtrise d’ouvrage du recensement qui regroupait environ 12 000 sites en 2001. De cet inventaire, il ressort les points suivants :
• les dépôts de liquides inflammables, la desserte de carburants, les garages et stations-service représentent 27 % des sites pollués ;
• les sites historiques sont concentrés dans les agglomérations avec 407 sites à Tourcoing, 754 sites à Roubaix, 240 sites à Valenciennes, 211 sites à Douai, 313 sites à Calais et 1 358 sites à Lille. Cette constatation est aussi valable pour les sites Basol.
| |
|
 Les sites et sols pollués Les sites et sols pollués
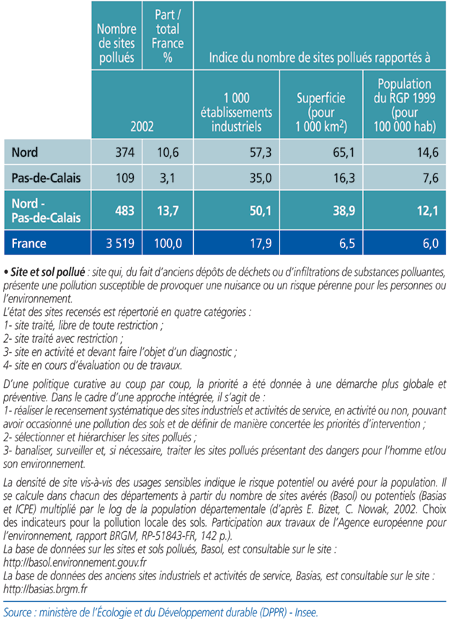
|
| |
|
 Les sols pollués - situation technique en 2002 Les sols pollués - situation technique en 2002

|
|
|
| |
|
 Les sols pollués - type d’activité en 2002 Les sols pollués - type d’activité en 2002
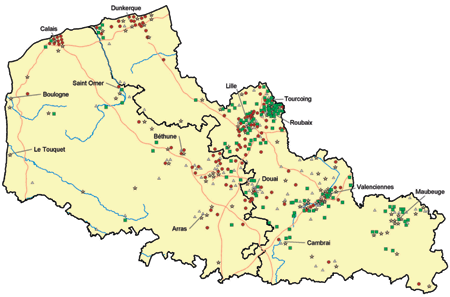
|
|
|
 Les émissions radioactives Les émissions radioactives |
La centrale nucléaire de Gravelines est située en bord de mer à égale distance de Dunkerque et de Calais (20 km). Le site comprend six réacteurs de 910 MW chacun, soit une puissance totale de 5 460 MW. D’une façon générale, les rejets radioactifs des centrales proviennent des produits engendrés par la fission des noyaux d’uranium du combustible, des produits de corrosion activés lors de leur passage dans le cœur du réacteur nucléaire et enfin du tritium formé dans le cœur et dans l’eau du circuit primaire. Ces rejets liquides correspondent à des effluents usés qui font l’objet d’un traitement poussé et d’un stockage plus ou moins long. Dès que la radioactivité passe en dessous des normes de rejets fixées par la réglementation, l’effluent est rejeté.
En 2001, l’activité totale tritium des rejets liquides de Gravelines s’établissait à 32 % de la limite annuelle réglementaire pour les six réacteurs contre 0,27 % pour l’activité totale hors tritium. Le bilan des rejets gazeux montre que les limites réglementaires sont également respectées.
Les déchets hautement actifs et moyennement actifs à vie longue sont transférés à l’usine de traitement de La Hague. Au cours de l’année 2001, 140 tonnes de combustible ont été retraitées, et ont généré, in fine, 50 m3 de déchets (produits de fission de haute activité) stockés dans des conteneurs à La Hague.
Les incidents qui peuvent survenir dans la centrale de Gravelines sont régulièrement analysés par la Drire. Le nombre d’incidents classés en 2001 (35) est en diminution par rapport à celui de 2000 (51). En revanche, le nombre d’incidents de niveau 1 (anomalie) est relativement constant.
 Notes Notes
|
6 - Voir http://www.spppi.org
7 - Selon l’estimation provisoire de l’Insee, le Nord - Pas-de-Calais représenterait, en 2002, 5,2 % du PIB français.
8 - Voir http://basol.environnement.gouv.fr
9 - Drire Nord - Pas-de-Calais, 2002. L’industrie au regard de l’environnement. Douai, 265 p.
10 - Voir http://basias.brgm.fr
|
|
|